 C’est devenu un lieu commun de la vulgarisation scientifique : en ce qui concerne les dispositions psychiques humaines, la science a permis de dépasser le débat entre « inné » (de droite) et « acquis » (de gauche). Mais de quel débat parle-t-on exactement, et sur quelles données scientifiques cette affirmation est-elle fondée ?
C’est devenu un lieu commun de la vulgarisation scientifique : en ce qui concerne les dispositions psychiques humaines, la science a permis de dépasser le débat entre « inné » (de droite) et « acquis » (de gauche). Mais de quel débat parle-t-on exactement, et sur quelles données scientifiques cette affirmation est-elle fondée ?
En février dernier, en pleine campagne présidentielle, le biologiste Pierre-Henri Gouyon, chercheur et professeur de renom intervenant fréquemment dans l’espace public pour parler d’évolution, de génétique, d’écologie et de bioéthique, donnait une conférence sur l’inné et l’acquis présentée comme suit :
« La question de ce qui est inné ou dû à l’environnement social dans les comportements humains défraie régulièrement la chronique. Qu’il s’agisse de questions de genre/sexe ou de comportements déviants, ces sujets resurgissent particulièrement en périodes pré-électorales. Que peut-on en dire sur le plan biologique ? […] » [1]
Lors de cette conférence, le biologiste – qui va donc nous expliquer ce qu’on peut en dire « sur le plan biologique » – commence par revenir sur le fameux débat qui avait opposé en 2007 Michel Onfray à Nicolas Sarkozy : le premier avait affirmé qu’ « on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile » et dit penser que « nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement », le second avait indiqué qu’il inclinait pour sa part à penser qu’ « on naît pédophile » et expliqué que les jeunes qui se suicidaient le faisaient non parce que leurs parents s’étaient mal occupé d’eux « mais parce que, génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable » [2].
Gouyon ironise sur la probable ignorance en génétique du « philosophe de gauche » comme du « candidat de droite », et résume ainsi la dimension idéologique de leurs propos : « les gènes c’est de droite, l’environnement c’est de gauche ». Brossant à grands traits une histoire de cette cristallisation du débat inné/acquis en clivage droite/gauche, il oppose deux extrémismes de la première moitié du 20ème siècle : d’un côté, à l’Ouest, la croyance dans l’inné a fait de la génétique la base de l’eugénisme et du nazisme ; de l’autre, dans la Russie soviétique, la croyance inverse a été promue et imposée par Lyssenko, théoricien de l’idée de Engels « qu’il n’y a aucune différence entre humains à la naissance et que c’est uniquement, et les propos de Michel Onfray reviennent tout-à-fait là-dessus, c’est uniquement la société qui les transforme, et donc le résultat c’est qu’on serait tous pareils, messieurs dames, si jamais on avait exactement vécu dans la même société ».
Mais ce débat idéologique, c’est du passé, nous dit Gouyon :
« Evidemment, c’est aussi faux l’un que l’autre, hein. […] la variation que j’observe dans une population, c’est la somme des effets de l’environnement plus des effets des gènes. Et […] évidemment, hein, ce qui compte, c’est de comprendre qu’il y a toujours de l’environnement et des gènes qui jouent, dans quasiment tous les caractères. »
Il explique ensuite qu’on sait même calculer la part respective de l’un et de l’autre dans la variabilité d’un caractère observée dans une population et un panel d’environnements donnés :
« C’est exactement ce qu’on fait en génétique : on va pouvoir, sur une variation – la taille du blé, ou le QI des enfants – mesurer la part de variation qui est due à l’environnement et la part de variation qui est due aux gènes. Et on peut trouver que c’est de l’ordre de 50/50 chez les enfants français des années 1970. Mais ça veut rien dire d’autre que “à cet endroit-là” : si je change le système scolaire, je vais changer les résultats. […] En fait, d’ailleurs, c’est ce que j’ai dit à des enseignants, ça les a horrifiés, c’est que si on arrivait à faire un système éducatif parfait, parfaitement égalitaire, eh bien comme il n’y aurait plus aucune variation environnementale, il ne resterait plus que les variations génétiques. […] Ca veut dire qu’Onfray a bien tort de dire qu’il n’y a pas de gènes dans l’histoire. Il y a pas besoin de dire ça. Il suffit de comprendre que même s’il y a des gènes, l’environnement change tout, et donc effectivement, même si vous êtes de gauche, vous pouvez accepter qu’il y ait des gènes, vous aurez le droit de changer l’environnement pour changer les résultats. »
Avant d’examiner la pertinence et la solidité scientifique de cet argumentaire, revenons pour commencer au fond du débat inné/acquis et à son point de départ.
Les perceptions de sens commun et le débat idéologique
Chacun fait l’expérience de certaines régularités observables dans les comportements et les performances d’autrui, en même temps que celle de leur variabilité interindividuelle : untel ne reste pas en place et réagit souvent au quart de tour aux événements, alors que tel autre est généralement calme et agit de manière posée; untel a systématiquement de bonnes notes en maths sans rien faire, alors que tel autre y consacre de vains efforts. On a tendance à attribuer ce phénomène à l’existence de « dispositions psychiques », au sens d’un ensemble intrinsèque à une personne et relativement stable de traits de la personnalité et de capacités cognitives influençant ses comportements et ses performances : en langage commun, il nous semble que certaines personnes sont plus « intelligentes » (ou « impulsives », « optimistes », « douées pour les maths », « émotives », « ambitieuses », « douées pour les langues », « égoïstes », « introverties », etc) que d’autres. On peut faire la même expérience et la même attribution non plus au niveau d’individus, mais au niveau de catégories d’individus correspondant à un découpage perçu, pour une raison ou une autre, comme ayant une certaine pertinence. Par exemple, il semblera à certains qu’en général, « les filles » sont plus « coquettes » que « les garçons », « les hommes » sont plus « capables d’abstraction » que « les femmes », ou encore « les noirs » sont plus « insouciants » que « les blancs ».
Il est évident que de telles différences entre individus dans les dispositions psychiques, si elles existent, sont susceptibles de contribuer à causer des différences dans leurs trajectoires de vie en général, et dans leur acquisition de capitaux économique, culturel, social et symbolique en particulier. A partir de là, le « débat inné/acquis » tel qu’il se pose dans l’espace public du fait de ses implications politiques correspond à la question de savoir si ces différences sont au moins en partie dues à des facteurs biologiques innés, et le cas échéant de savoir :
· si ces facteurs sont héritables, au sens ici de transmissibles sans modification, selon une certaine probabilité, des parents aux enfants, ce qui expliquerait en partie certains phénomènes de reproduction sociale ;
· dans quelle mesure ces facteurs eux-mêmes ou leurs effets sont façonnables.
L’héritabilité et le caractère non façonnable constituent clairement des arguments pouvant justifier, en matière de hiérarchies économiques et sociales, un conservatisme et une relativisation de l’objectif d’égalité qui sont plutôt « de droite », contre un progressisme et une priorisation de l’objectif d’égalité qui sont plutôt « de gauche » – bien qu’ils puissent aussi justifier une politique eugéniste de gauche. C’est là que se situe le débat idéologique, et on voit bien que la pertinence de telle ou telle politique concrète dépend notamment de la réponse à ces questions.
Ainsi, si de tels facteurs existent et sont héritables, alors un constat d’inégalités d’accès au diplôme d’ingénieur, par exemple, entre certains groupes sociaux (enfants d’ingénieurs vs d’ouvriers, « blancs » vs « noirs », garçons vs filles, etc) ne permet pas automatiquement d’incriminer les inégalités sociales ou les discriminations et de justifier un programme de lutte contre ceux-ci : peut-être n’ont-ils statistiquement pas les mêmes chances d’être biologiquement prédisposé à développer l’envie et les moyens intellectuels de réussir un tel concours. De même, si de tels facteurs existent et ne sont que partiellement façonnables, alors peut-être n’est-il pas raisonnable de vouloir amener tel pourcentage d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat, par exemple.
Dans nos sociétés laïcisées et démocratiques, la science a acquis le statut d’autorité cognitive, et l’expertise scientifique un rôle croissant de guide censément neutre de l’action publique [3] : il est donc logique de se tourner vers elle pour trancher ce débat.
Une traduction scientifique du débat
Des échelles de mesure sont élaborées par les psychométriciens pour tenter d’objectiver la notion de dispositions psychiques. Il existe des débats scientifiques sur la question de savoir ce que chacune d’elles mesure au juste et avec quelle robustesse, mais il existe du moins un consensus sur l’idée qu’elles constituent un moyen pertinent, bien qu’imparfait, d’approcher scientifiquement cette notion. En ce qui concerne les facteurs biologiques héritables et a priori non façonnables en tant que tels, c’est le concept de patrimoine génétique des individus qui fait actuellement l’affaire.
Sur cette base, le débat inné/acquis tel que je viens de le formuler peut se traduire par la question suivante :
(Q1) Les différences entre individus dans les scores obtenus à telle ou telle mesure de capacités cognitives, de traits de la personnalité ou de tendances comportementales sont-elles en partie causées, via des mécanismes biologiques, par des différences dans les variantes génétiques qu’ils possèdent ?
Et le cas échéant, trancher complètement le débat commande qu’on réponde aux deux questions subsidiaires suivantes :
(Q2) Existe-t-il des différences de dosage de ces variantes génétiques dans les populations humaines définies par le sexe, l’origine géographique, ou encore la classe sociale (ou une interaction entre ces variantes et d’autres variantes génétiques inégalement réparties entre ces populations) de nature à causer des différences dans ces scores ?
(Q3) Est-il possible d’entièrement compenser par l’ « environnement » (régime alimentaire de la mère durant la grossesse, enrichissement environnemental néonatal ciblé, règles éducatives, méthodes pédagogiques,…) les désavantages cognitifs ou les troubles comportementaux lié à la possession de certaines variantes ?
Un élément de réponse et une reformulation de la question : les anomalies génétiques
On peut clairement répondre par l’affirmative à la question Q1, dans la mesure où on sait qu’il existe des anomalies génétiques innées causant, chez les personnes qui en sont porteuses, des troubles développementaux. Par exemple, la forme la plus fréquente de trisomie 21 s’accompagne toujours d’une déficience intellectuelle plus ou moins marquée dont la présence anormale d’un troisième chromosome 21 est indubitablement la cause, même si la chaîne de causalité biologique aboutissant à cette déficience n’est pas élucidée. Le syndrome de l’X fragile s’accompagne quant à lui de retard mental en gros chez tous les garçons qui sont porteurs de cette anomalie génétique mais chez la moitié des filles, ledit retard étant en moyenne moins important chez celles-ci, et c’est la répétition anormale d’une séquence située sur le chromosome X qui en est indubitablement la cause (d’où le moindre impact chez les filles, qui ont un autre chromosome X pouvant compenser le chromosome X anormal). Un autre exemple bien connu est la phénylcétonurie, qui s’accompagne d’un développement psychomoteur anormal causé par la mutation d’un gène situé sur le chromosome 12 : cette mutation provoque un déficit de production d’une substance servant à transformer la phénylalanine, or au-delà d’une certaine concentration dans le sang elle est toxique pour le cerveau.
Ces trois exemples permettent d’ores et déjà de voir que les questions posées n’ont pas une réponse unique. Ainsi, la réponse à la question Q2 est clairement « oui » pour le syndrome de l’X fragile (différence selon le sexe) ainsi que pour la phénylcétonurie (dont la fréquence semble assez variable selon les pays et varie presque du simple au triple en France selon les régions [4]), mais plutôt « non » pour la trisomie 21. En ce qui concerne la réponse à la question Q3, elle est pour l’instant « non » pour la trisomie 21 et pour le syndrome de l’X fragile, même si une prise en charge précoce adaptée permet d’améliorer le fonctionnement des personnes concernées, mais « oui » pour la phénylcétonurie (les effets de cette mutation peuvent être compensés, en cas de dépistage néonatal comme c’est le cas en France de manière systématique depuis 1972, par le suivi strict d’un régime alimentaire limitant l’apport en phénylalanine).
Mais ce ne sont pas les personnes porteuses d’anomalies génétiques qui font l’objet du débat idéologique ou politique global tel que je l’ai formulé plus haut. La question Q1 doit en fait être reformulée comme suit :
(Q1bis) Hormis les individus porteurs d’anomalies génétiques rares (par définition) causant certains troubles développementaux, dans le reste de la population les différences entre individus dans les scores obtenus à telle ou telle mesure de capacités cognitives, de traits de la personnalité ou de tendances comportementales sont-elles en partie causées, via des mécanismes biologiques, par des différences dans les variantes génétiques qu’ils possèdent ?
Un faux dépassement du débat via sa substitution par une fausse question
Lorsque Pierre-Henri Gouyon explique qu’« évidemment, […] il y a toujours de l’environnement et des gènes qui jouent » pour contrer la vision qu’il prend plus particulièrement pour cible, c’est-à-dire celle « de gauche » d’Onfray, il utilise une rhétorique fallacieuse fréquemment employée pour faire mine de répondre à cette question en répondant à une autre.
L’argumentaire sous-jacent à cette « évidence » est le suivant, énoncé ici par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik :
« “Il faut dépasser ces clivages obsolètes, assure Boris Cyrulnik. L’inné, l’acquis, c’est un vocabulaire idéologique. La biologie n’est rien sans la culture, et vice versa. C’est comme se demander si, pour respirer, qui des poumons ou de l’oxygène est le plus important. Un cerveau sain sans émotions ne donnera rien de bon, des émotions sans cerveau non plus. […]” » [5], ou encore : « Nous sommes pétris par notre milieu autant que par nos gènes. Je crois ainsi que la distinction gène/environnement – c’est-à-dire inné/acquis – est purement idéologique et pas du tout scientifique. Le gène est aussi vital que l’environnement, ils sont inséparables. Nous sommes déterminés à 100 % par nos gènes et à 100% par notre environnement. » [6]
Nul besoin de connaissances en génétique, en effet, pour savoir que sans gènes (comme sans nutriments), on ne développe ni cerveau ni dispositions psychiques, ou plus sérieusement que les gènes ne « programment » pas le fonctionnement mental indépendamment de l’influence de l’environnement, et réciproquement : on sait depuis le début du 20ème siècle que le manque d’iode dans l’alimentation provoque le retard mental communément appelé crétinisme, ou encore qu’un « enfant sauvage » qui n’a entendu personne parler pendant les 10 premières années de sa vie ne pourra développer des capacités langagières normales, de même qu’on sait réciproquement que quel que soit l’environnement dans lequel ils grandissent, les enfants atteints de trisomie 21 ne sont jamais « normaux ».
Sur un plan plus scientifique, on sait depuis les travaux de Hubel et Wiesel menés dans les années 1960 que l’interaction avec l’environnement guide le développement des connexions entre neurones au point de complètement façonner la fonction visuelle, une fonction dont on aurait pourtant pu croire que son développement résultait entièrement du déroulement d’un programme génétique. De manière plus générale, on sait depuis longtemps que notre cerveau est plastique, et comme le formulait le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux en 1970, la plasticité cérébrale, associée dans notre espèce à une longue période de maturation postnatale, nous confère « la propriété d’échapper au déterminisme génétique absolu », car le cerveau se développe et se remanie tout au long de la vie dans une « interaction structurante » avec notre environnement physique et social [7].
L’invocation de l’ « évidence » d’un rôle des gènes vise en fait à induire la confusion classique entre la question de la genèse d’une caractéristique chez un individu d’une part, et celle de l’origine des différences entre individus dans cette caractéristique d’autre part, qui est celle que j’ai formulée plus haut et qui fait véritablement l’objet du débat idéologique. Or dire que le patrimoine génétique d’un individu est un facteur déterminant dans la genèse de ses dispositions psychiques ne permet nullement de conclure que la variabilité des dispositions psychiques entre individus de patrimoines génétiques normaux est en partie déterminée par la variabilité de ceux-ci.
Genèse d’un trait individuel vs causes des différences entre individus dans ce trait
Pour prendre une image proche de celle utilisée par Pierre-Henri Gouyon lors d’une autre intervention [8], disons qu’un individu est l’équivalent d’une crêpe, qui va être le résultat de trois facteurs : une recette (le patrimoine génétique de l’individu), des ingrédients (l’environnement biologique de l’individu), et la réalisation de la recette par un cuisinier avec son matériel (l’interaction avec l’environnement socio-affectif, matériel et culturel de l’individu). Disons par ailleurs que les dispositions psychiques d’un individu correspondent à la couleur de la crêpe, son QI correspondant à la moyenne des longueurs d’ondes émises par la surface de la crêpe mesurée dans des conditions d’éclairage définies, exprimée en nanomètres (nm). Posons enfin que les recettes de crêpe existantes ont été sélectionnées au cours de l’histoire de la gastronomie pour ne conserver que des recettes correctes, seuls de rares cas de recettes mal recopiées étant ici ou là en circulation (le patrimoine génétique de l’humanité a fait l’objet de pressions évolutives telles que tous les êtres humains sont génétiquement dotés du potentiel de développement de capacités intellectuelles minimales, hormis dans de rares cas de mutations génétiques).
Les trois facteurs sont nécessaires à l’existence d’une crêpe, et la question de savoir, pour une crêpe donnée de « QI » égal à 590 nm, combien de nanomètres sont dus à la recette, combien aux ingrédients et combien au cuisinier n’a pas plus de sens que la question de savoir quel pourcentage de la surface d’un rectangle est respectivement due à sa largeur et à sa longueur. En fait, si toutes choses égales par ailleurs la recette n’avait pas mentionné qu’il fallait des œufs (trisomie 21), ou s’il n’y avait pas eu d’œufs disponibles pour la réaliser (absence d’iode), ou si le cuisinier avait oublié de cuire la pâte (enfant sauvage), le QI de la crêpe aurait été différent de 590, et en ce sens il a été « déterminé à 100% » par chacun des trois facteurs, pour paraphraser Boris Cyrulnik.
Mais savoir cela ne permet ni de répondre à la question suivante, ni de dire qu’elle n’a pas de sens :
(Q1bis) Considérant toutes les variantes existantes de recettes de crêpe hormis les recettes mal recopiées, les différences de couleur observées entre les crêpes faites par divers cuisiniers avec divers ingrédients sont-elles en partie causées par des différences dans ces recettes, ou entièrement imputables aux différences dans les ingrédients utilisés et les modes opératoires des cuisiniers ?
En effet, il se pourrait bien que les seules variantes de recettes existantes concernent des points sans effet détectable sur la couleur (ex : certaines indiqueraient qu’il faut deux pincées de sel et d’autres une). Comme on le voit, cette question n’est pas « évidemment » dépassée avant toute analyse des variantes de recettes existantes et de leurs effets éventuels sur la couleur des crêpes. De même, la réponse à la question équivalente formulée plus haut concernant l’être humain ne peut être apportée que par l’étude scientifique des variantes génétiques communes et de leurs effets éventuels sur le développement des caractéristiques cognitives et comportementales. Les recherches scientifiques sur cette question sont toujours vivaces – ce qui montre déjà qu’elle n’est ni « dépassée », ni « obsolète », ni « pas du tout scientifique ». Qu’y répondent-elles ?
Un élément de réponse : les calculs de corrélations entre variantes génétiques et scores mesurés
Lorsque Pierre-Henri Gouyon explique que les généticiens peuvent « mesurer la part de variation qui est due à l’environnement et la part de variation qui est due aux gènes » pour le QI des enfants comme pour la taille du blé, c’est l’ingénieur agronome, docteur et chercheur en sciences de l’évolution, génétique et écologie appliquées à la botanique qui parle. Car si ce qu’il dit est vrai pour la taille du blé, ça ne l’est pas pour le QI.
Même le pionnier et éminent promoteur de la génétique comportementale en France qu’est Pierre Roubertoux, qui a fondé et dirigé le laboratoire « Génétique, neurogénétique, comportement » du CNRS, n’ose pas « survendre » ainsi les résultats de la recherche en la matière. Comme il l’indiquait en 1996 [9], et les arguments qu’il développe dans cet article de vulgarisation restent considérés comme recevables dans le débat scientifique actuel, les estimations d’héritabilité génétique du QI calculées depuis des décennies sur la base d’études familiales, d’études de jumeaux et d’études d’adoption, et plus récemment sur la base d’études moléculaires (études de liaison ou études d’association pangénomiques) ne font qu’estimer un effet statistique de la variabilité génétique sur celle du QI [10].
Or cela ne permet pas d’inférer qu’il existe une chaîne de causalité biologique entre les variantes génétiques concernées et la genèse du substrat biologique qui serait responsable de la variabilité du QI. En effet, à la différence des études faites sur les plantes, où on fait varier les gènes et l’environnement de manière contrôlée, celles faites sur l’Homme sont biaisées en raison des interactions non contrôlables entre gènes et environnement (qui font que la règle selon laquelle « la variation que j’observe dans une population, c’est la somme des effets de l’environnement plus des effets des gènes » n’est pas applicable à ces études).
Pour illustrer cette notion d’interaction gènes/environnement, revenons aux crêpes. Imaginons que les recettes indiquant qu’il faut deux pincées de sel au lieu d’une se trouvent plus souvent avoir été transmises dans des familles où on a également l’habitude de manger les crêpes particulièrement cuites. Si on faisait une étude équivalente à celles mentionnées ci-dessus, mettant en relation la variabilité du gène « quantité de sel indiquée dans la recette» et celle de la couleur des crêpes cuisinées dans les différentes familles, ont trouverait qu’il y a un effet statistique de ce gène sur la couleur. Pourtant, la variabilité de la couleur serait en fait ici causée par le fait de plus ou moins cuire les crêpes.
C’est ce type d’interaction gène/environnement – les variantes génétiques ne sont pas nécessairement uniformément réparties dans les différents environnements – qui fait que bien que Pierre-Henri Gouyon affirme comme évidente l’absence totale de lien de causalité entre le patrimoine génétique et le fait d’avoir un bon accent en anglais [11], on pourrait néanmoins très facilement trouver un effet statistique de la variabilité génétique sur celui-ci en réalisant des études semblables à celles qu’il invoque concernant le QI (ex : une étude menée en Angleterre pourrait trouver une corrélation entre l’accent indo-pakistanais et des combinaisons de variantes génétiques plus fréquentes chez les personnes originaires d’Inde ou du Pakistan).
Un autre type d’interaction gènes/environnement qui biaise ces études concernant les dispositions psychiques humaines est le fait qu’ici, les gènes peuvent modifier l’environnement. Par exemple, typiquement, le fait d’avoir une paire de chromosomes sexuels XX ou XY, autrement dit d’être une fille ou un garçon, induit dans notre culture des différences d’attitudes de l’entourage, de vécu, de modèles d’identification disponibles et culturellement imposés qui influent sur le développement psychologique d’un enfant. Par conséquent, une partie – et pourquoi pas la totalité ? – de l’effet statistique de cette différence génétique sur certains traits psychologiques est en réalité causée par l’ « environnement ». Pour en revenir aux crêpes, c’est comme si pour une raison ou une autre, la croyance selon laquelle plus une crêpe est salée, plus il faut la cuire, était relativement répandue chez les cuisiniers : on trouverait un effet statistique de la variabilité du gène « quantité de sel indiquée dans la recette» sur la variabilité de la couleur des crêpes, et pourtant ici encore celle-ci serait en fait causée par la différence de cuisson.
La réponse scientifique définitive à la question Q1bis n’est donc pas apportée par ce type d’études, et elle n’est en aucun cas globale : selon les dispositions psychiques considérées, d’autres types d’études existent ou non (études sur des souris génétiquement modifiées, études in vitro de l’expression des gènes, etc) qui apportent parfois des indices en faveur d’une réponse affirmative, mais le niveau de confiance dans cette hypothèse permis par la littérature scientifique existante reste à évaluer au cas par cas. En ce qui concerne l’« intelligence » en tout cas, on est loin d’avoir confirmé cette hypothèse, et avec le recul de la distance critique et du temps, le caractère fallacieux des arguments et prédictions du psychologue évolutionniste Steven Pinker développés dans son best seller publié en France par les éditions Odile Jacob apparait dans toute sa crudité [12].
Quid des différences entre groupes sociaux ?
En imaginant qu’on ait répondu par l’affirmative à la question Q1bis pour telle ou telle disposition psychique, resterait à répondre à la question Q2, c’est-à-dire à déterminer si les variantes génétiques responsables de différences entre individus sont aussi responsables de différences entre certains groupes sociaux. Comme l’explique également Pierre Roubertoux, quand bien même le caractère héréditaire d’un trait serait avéré, on ne pourrait en effet en déduire que les différences entre deux populations dans ce trait sont d’origine génétique (cf [9]).
Lors de son exposé, Pierre-Henri Gouyon s’abstient d’aborder ce sujet glissant. Des intermédiaires culturels moins scrupuleux et surtout beaucoup plus ignorants n’hésitent pas, quant à eux, à sauter le pas, tels le journaliste Brice Couturier et la romancière-essayiste féministe Nancy Huston qui ont récemment donné sur France culture une version caricaturale du faux argument et de l’accusation de parti-pris idéologique vus plus haut pour expliquer que certaines différences comportementales entre hommes et femmes – par exemple la tendance des femmes à être « extrêmement préoccupées par des choses comme leurs enfants, la beauté », selon Huston – sont « évidemment » dues en partie à des dispositions innées [13]. Ce qui est en tout cas évident, c’est que de tels propos expriment les croyances de ceux qui les tiennent et non les conséquences tirées de l’état des connaissances scientifiques, dont Huston trahit d’ailleurs la méconnaissance crasse en attribuant aux seuls biologistes marxistes l’idée que des traits acquis puissent être héritables [14].
Compenser l’inné par l’acquis ?
Toujours en imaginant qu’on ait répondu par l’affirmative à la question Q1bis, resterait également à répondre à la question Q3. Lorsque Pierre-Henri Gouyon affirme que « même s’il y a des gènes, l’environnement change tout », et que par conséquent on peut conserver un objectif d’égalité dont l’atteinte reposerait sur la modification contrôlée de l’environnement, on sent poindre une certaine mauvaise foi. Car dans l’état actuel des connaissances scientifiques, on ne sait pas comment il conviendrait de procéder pour faire en sorte qu’à l’avenir tous les individus de patrimoine génétique normal aient, par exemple, un niveau de QI au moins égal à un 130 actuel.
Gouyon contredit d’ailleurs cet idée en affirmant que si on arrivait à faire un système éducatif « parfaitement égalitaire », il resterait une variabilité des performances scolaires entièrement causée par la variabilité génétique (affirmation aussi fallacieuse que la conséquence qu’il prête à la théorie de Lyssenko, à savoir qu’on serait « tous pareils » si on avait « exactement vécu dans la même société », l’environnement de développement intellectuel d’un enfant ne se réduisant pas à son environnement scolaire, de la même manière que l’environnement biologique, matériel, culturel et socio-affectif de développement d’un être humain n’est pas équivalent à « la société »).
Cette affirmation contredit du reste également le fait (avéré) qu’il relaye pourtant aussi, mais sans aller au bout de ses conséquences, que les parts de variabilité attribuées respectivement aux gènes et à l’environnement sont très variables selon la diversité génétique de la population qu’on étudie et la diversité de l’environnement dans lequel se sont développés les individus de cette population. En effet, rien n’empêche a priori d’imaginer que dans un environnement optimal particulier, la variabilité attribuable aux gènes soit réduite à 0, une large variabilité due aux mille et une micro-différences dans les expériences vécues dès la vie intra-utérine subsistant.
Il conviendrait peut-être de se demander pourquoi, bizarrement, la recherche en génétique comportementale sur la variabilité commune des dispositions psychiques qui fait l’objet d’une communication publique indique presque toujours qu’en gros, tout est déterminé à peu près à 50% par les gènes et à 50% par l’environnement. Serait-ce parce que pour faire avaler la pilule d’une certaine part de déterminisme génétique sans faire trop peur, ce chiffrage a l’avantage de suggérer que le second facteur serait assez puissant pour compenser le premier ?
Odile Fillod
______________________________
Notes
[1] Pierre-Henri Gouyon, « L’inné, l’acquis… et le reste », conférence donnée le 09/02/2012 à l’Université Paris Diderot dans le cadre des sessions « Treize minutes », diffusée en direct en streaming sur le Portail de la science géré par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (www.science.gouv.fr). Vidéo et présentation de la conférence disponibles sur http://www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/spip.php?article280.
[2] Alexandre Lacroix, Nicolas Truong (propos recueillis par), mars 2007, « Nicolas Sarkozy et Michel Onfray – Confidences entre ennemis », Philosophie magazine, n°8, p.30-37.
[3] Cf Dominique Pestre, 2010, « Dix thèses sur les sciences, la recherche scientifique et le monde social, 1945-2010 », Le Mouvement Social, n°233, p.13-29.
[4] Cf Haute Autorité de Santé, 2010, Phénylcétonurie. Protocole national de diagnostic et de soin, en ligne sur http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-05/ald_17_pnds_pcu_web.pdf.
[5] Giulia Foïs, 2007, « Enquête : est-on obligé d’aimer sa mère ? », Psychologies magazine, n°260, p.54.
[6] Patrice van Eersel, Marc de Smedt (propos recueillis par), 2007, « Boris Cyrulnik – Pour être heureux il faut avoir souffert », Nouvelles Clés.
[7] Jean-Pierre Changeux, 1970, « L’inné et l’acquis dans la structure du cerveau », La Recherche, n°3.
[8] Pierre-Henri Gouyon, 02/01/2009, « Notre mode de vie modifie-t-il nos gènes ? », Science Publique (France Culture).
[9] Pierre Roubertoux, Michèle Carlier, 1996, « Le QI est-il héritable ? », La Recherche, n°283, p.70-78, en ligne sur http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=22517.
[10] Voir la discussion du compte-rendu médiatique de l’une d’elles dans https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/02/16/intelligence-et-genetique/. Dans l’article scientifique rapportant les résultats de cette étude, publié en 2011, les auteurs n’écrivent pas qu’ils démontrent l’existence d’une causalité génétique dans la variabilité du QI, et rappellent que les études moléculaires n’ont permis d’identifier aucun gène ou variante génétique particulière associée de manière robuste à une mesure de l’intelligence. Cf Davies et al., 2011, Molecular Psychiatry, vol. 16(10), p.996-1005, souligné en italiques par moi : « We estimate that 40% of the variation in crystallized-type intelligence and 51% of the variation in fluid-type intelligence between individuals is accounted for by linkage disequilibrium between genotyped common SNP markers and unknown causal variants. […] Intelligence is highly familial, yet the extent and nature of the genetic contribution to intelligence differences has been controversial. […]However, no single genes or gene variants have been identified that are robustly associated with intelligence-related phenotypes. […] This suggests that human intelligence and perhaps other complex traits are highly polygenic, […] ». Dans le numéro spécial d’une revue scientifique consacré au rôle des interactions gènes/environnement dans le développement humain, un chercheur qui mène pourtant lui-même des recherches visant à mettre au jour les effets des gènes sur la maladie mentale, l’intelligence et la personnalité, citant entre autres cet article de Davies et al., souligne que la littérature scientifique rapportant de tels calculs d’héritabilité montre que tout et n’importe quoi est « héritable » (par exemple le statut marital, qui le serait à 40% environ), et qu’il est problématique de faire la différence entre les phénotypes héritables en raison de mécanismes génétiques et les autres : cf Eric Turkheimer, 2011, Still missing, Research in Human Development, vol.8(3-4), p.227-241 (« […] the very ubiquity of heritability has made it problematic to differentiate between heritable phenotypes that have genetic mechanisms and those that do not. »).
[11] Cf Pierre-Henri Gouyon in [1] : « Il y a d’autres trucs qui sont absolument pas sensibles aux gènes, par exemple l’accent anglais : les gens qui parlent bien anglais au niveau mondial, c’est pas compliqué, ils sont nés en Angleterre [rires des spectateurs]. Leurs gènes n’ont rien à voir. ».
[12] Dans Comprendre la nature humaine, publié en 2005 chez Odile Jacob (initialement publié en 2002 aux Etats-Unis sous le titre The blank slate : the modern denial of human nature), Pinker (p. 69) écrit que les études de jumeaux et d’adoption apportent « une forte preuve que les différences entre les esprits peuvent provenir de différences dans les gènes » puis invoque les cas de mutations invalidantes, ces deux arguments ne constituant pas des preuves d’une causalité génétique dans la variabilité commune, comme on vient de le voir. Il invoque ensuite une étude ayant trouvé une association entre une variante du gène IGF2R et l’ « intelligence supérieure » dont la réplication a en fait échoué, comme il est rappelé par exemple dans les articles cités dans la note [10] ci-dessus (de même qu’il invoque l’étude de Lesch et al. De 1996 censée avoir montré selon lui que le fait d’être porteur de la version courte du gène du transporteur de la sérotonine augmente la probabilité d’être « névrosé et anxieux, de ceux qui ne peuvent pratiquement pas fonctionner dans les réunions sociales de crainte d’offenser quelqu’un ou de se conduire comme des imbéciles », pourtant également démentie : voir https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/03/19/serotonine-races-et-civilisations/). La prédiction qu’il formulait en 2002 dans l’édition originale résonne cruellement (pour lui) en 2012 : « In the coming decade, geneticists will […] identify which combinations are associated with normal, abnormal, and exceptional mental abilities, and begin to trace the chain of causation in fetal development by which genes shape the brain systems that let us learn, feel, and act. » ( « Dans les dix ans à venir, les généticiens […] identifieront les combinaisons qui sont associées avec les aptitudes mentales normales, anormales et exceptionnelles, et ils commenceront à suivre à la trace dans le développement fœtal l’enchaînement des causes qui permettent aux gènes de façonner les systèmes cérébraux qui nous font apprendre, ressentir, agir. », in Pinker, 2005, Odile Jacob, p.69).
[13] Extraits de l’émission « L’invité des matins », le 22/05/2012 sur France Culture, et de la chronique de Brice Couturier au cours de l’émission :
« [Nancy Huston :] Ce dogme du genre, des études du genre, maintenant à mon sens ça devient un petit peu comme le marxisme lors de mon arrivée en France il y a 40 ans, c’est-à-dire, on avait juste pas le droit de le remettre en cause. […] Le paradoxe, avec les théories du… les théoriciennes du genre, c’est que très souvent elles n’aiment pas les femmes. Elles n’aiment pas les femmes réelles : elles n’aiment pas les préoccupations des femmes réelles, ni les comportements des femmes réelles.
[Marc Voinchet :] C’est quoi, une femme réelle ?
[Nancy Huston :] Non mais, juste quand on regarde le monde, comment ça fonctionne, on voit que les femmes sont extrêmement préoccupées par des choses comme leurs enfants, la beauté, elles ont mille autres choses à faire aussi, mais ce sont des choses qui occupent une grande partie de leur esprit et de leur temps, et ce n’est pas que de l’aliénation. […] Il me semble que ces théories qui refusent de voir qu’il y a du donné, et pas seulement de l’acquis, sont dans une sorte de délire… comment dire… c’est un délire volontariste qui empêche de voir la réalité autour de nous, […]
[Brice Couturier :] La substitution du genre au sexe est le produit d’un courant important de la sociologie contemporaine, le constructivisme. […] Tout, dit-il, est socialement construit, rien n’est déterminé par la nature des choses ; celle-ci, d’ailleurs, n’existe pas […] Selon cette logique, la plupart des réalités sociales sont en fait des coquilles vides, de pures conventions qui ne persistent que par le fait d’un accord tacite entre les membres d’une société donnée. A la limite, la science elle-même n’est qu’un “discours” dont les concepts ne renvoient à rien d’autre qu’aux conventions adoptées par l’institution scientifique en une aire géographique donnée à un moment historique particulier. […] Une frange du féminisme a plongé avec délice dans ce bouillon de culture. Elle y a trouvé des arguments pour déconstruire l’asymétrie entre hommes et femmes, réfuter l’idée d’un donné biologique contraignant, en le ramenant à une pure construction sociale, fruit d’un processus piloté, bien-sûr, par les hommes dans leur propre intérêt.
[…]
[Nancy Huston :] Vous avez raison, Brice Couturier, de dire [qu’]autant c’est un acquis de dire que tout n’est pas naturel – mais ça personne ne peut le contester, l’humain c’est quelqu’un qui est pris dans une culture –, autant c’est un déni de dire que rien n’est naturel. Et c’est vrai que […] après la deuxième guerre, il y a eu une sorte de crise dans l’histoire de l’anthropologie et une décision constante d’éviter toute référence à une nature humaine, de peur de tomber dans les travers nazis : tout ce qui était le darwinisme social, dire ‘les femmes sont naturellement mères’, ‘les nègres sont naturellement bêtes’, ‘les juifs sont naturellement corrompus’, et ainsi de suite. Et de ce fait, on est tombés dans le travers inverse, qui est le travers stalinien, si on veut, enfin, des pays communistes, qui est la théorie à la Lyssenko, à savoir que tout est absolument construit, […]on peut hériter des traits acquis, et cætera. Et donc on a versé d’un totalitarisme de la pensée dans l’autre, en remplaçant les excès des biologistes nazis par ceux des biologistes marxistes, et on est encore là-dedans, tranquillement. […] Nous sommes dans la dénégation de nos propres sens. […] moyennant quoi nous n’arrivons pas à voir cette réalité sociale [des différences comportementales entre les sexes] parce qu’elle nous est cachée par nos théories.»
[14] Bien que l’étendue des effets de ce mécanisme reste à établir chez l’Homme, on sait que des modifications épigénétiques (modulant l’expression des gènes sans les modifier eux-mêmes) acquises, réversibles, peuvent être transmises d’une génération à l’autre.
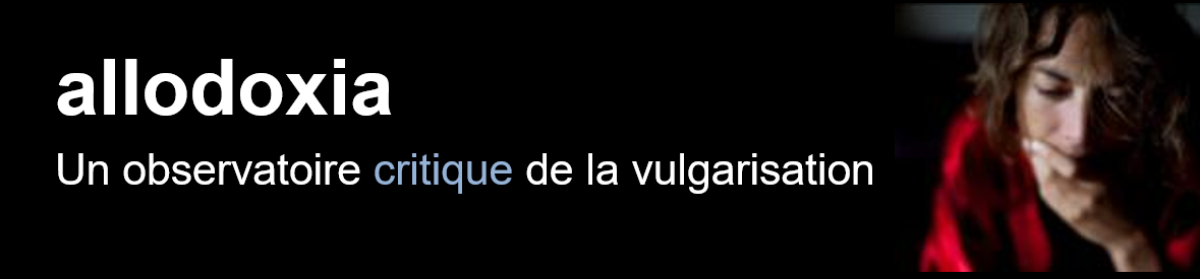
Il serait intéressant de se pencher sur la biochimie des corps. Quoiqu’il en soit la diversité des comportements et des capacités fait la richesse de toute société et c’est l’égalité à l’accès des ressources intellectuelles et matérielles qui est importante non le façonnement d’une humanité “parfaite” et “uniforme”. Il me semble qu’être de gauche c’est accepter la différence de l’autre (sa paresse comme son hyperactivité) et ne léser aucun quant à l’accès aux biens de la société. De plus, obsédé par la rationalisation des comportements nous oublions l’importance des affects et de l’empathie dans la compréhension de l’autre et dans la capacité à nous façonner.
Je suis d’accord avec vous sur l’idée que la diversité des comportements et des capacités fait la richesse de toute société. Raison de plus pour ne pas imposer, plus ou moins subtilement selon les cas, certaines plages de comportements et de capacités aux individus en fonction de la couleur de leur peau ou de leurs chromosomes sexuels. Derrière l’exhortation à accepter la différence de l’autre se cache malheureusement souvent la volonté (que je ne vous prête pas) d’enfermer cet autre dans une différence…
Pour ce qui est de l’égalité d’accès aux ressources intellectuelles, le problème est que des tendances comportementales telles que celles que vous citez (paresse, hyperactivité) peuvent dans certains cas constituer un obstacle au développement des capacités d’accès à ces ressources, et dès lors constituer un handicap dans divers domaines (accès à certains métiers, exercice eclairé des droits accordés à tout citoyen, etc). Que faire dans ces cas-là ?
Quoi qu’il en soit, mon propos n’est pas ici de me prononcer sur ces questions, ni de défendre une vision “de gauche” ou “de droite”, mais seulement de pointer les faux arguments avancés sous couvert de vulgarisation scientifique qui tendent à imposer une vision.
Comment un scientifique sérieux peut-il encore, comme M. Gouyon, se référer à la malheureuse notion de QI? Il s’agit d’une pure construction sociale, aberrante d’un point de vue scientifique. C’est en effet ici l’instrument, le test psychologique, qui produit l’objet qu’il est censé mesurer,” l’intelligence”! Il en est de même d’ailleurs des prétendus sondages d’opinion qui ne font que produire ce qu’ils sont censés mesurer, “l’opinion”!
Je peux comprendre votre rejet de cette notion mais ne le partage pas. Je pense que le WAIS et autres échelles psychométriques utilisées par les chercheurs mesurent (de manière plus ou moins fiable) “quelque chose” qui existe (à un instant t au moins), indépendamment du fait qu’on le mesure ou non. On ne sait pas à quel point ce “quelque chose” rend compte d’une autre chose elle-même difficile à définir (qu’est-ce que l’ “intelligence” ?), mais la recherche scientifique ne peut se passer de ce genre d’outils pour avancer.
En tant que psychologue scolaire, pendant plus de 20 ans j’ai fait passer des centaines de WISC à des enfants de 6 à 13 ans. Je peux vous dire que, tests verbaux
ou non-verbaux, je n’ai jamais fait que “mesurer” la réussite scolaire de ces enfants,
la corrélation étant massive. Le WISC, puisque c’est celui que je connais le mieux, est un pur artefact et la courbe de Gauss qui est censée traduire la répartition de
“l’intelligence” n’est qu’une hypothèse, l’épreuve est conçue de telle façon qu’elle
soit vraie. On retrouve ainsi à l’arrivée ce qu’on a mis au départ.
Quel talent !
Quel étonnant challenge que le votre de corriger les démocratisations erronées visant à éluder certaines données scientifiques au profit d’autres, peut être par mauvaise foi “propagandique” (j’aime les néologismes), probablement par paresse intellectuelle aussi et aussi par manque d’écoute de ceux qui aimeraient “une réponse facile” à une “question facile”, alors qu’il n’existe en sciences que des réponses complexes, mouvantes à ces questions qui semblent faciles.
Merci de vos “précis”, ils vont me permettre d’approfondir des connaissances, et je vais relire cet article (ainsi que d’autres) pour l’intégrer. Ca me change de mes lectures trop faciles, j’ai beaucoup aimé le Roubertoux (l’ouvrage publié chez Odile Jacob), j’apprends, j’apprends, j’apprends….
Bonjour,
Merci pour ce billet fouillé et stimulant sur la question de l’inné et l’acquis. Je me permets de réagir et de souligner les quelques différences de point de vue que j’ai.
D’abord, je voulais souligner la difficulté qu’il y a à utiliser la notion de « variabilité commune ». A partir de quand un caractère cognitif devient « commun » et cesse-t-il d’être rare, c’est-à-dire « pathologique » ? Je crois qu’il est admis que cette frontière est mouvante, fortement influencée par des définitions subjectives. C’est particulièrement criant dans le cas des « pathologies comportementales » traitées par la psychiatrie, référencées dans le fameux DSM, dont chaque nouvelle édition modifie les classifications et étend ou restreint la définition d’une maladie donnée. Sans parler de l’homosexualité qui y figurait comme une pathologie il n’y a pas si longtemps. Bref, je ne suis pas sûr que l’on puisse séparer simplement les comportements pathologiques d’un côté, et les associer le cas échéant à une altération génétique, et les « comportements communs » d’un autre, qui serait un pur produit de notre histoire et de l’environnement.
D’après ce que j’ai pu lire sur le sujet, il semble avéré que des variations génétiques sont associées à des variations de comportements chez les animaux. C’est vrai quand on compare différentes lignées d’animaux domestiques par QTL ou par GWAS. De plus, on peut manipuler chez des animaux de laboratoire l’expression d’un gène ou le niveau d’une hormone, ce qui résulte parfois dans une modification de leur comportement. Bien sur, il me parait toujours intéressant de souligner que les comportements animaux ne sont pas UNIQUEMENT le produit de la génétique et d’un pseudo « programme », mais qu’ils sont aussi influencés par leur histoire et leur environnement. Cela dit, j’ai du mal à imaginer que l’humain soit un animal à part, qui soit dépourvu au moment de sa conception de différence biologique pouvant influencer son comportement futur. Emettre une telle hypothèse me paraitre être une tentative de mettre l’humain à part, de le séparer du reste des animaux.
En ce qui concerne les études chez l’humain, elles me paraissent concorder. Déjà, je crois qu’il est clair que des variations biologiques à la conception sont l’origine de variations phénotypiques (même “communes”) chez l’humain : taille, couleur des yeux, métabolisme, etc. A nouveau, j’ai du mal à imaginer que les comportements échappent à la règle, et que contrairement à d’autres phénotypes, leur variabilité observée soit entièrement due à des différences d’histoire et d’environnement.
Et pour moi, les comparaisons entre vrais jumeaux et faux jumeaux vont dans ce sens, dans le cas du QI par exemple. Attention, je n’ai jamais dit que je pensais que la répartition du génétique et de l’environnemental était mesurable, et encore moins qu’ils contribuaient à parts égales (le fameux 50-50 que vous dénoncez). Pour moi, le calcul de l’héritabilité est une erreur, et le nom est porteur d’une immense ambiguïté, comme j’y reviens à la fin de ce texte. Par contre, dans ces études sur les jumeaux, si l’on émet l’hypothèse qu’aucune variabilité génétique n’est à l’origine de la variabilité des comportements humains, on s’attendrait à ce que les faux et les vrais jumeaux fassent des scores avec une variabilité comparable. Or ce n’a ne semble pas être le cas.
Ceci a été d’ailleurs confirmé par l’étude par GWAS que vous commentiez dans un de vos billets. Statistiquement, plus les génomes sont proches, et plus les scores aux tests sont proches, ce qui indique bien que la variabilité génétique contribue en partie à la variabilité cognitive. Par contre, ce que montre cette étude (et d’autres pour d’autres comportements…), c’est qu’il est extrêmement rare de trouver des variations à l’échelle d’un gène unique qui expliquerait une part importante de la variabilité comportementale observée (à part dans le cas des maladies monogéniques comme celles que vous citez dans votre billet, qui ont souvent un caractère familiale et dont les gènes responsables ont été identifiés pour la plupart bien avant le séquençage du génome et les GWAS…). Ceci colle parfaitement avec un modèle où les capacités cognitives émergent de façon complexe à partir du génétique, du fait des interactions entre les gènes entre eux et entre les gènes et l’environnement. Finalement, si le séquençage du génome n’a servi qu’à une chose, c’est à démontrer que le calcul de « l’héritabilité » négligeait ces interactions qui sont cruciales (la fameuse “missing heritability”!). Et du même coup, le séquençage du génome prouve (1) que le génome n’est pas un « programme » et (2) qu’on ne peut pas le « décrypter » à partir de sa séquence uniquement ! Et du même coup, il montre que la part de déterminisme biologique dans nos comportements n’est pas « héritable », au sens que les gènes se re-mélangeant à chaque génération, créant de nouvelles interactions, et que l’environnement changeant, cela change le déterminisme des gènes et leurs interactions.
C’est pourquoi je pense qu’on ne peut démontrer pas une absence d’influence de variation génétique dans les variations de comportements, mais qu’on peut postuler que cette influence n’est pas strictement héréditaire, n’est pas mesurable, et qu’elle est influencée fortement par l’environnement. A moins que vous n’ayez connaissance d’expériences qui le démontreraient ?
Cordialement
Merci à vous pour ces commentaires constructifs, d’autant plus intéressants que venant d’un chercheur en génétique et biologie du développement.
Je trouve votre remarque sur la notion de variabilité commune phénotypique tout-à-fait pertinente. Mais lorsque j’utilisais “variabilité commune” dans mon billet, c’était pour faire référence à la variabilité génétique et non phénotypique. Cela me semblait implicite dans le contexte où j’ai employé cette terminologie. J’aurais du le préciser systématiquement et veillerai à l’avenir à être plus précise.
Il peut en effet sembler risqué de faire le pari que cette variabilité commune (génétique, donc) n’a aucune part de responsabilité directe (i.e. sans médiation par des phénomènes sociaux) dans la variabilité des traits psycho-comportementaux. Cela dit, le developpement exceptionnel du cortex cérébral fait bel et bien de l’être humain, sur ce plan, un être un peu à part du reste des animaux. Par ailleurs, il est possible d’élaborer un scénario psycho-évolutionniste aboutissant à une telle exception. Mais pour répondre tout de suite à votre dernière question, si maintes expériences démontrent l’effet des intéractions avec l’environnement, aucune ne démontre l’absence d’effet des variations génétiques (de même qu’aucune ne démontre un tel effet).
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce que je cherche à démontrer ou ce dont je cherche à convaincre mes lecteurs. Mon point est que les indices d’un tel effet de la variabilité génétique disponibles à ce jour, qu’il s’agisse des études animales ou humaines, sont largement insuffisants pour affirmer que cet effet est certain, et encore moins qu’il est évident, ou scientifiquement démontré, voire qu’il a été quantifié. De telles affirmations faites au nom de “la science” relèvent de l’imposture et souvent de la propagande idéologique, et doivent à ce titre être dénoncées.
Concernant les études de jumeaux ainsi que l’étude par GWAS commentée dans un autre billet, comme vous le savez elles restent interprétables autrement que par un effet des variations génétiques, puisque dans les échantillons étudiés la proximité génétique peut être corrélée à une proximité environnementale qui n’est pas prise en compte (car essentiellement impossible à capturer). Pour prendre un exemple trivial, il n’est pas difficile d’imaginer que le fait d’avoir des traits physiques généralement perçus comme disgracieux a un effet sur les attitudes d’autrui et l’image de soi, et in fine sur certains aspects de la personnalité. On pourra alors trouver une corrélation avec les gènes, mais qui ne traduira pas un effet biologique de ceux-ci sur le cerveau.
Concernant la contribution génétique à la variabilité du QI en particulier, Roubertoux et Carlier (dont je rappelle qu’ils font partie des leaders français de la génétique comportementale), disent eux-mêmes dans l’article de que je citais que “La mesure de la corrélation ne dit rien sur l’origine génétique du caractère étudié car, dès que l’on s’écarte des populations d’animaux de laboratoire, la proximité génétique est indissociable d’une autre proximité, celle de l’environnement.”. Ils soulignent en outre que les valeurs d’héritabilité génétique du QI qui sont avancées sont “quelque peu surprenantes pour le généticien. On ne connaît pas en effet de trait relevant de l’activité nerveuse, mesuré chez l’animal de laboratoire, dans des conditions de croisement strictes et d’environnement contrôlé, qui atteigne les valeurs obtenues pour le QI”. Ils rappellent enfin que “L’héritabilité est forte lorsque la variabilité génétique est grande. Or on sait que lorsqu’un caractère a une grande valeur adaptative, les allèles correspondants sont rapidement sélectionnés au détriment des formes concurrentes, réduisant du même coup la variabilité génétique et l’héritabilité. Si donc la variabilité d’un caractère est grande, c’est que celui-ci n’a pas subi de forte pression sélective ou que ses valeurs moyennes ont une valeur adaptative. Concernant l’intelligence, il faut choisir : on ne peut pas à la fois affirmer qu’il s’agit d’un trait hautement adaptatif, et lui accorder une héritabilité élevée.”.
Bref, le débat scientifique reste ouvert, même s’il me semble raisonnable de postuler comme vous le faites que l’influence de la variabilité génétique, si d’aventure elle existe, n’est pas strictement héréditaire et est influencée fortement par l’environnement.
Le débat inné/acquis n’est pas près d’être dépassé pour la bonne raison que le développement des sciences aboutit à une hyper-spécialisation et à un éparpillement des savoirs interdisant toute synthèse ou vision globale de ce qu’il est question de comprendre.
En d’autres termes, l’institutionnalisation des savoirs aboutit au découpage de ceux-ci en spécialités toujours plus nombreuses, à l’intérieur desquelles chaque spécialiste travaille sur des questions internes (à sa spécialité) “sans se soucier” de ce qui se passe dans les spécialités connexes.
On en arrive ainsi à la coexistence de recherches sans rapports entre elles bien que traitant des mêmes problèmes ou questions, tout en ayant vocation à être complémentaires, en principe tout au moins.
Les hypothèses et résultats de ces recherches sont donc souvent en opposition voire en contradiction plus ou moins partielle ou totale entre eux, ceci sans que l’on puisse trancher de leur validité “dans l’absolu”, car tout est relatif au cadre dans lequel les travaux en question s’inscrivent.
Ainsi, en prenant les choses au premier degré, l’acquis relève de la psychologie tandis que l’inné relève de la biologie.
C’est pourquoi les savoirs psychologiques explicitant les causes ou plus précisément les facteurs impliqués dans le développement individuel, sont très différents des savoirs biologiques portant sur ces mêmes questions.
Ainsi, qu’on le veuille ou non et qu’on le sache ou non, il y a bel et bien une rupture épistémologique entre ces 2 champs de savoirs même si l’on sait bien que le tout Bio-Psycho-Social, pour reprendre l’expression consacrée, fonctionne de manière intégrée (interactionnelle).
C’est aussi pourquoi les clivages en question n’ont rien d’obsolète paradoxalement, et il suffit pour s’en convaincre de consulter les différents types d’études.
Cela dit si un grand nombre de travaux cherchent actuellement à réduire ces clivages et à intégrer la biologie et la psychologie en particulier, cela ne va pas sans grandes pertes de données et sans dénaturer la psychologie en particulier.
A cet égard, le développement de la neuro-psychologie symbolisant ce mouvement d’intégration, est un courant de pensée réducteur s’intéressant à mettre en lien tout ce qui peut l’être entre ces deux domaines, ce qui a pour effet de rejeter des grands pans de la psychologie dans l’oubli ou l’ignorance.
On devrait d’ailleurs parler des psychologies car il existe plusieurs écoles, la neuro-psychologie ne faisant la part belle qu’à la psychologie cognitivo-comportementale, laquelle est congruente avec la méthode expérimentale.
Ainsi la désaffection dont souffre actuellement la Psychanalyse mais aussi les autres écoles de Psychologie est principalement due au développement exponentiel des dites neurosciences, lequel produit un effet d’étouffement ou de noyage des savoirs psychologiques moins répandus mais pas moins pertinents pour autant.
De même ce développement aboutit à l’imposition hégémonique des critères des sciences expérimentales dans le champ des sciences humaines (dites aussi morales), ce qui ne va pas sans produire de nombreux effets pervers dont la politique omniprésente du chiffre, etc…
Pour finir je renvoie les lecteurs à un article fort intéressant de J.-J. Kupiec, Retour vers le phénotype – Les gènes existent-ils ? http://www.psychologue–paris.fr/textes/les-genes-existent-ils.pdf
cet article apportant un regard différent de ceux auxquels la vulgarisation scientifique nous habitue.
Une juste observation sur les effets de la fragmentation de la recherche et de l’hyperspécialisation. Mais avec une réserve à propos de la méthode expérimentale, trop rapidement assimilée aux sciences “dures”. Comme si les sciences humaines n’étaient pas aussi expérimentales à leur manière! Le problème avait été traité autrefois par Jeanne Parain-Vial dans une recherche qui garde toute sa pertinence, notamment dans son ouvrage “La nature du fait dans les sciences humaines” (PUF,1966). Je voudrais ici lui rendre hommage.
“on sait depuis les travaux de Hubel et Wiesel menés dans les années 1960 que l’interaction avec l’environnement guide le développement des connexions entre neurones au point de complètement façonner la fonction visuelle, une fonction dont on aurait pourtant pu croire que son développement résultait entièrement du déroulement d’un programme génétique.”
Il me semble que vous reproduisez là une interprétation courante mais incorrecte des travaux de Hubel et Wiesel. Ils ont montré que l’environnement influence l’organisation du système visuel dans le sens où, pendant une certaine période de plasticité (qui est d’ailleurs programmée génétiquement), l’absence d’input dans un oeil peut altérer les colonnes de dominance oculaire. Mais ils n’ont absolument pas montré que l’environnement façonne complètement la fonction visuelle. Ils ont en effet aussi montré que les colonnes de dominance oculaire existaient avant même que le bébé chat ouvre les yeux (et reçoive donc le moindre input visuel). L’organisation du cortex visuel est donc bien “pré-spécifiée” génétiquement, mais pas “déterminée” génétiquement puisque le résultat de ces spécifications peut être modifié par des facteurs environnementaux.
Une revue incontournable sur ce sujet:
Katz, L. C., & Crowley, J. C. (2002). Development of cortical circuits: lessons from ocular dominance columns. Nat Rev Neurosci, 3(1), 34-42. http://www.lscp.net/persons/ramus/fr/GDP1/papers/katz02.pdf
et plus généralement sur le guidage génétique du développement cérébral:
Sur, M., & Rubenstein, J. L. R. (2005). Patterning and Plasticity of the Cerebral Cortex. Science, 310(5749), 805-810. http://www.lscp.net/persons/ramus/fr/GDP1/papers/sur05.pdf
Vous dites “L’organisation du cortex visuel est donc bien « pré-spécifiée » génétiquement” comme si j’avais dit qu’il n’y avait aucune “pré-spécification” génétique, or ce n’est pas le cas : je dis que l’interaction avec l’environnement guide ce développement alors qu’on aurait pourtant pu croire qu’il “résultait entièrement du déroulement d’un programme génétique”.
Hubel et Wiesel ont montré que si on maintient fermé l’oeil d’un chaton pendant une certaine période critique, les neurones du cortex visuel primaire qui normalement reçoivent les inputs des deux yeux n’ont que très peu de connexions avec cet oeil qui devient en quelque sorte aveugle, et que ce pattern de connexions et de déficit visuel ne sont pas normalisés par le fait de laisser cet oeil ouvert à l’âge adulte. En ce sens, ils ont bel et bien montré que l’interaction avec l’environnement façonne profondément l’organisation du cortex visuel. Même si un cablage initial est déjà présent à la naissance, cette interaction guide le développement ultérieur de ce cablage de telle sorte qu’il peut être complètement modifié, et ce de manière irréversible.
Ensuite, c’est une question de mot : il semble que “façonner complètement” soit pour vous trop fort, et pour ma part “influence” me semble trop faible. Peut-être aurais-je dû écrire “profondément façonner” plutôt que “complètement façonner”, mais je pourrais de la même façon dire que votre interprétation des travaux de Hubel et Wiesel est incorrecte car la ligne de travaux qu’ils ont initiée montre plus qu’une simple “influence” de l’environnement.
Je note en tout cas que dans l’article de 2005 que vous citez, les auteurs utilisent le verbe façonner (to shape) à plusieurs reprises (ex : “A scaffold of cell-specific connections and hence of area-specific networks may be laid down by molecular recognition and adhesion mechanisms[…]. Superimposed on this framework, activity-dependent mechanisms shape connections between neurons.” + “Activity shapes connections in visual cortex.” + “Thus, similar to ocular dominance columns, orientation selectivity and orientation maps in V1 may be set up by an early, intrinsic scaffold of connections that is later shaped by activity.”).
C’est effectivement une question de mots, mais les mots ont leur importance. On ne peut pas dire que l’environnement façonne complètement la fonction visuelle. Certains facteurs environnementaux (assez radicaux puisqu’il s’agit de perdre un oeil) peuvent, dans certaines circonstances, remodeler en partie la fonction. Ca n’a pas du tout les mêmes implications, surtout quand on parle à un public de non-initiés.
Quant aux citations du mot “shape”, elles ont trait aux connections synaptiques, c’est-à-dire la structure fine du réseau, pas son architecture d’ensemble.
“la plasticité cérébrale, associée dans notre espèce à une longue période de maturation postnatale, nous confère « la propriété d’échapper au déterminisme génétique absolu », car le cerveau se développe et se remanie tout au long de la vie dans une « interaction structurante » avec notre environnement physique et social”
Cette phrase de Jean-Pierre Changeux est un lieu commun puisqu’il n’y a pas de déterminisme génétique absolu, ni chez l’humain, ni chez le chat, ni chez c. elegans. En revanche cette manière de mettre l’être humain en exergue est trompeuse, et elle est souvent citée de manière abusive pour laisser entendre qu’il y aurait une sorte “d’exception humaine”, que la plasticité cérébrale supposée unique à l’espèce humaine lui permettrait d’échapper, plus que toutes les autres espèces (voire totalement pour certains utilisateurs de cette citation), à l’influence des gènes. Or une telle conclusion ne se justifie pas du tout. Et de manière générale toutes les suggestions d’une forme d’exception humaine sont hautement suspectes.
C’est bien en tant que lieu commun que je cite cette phrase, dans le paragraphe introduit par : “Nul besoin de connaissances en génétique, en effet, pour savoir que […] les gènes ne « programment » pas le fonctionnement mental indépendamment de l’influence de l’environnement”.
Il est vrai que cette phrase de Jean-Pierre Changeux est maladroite puisqu’il n’y a pas non plus de déterminisme génétique absolu chez les animaux, mais il faut la remettre dans son contexte (1970). Je suis aussi d’accord sur le fait qu’il serait trompeur de laisser croire que la plasticité cérébrale est unique à l’espèce humaine, ou que cette plasticité permet à l’être humain d’échapper totalement à l’influence des gènes, ou encore qu’il y a une “exception humaine” au sens où le cerveau humain fonctionnerait de manière radicalement différente de celui des autres primates (par exemple). Je n’affirme nulle part de telles choses, et ce n’est pas à l’appui de telles idées que j’ai cité cette phrase.
Cela dit, il y a quand même dans notre espèce une période de maturation postnatale particulièrement longue (c’est ce qu’évoque Changeux) et un néocortex d’un volume inégalé. Ne serait-ce que du fait de ces deux caractéristiques, il n’est pas aberrant de supposer que la cognition et les comportements humains échappent plus que ceux des autres espèces aux déterminismes biologiques génétiques et hormonaux.
La maturation postnatale permet plein d’apprentissages qui sont évidemment fournis par l’environnement, néanmoins il n’y a aucune raison de penser que ces apprentissages seraient libérés de contraintes génétiques. De même que pour le néocortex (même frontal), en quoi son volume important dégagerait comme par magie les neurones qui le composent des contraintes génétiques qui s’imposent à tous les neurones? Et en quoi son architecture serait moins guidée génétiquement que celle de toute autre région cérébrale?
Votre emploi du terme “apprentissages” est réducteur dans ce contexte, eu égard à son acception commune. Pour reprendre l’image du cerveau “bien fait” ou “bien plein”, on a l’impression que dans la vision que vous proposez, les gènes donneraient en quelque sorte le plan de construction du cerveau (i.e. feraient qu’il est plus ou moins bien “fait”) et l’environnement fourniraient le nécessaire pour remplir les cases ainsi pré-définies (i.e. feraient qu’il est plus ou moins bien “rempli”). Changeux parle d’ “interaction structurante”, ce qui me semble bien mieux rendre compte de la réalité du façonnage des connexions cérébrales par l’activité cérébrale elle-même. On retombe sur cette question de vocabulaire qui n’est décidément pas neutre.
Encore une fois, je ne dis pas que ce processus de façonnage est libre de contraintes génétiques : bien-sûr que le fonctionnement des neurones (et la plasticité cérébrale elle-même) sont sous contrôle génétique. Je dis seulement – reprenant ici l’argument de Changeux – qu’une phase longue pendant laquelle le cerveau est très plastique donne a priori plus de prise aux interactions avec l’environnement, plus de poids à leurs effets que chez les individus d’une espèce dans laquelle le processus de maturation est très court.
Quant au néocortex, je ne dis évidemment pas non plus que du fait de son volume, les neurones qui le composent sont dégagés des contraintes génétiques qui s’imposent à tous les neurones ! Une fois de plus vous reformulez indûment mon argument pour le ridiculiser : ça s’appelle la technique de l’homme de paille, et ça ne fait pas avancer le débat. J’écris que du fait de cette caractéristique, “il n’est pas aberrant de supposer que la cognition et les comportements humains échappent plus que ceux des autres espèces aux déterminismes biologiques génétiques et hormonaux”. Au vu de votre commentaire, je comprends que vous ne partagez pas cette idée qui me paraît pourtant assez consensuelle. Dont acte : pour vous c’est aberrant, donc.
Enfin sur le fond de la question votre argumentation n’est pas du tout convaincante. Il ne suffit pas d’évoquer les corrélations gènes-environnement et les interactions gènes-environnement (qui sont bien réelles) pour conclure qu’il n’y a aucune influence génétique sur les traits psychologiques.
Les influences génétiques sur les traits psychologiques sont établies par de multiples études convergentes sur les jumeaux, les familles, les enfants adoptés, les études génomiques de type GCTA, et les associations de gènes à certains traits cognitifs. Je vous renvoie à plusieurs de mes articles sur le sujet:
http://franck-ramus.blogspot.fr/2013/12/au-dela-de-linne-et-de-lacquis.html
et les articles cités en bibliographie.
Où lisez-vous que je conclus qu’il n’y a aucune influence génétique sur les traits psychologiques ? Je critique ici l’idée qu’il serait “évident” ou “maintenant démontré” que la variabilité commune de tout trait psychologique est en partie causée par la variabilité génétique commune et que le “débat inné/acquis” serait par conséquent dépassé. Et ce que je conclus, c’est que la réponse scientifique définitive à cette question n’est pas apportée par les études mettant en évidence un effet statistique de la variabilité génétique sur celle de tel ou tel trait, et qu’elle n’est en aucun cas globale : elle varie selon le trait considéré, le nivau de confiance dans cette hypothèse permis par la littérature scientifique existante étant à évaluer au cas par cas.
Comme je l’ai écrit à propos du QI, les estimations d’héritabilité génétique calculées sur la base d’études familiales, d’études de jumeaux et d’études d’adoption, et plus récemment sur la base d’études moléculaires (études de liaison ou études d’association pangénomiques) ne font qu’estimer un effet statistique de la variabilité génétique sur celle du trait mesuré, ce qui ne permet pas d’inférer qu’il existe une chaîne de causalité biologique entre les variantes génétiques concernées et la genèse du substrat biologique qui serait responsable de la variabilité de ce trait. En affirmant que les “influences génétiques sur les traits psychologiques sont établies” par les études de ce type vous ne faites qu’affirmer votre croyance dans le fait que ces associations statistiques sont le signe de l’existence d’une telle chaîne de causalité, mais il faut regarder la réalité en face : elles n’en établissent pas l’existence.
Les études familiales ne peuvent au mieux que mettre en évidence une héritabilité au sens large, et non une héritabilité génétique.
Les études de jumeaux souffrent de graves défauts (cf par exemple http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2013/12/19/alzheimer-facteurs-de-risque/#note21), et les études d’adoption également.
Quant aux études génomiques de type GCTA, dans votre article publié hier vous écrivez qu’elles “ont en grande partie confirmé les estimations antérieures d’héritabilité, bien que basées sur des hypothèses et des méthodes totalement différentes”, citant notamment Davies et al. 2011. Or cette étude comme les autres de ce type sont certes basées sur des méthodes différentes mais reposent sur les mêmes hypothèses et souffrent en partie des mêmes défauts : cf http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2012/02/16/intelligence-et-genetique/ sur Davies et al. 2011 justement.
Revenons aux propos de P-H. Gouyon que je cite ici : “évidemment, hein, ce qui compte, c’est de comprendre qu’il y a toujours de l’environnement et des gènes qui jouent, dans quasiment tous les caractères” et “Il y a d’autres trucs qui sont absolument pas sensibles aux gènes, par exemple l’accent anglais : les gens qui parlent bien anglais au niveau mondial, c’est pas compliqué, ils sont nés en Angleterre. Leurs gènes n’ont rien à voir.”.
La question qu’on peut se poser, c’est pourquoi dit-il “quasiment”, et comment peut-il affirmer qu’avoir un bon accent anglais n’a rien à voir avec les gènes ? Par construction, les études génomiques de type GCTA montreraient très probablement que l’héritabilité génétique du bon accent anglais est non négligeable.
Vous évoquez les “multiples études convergentes sur les jumeaux, les familles, les enfants adoptés, les études génomiques de type GCTA, et les associations de gènes à certains traits cognitifs”, or elles ne sont pas convergentes, justement. Par exemple, Plomin et al. (1998) constatent que bien que les études de jumeaux ont estimé de manière récurrente que l’héritabilité des traits de la personalité était autour de 40 %, dans cette étude d’adoption la plus solide jamais réalisée ils trouvent une héritabilité estimée de 14%, et encore :
– c’est après avoir tripoté leurs données notamment en “prenant en compte” la ressemblance entre conjoints et la ressemblance entre parents biologiques et adoptifs;
– ce 14% correspond au score moyen sur les 4 traits de la personalité mesurés; ils ont dans le détail calculé les estimations d’héritabilité génétique suivantes : émotivité = 0 %; impulsivité = 7 %; activité = 20 % mais non statistiquement significatif; sociabilité = 27 %.
– leurs données brutes sont édifiantes, puisqu’ils trouvent que la corrélation moyenne entre le score global à leur mesure des traits de la personnalité entre les enfants adoptés et leur parents biologiques est de 0.01 seulement (p. 212); ils n’obtiennent péniblement que 0.03 en faisant d’abord la moyenne de ce score au cours des années chez les enfants et en calculant ensuite la corrélation entre cette moyenne et le score de leurs parents (p. 213).
Comme l’écrit Joseph (2012), on pourrait conclure de cette étude que les facteurs génétiques n’ont aucun rôle dans la formation de la personnalité, mais bizarrement les résultats de cette étude menée par des chercheurs qui sont parmis les leaders mondiaux de la recherche en génétique comportementale (que vous citez abondamment) sont rarement cités.
Vous évoquez également ici “les associations de gènes à certains traits cognitifs” et dans votre article d’hier vous écrivez “Des succès notables ont été obtenus dans l’étude des bases génétiques de fonctions cognitives comme l’attention, la mémoire ou le traitement des émotions, et de troubles comme l’autisme ou la dyslexie.”
Pouvez-vous citez, au hasard, ne serait-ce qu’une seule variante génétique commune dont il a été démontré qu’elle était la cause d’une variabilité dans le traitement des émotions ?
Pour mémoire, je rappelle que vous aviez écrit que l’hypothèse selon laquelle l’allèle court du gène du transporteur de la sérotonine induit une susceptibilité accrue à la dépression face à des événements stressants était « amplement confirmée », hypothèse que j’ai critiquée dans http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2012/03/19/serotonine-races-et-civilisations/ et dont vous avez admis dans http://allodoxia.odilefillod.fr/2013/06/27/boris-cyrulnik-stop-ou-encore-partie2/#comment-1588 qu’effectivement, elle n’était “pas bien répliquée” et que vous vous absteniez désormais d’en faire état.
Références citées :
– Joseph, 2012, The ‘‘Missing Heritability’’ of Psychiatric Disorders: Elusive Genes or Non-Existent Genes?, Applied Developmental Science, vol.16(2), p.65-83;
– Plomin, Corley, Caspi, … et DeFries, 1998, Adoption results for self-reported personality: Evidence for nonadditive genetic effects? Journal of Personality and Social Psychology, vol.75(1), p. 211–218
Toutes ces études partagent la même démarche, qui est de tester des associations statistiques entre variations génétiques et variations phénotypiques. Au-delà leurs hypothèses et leurs méthodes diffèrent.
Aucune étude ne peut établir à elle seule un lien de causalité, mais quand on considère l’ensemble de la littérature scientifique, comprenant toutes les études de toutes disciplines et de toutes méthodes, la génétique formelle, la génétique moléculaire, la neurogénétique, les modèles animaux, etc., la seule conclusion qui permet d’expliquer l’ensemble des données, c’est que tous les traits psychologiques humains sont influencés génétiquement. Mais encore faut-il avoir la vision d’ensemble sur tout ce pan de la connaissance scientifique pour s’en rendre compte. Car si l’on examine la littérature scientifique avec des oeillières, on peut toujours critiquer chaque étude morceau par morceau (parfois à raison, parfois à tort), et rester aveugle aux convergences.
Donc il ne suffit pas de dire “telle étude ne montre qu’une corrélation et ne prouve pas que”, il faut prendre en compte l’ensemble des données, et formuler une interprétation alternative qui expliquerait aussi bien l’ensemble des résultats. Mais aucun critique des études au cas par cas n’a jamais fait cela, la démarche est toujours “je critique tel aspect de telle étude”, “je généralise à toutes les études du même type”, et “je balaye tout le reste d’un revers de main”.
A) “la seule conclusion qui permet d’expliquer l’ensemble des données, c’est que tous les traits psychologiques humains sont influencés génétiquement”
Vous reformulez encore une fois les choses d’une manière qui réintroduit la confusion que je me suis efforcée de dissiper. Je ne conteste pas l’idée que les traits psychologiques humains sont influencés génétiquement, mais dire cela ne permet pas de conclure que la réponse à ma question Q1bis est ‘oui’ pour n’importe quel trait psychologique humain, ni a fortiori qu’elle est ‘oui, de manière notable’ par comparaison aux causes non génétiques de variabilité.
B) “si l’on examine la littérature scientifique avec des oeillières, on peut toujours critiquer chaque étude […] et rester aveugle aux convergences”
Permettez-moi de vous retourner la critique : si l’on examine la littérature scientifique avec des oeillières, on peut toujours mettre en avant certaines études ou morceaux d’études en étant aveugle aux divergences. Par exemple, dans l’étude de Plomin et al. citée plus haut, les auteurs aboutissent à une estimation d’héritabilité d’un score de traits de la personalité égale à 14 % alors qu’elle est typiquement de 40 % selon les études de jumeaux (Plomin manifeste ici sa préférence pour l’hypothèse que les études de jumeaux surestiment l’héritabilité et non que cette étude en particulier et les études d’adoption en général la sous-estiment). Pire, ils trouvent ici que l’héritabilité génétique de l’émotivité est égale à 0 %. N’est-ce pas pourtant un trait psychologique humain, en outre un trait qui relève typiquement de la notion de tempérament chère aux penseurs de l’existence de “natures” psychologiques distinctes pour des raisons génétiques ?
Les divergences existant dans cette littérature sont innombrables, entre échecs de réplication d’études d’associations, différences entre modèles animaux et échecs à mettre au jour chez l’être humain les mécanismes observés sur tel ou tel modèle animal, échecs à trouver que les variantes communes des gènes dont une mutation rare est connue pour causer un trouble sur tel trait sont statistiquement associées aux variations dudit trait, etc.
Par ailleurs, il y a sinon la divergence mais la fondamentale absence de convergence, si l’on peut dire, que constitue le problème dit “de l’héritabilité manquante”, i.e. l’écart entre l’héritabilité estimée non négligeable d’à peu près n’importe quel trait humain et l’extrême pauvreté des résultats de la recherche ayant tenté d’identifier les variantes génétiques rendant compte de cette héritabilité, et ensuite la pauvreté plus grande encore des résultats de la recherche ayant tenté de mettre au jour les chaînes de causalité biologiques correspondantes. Comme le souligne Turkheimer (2011), les résultats de génétique quantitative n’ont pas permis à la génétique moléculaire de mettre en évidence les mécanismes biologiques reliant les variantes génétiques aux variations de traits psychologiques, et le fait que tout et n’importe quoi se révèle héritable “a rendu problématique la différenciation entre les phénotypes héritables qui ont des mécanismes génétiques et ceux qui n’en ont pas.” Même un chercheur qui souscrit pleinement au paradigme des études de jumeaux estime donc comme moi qu’il existe des phénotypes dont une certaine héritabilité “génétique” a été estimée mais qui ne reposent pas pour autant sur des mécanismes génétiques.
Turkheimer prend l’exemple du divorce : les études de jumeaux ont estimé que l’héritabilité génétique du divorce était de l’ordre de 40 %, mais personne ne s’attend pour autant à ce que soit mise au jour une “étiologie génétique” du divorce, et il semble très peu probable qu’on découvre des “gènes du divorce” qui auraient une influence sur le développement de “circuits cérébraux du divorce”.
Pour prendre un exemple plus pertinent, dans la note 21 de mon article sur Alzheimer à laquelle j’ai déjà renvoyé, je note que Stanislas Dehaene considère qu’il n’existe pas de prédispositions génétiques à avoir un “talent mathématique” bien que les études de jumeaux aient conclu que ledit talent était héritable génétiquement.
Pour ma part, je considère de même que ce n’est pas parce que les études de jumeaux ou autres ont estimé que l’héritabilité génétique du QI était de l’ordre de X % qu’il existe nécessairement des gènes impliqués dans l’ontogénèse de l’ “intelligence” dont la variabilité causerait X % de la variabilité des circuits cérébraux sous-tendant celle du QI, et je dirais la même chose de n’importe quel trait cognitif ou comportemental jusqu’à preuve du contraire.
Comme Turkheimer le souligne, les études de type GCTA ne résolvent pas ce problème : elles identifient un ensemble de marqueurs génétiques dont la variabilité rend compte (au sens statistique) d’un certain pourcentage de la variabilité du trait considéré, mais elles n’identifient pas pour autant les causes génétiques de cette dernière. Sur ce type d’études, voir mes remarques plus précises sur l’exemple de Davies et al. (2011) dans ma réponse à votre commentaire du 29/12 à 13h.
C) “il faut prendre en compte l’ensemble des données, et formuler une interprétation alternative qui expliquerait aussi bien l’ensemble des résultats”
Je pense que vous ne contesterez pas l’existence de nombreuses preuves que de multiples facteurs non génétiques ont une influence sur le cerveau, les performances cognitives et les tendances comportementales, qui sont du reste sans équivalent du côté de l’explication génétique. Exemple : il est établi qu’un entraînement ciblé permet d’améliorer notablement les capacités spatiales, et a contrario aucune prédisposition génétique à développer un substrat cérébral permetant d’avoir des capacités spatiales particulièrement élevées n’a pu être identifiée à ce jour.
La question est de savoir d’une part dans quelle mesure ces facteurs non génétiques expliquent la variabilité des traits psychologiques, et d’autre part dans quelle mesure ces facteurs sont corrélés avec le génotype (et ainsi quelle part de l’héritabilité génétique calculée par les études GCTA ou autres ne renvoie en fait pas à des mécanismes génétiques sous-jacents).
Le problème est qu’on ne dispose pas d’une liste de “variantes non génétiques” équivalente à celle des variantes génétiques dont l’association avec la variabilité des phénotypes pourrait être testée, et que cette liste est impossible à établir : il faudrait observer tous les paramètres biologiques, chimiques, mécaniques, thermiques de l’environnement du foetus durant toute la gestation, toutes les variations de stimuli reçus durant la gestation et dans la petite enfance, les infections bactériennes, accès de fièvre, l’alimentation, les rythmes de veille/sommeil imposés, etc, et ce jusqu’à l’âge auquel on teste le trait considéré.
Une infinité de scénarios peuvent être imaginés qui permettent de formuler des interprétations alternatives à l’interprétation génétique. Reprenons l’étude de Plomin et al déjà citée pour évoquer l’un de ces scénarios. Comme on l’a vu, les auteurs trouvent une héritabilité génétique de l’émotivité égale à 0 % mais non négligeable (27 %) de la sociabilité . Il me paraît pour le moins malaisé d’expliquer cette différence sous l’hypothèse que la variabilité de tout trait psychologique humain est en partie d’origine génétique. En revanche, si on fait l’hypothèse qu’une partie de l’héritabilité génétique capturée par ce type d’études est due à une corrélation entre des caractéristiques physiques sous influence génétique qui ont un effet sur le vécu et que c’est ce vécu qui façonne en partie le trait considéré, ça marche mieux. Ainsi, de même que Stanislas Dehaene évoque le scénario des variantes génétiques tendant à conférer une grande taille qui pourraient causer de mauvaises performances en maths simplement parce que les personnes concernées auraient tendance à se consacrer au basket plutôt qu’à leur études, on peut imaginer que des traits relatifs à l’apparence physique qui sont sous influence génétique produisent des effets sur les modalités d’interaction avec autrui, d’où une certaine héritabilité de la sociabilité mais pas de l’émotivité qui dépend probablement peu ou pas de l’apparence physique. Vous me direz peut-être que ce scénario est hypothétique, mais il ne l’est pas plus que le scénario “génétique” censé expliquer le résultat de cette étude.
D) “Toutes ces études partagent la même démarche, qui est de tester des associations statistiques entre variations génétiques et variations phénotypiques. Au-delà leurs hypothèses et leurs méthodes diffèrent.”
Au-delà des différences de méthodes qui effectivement impliquent des hypothèses ad hoc spécifiques aux études de jumeaux d’un côté et aux études d’adoption de l’autre, ces études partagent les deux hypothèses fondamentales suivantes :
– il est pertinent de calculer l’héritabilité génétique des traits psychologiques humains sur des sous-ensembles de population caractérisés par un certain degré (indéfini) de proximité génétique et/ou “environnementale”,
– l’héritabilité génétique non nulle ainsi calculée est le signe qu’il existe des mécanismes génétiques causant une partie de la variabilité des traits considérés.
Ref citées :
– Eric Turkheimer (2011): Still Missing, Research in Human Development, 8:3-4, 227-241
– Plomin, Corley, Caspi, … et DeFries, 1998, Adoption results for self-reported personality: Evidence for nonadditive genetic effects? Journal of Personality and Social Psychology, vol.75(1), p. 211–218
Pour revenir aux hypothèses, l’hypothèse des études de jumeaux qui est la plus critiquée (et qui a suffit à la plupart des détracteurs à rejeter en bloc les résultats de toutes les études de jumeaux, bien qu’aucune mesure au sein des familles n’ait permis de la réfuter) est l’hypothèse des environnements également similaires entre jumeaux MZ et DZ. Or cette hypothèse n’est partagée ni par les études d’adoption ni par les GCTA.
L’hypothèse des environnements également similaires n’est pas partagée par les études d’adoption… qui justement n’aboutissent pas toujours à des héritabilités aussi élevées que les études de jumeaux. Cf Plomin et al. déjà cité, où les auteurs écrivent eux-mêmes que “les facteurs méthodologiques majeurs qui pourraient faire que les estimations d’héritabilité par les études de jumeaux sont trop élevées impliquent diverses violations de l’hypothèse des environnements également similaires”, même s’ils jugent pour leur part que “les tests de cette hypothèse étayent généralement le caractère raisonnable de cette hypothèse” et préfèrent mettre en avant une autre hypothèse explicative de cet écart (p.215-216). En fait, l’explication qu’ils privilégient revient à dire que ça n’est pas la même notion d’héritabilité génétique qui est mesurée par ces deux types d’études, ce qui complexifie un peu les choses.
Quant aux études de type GCTA, il est trop tôt pour savoir si elles confirmeront de manière générale que les estimations d’héritabilité faites à l’aide d’études de jumeaux sont “les bonnes”, pour autant qu’on puisse dire que l’héritabilité génétique qu’elles mesurent est celle qui est pertinente (cf ci-dessus).
Par ailleurs, votre affirmation qu’aucune mesure au sein des familles n’a permis de réfuter l’hypothèse des environnements également similaires est fallacieuse à deux titres.
D’une part elle laisse croire que les études de jumeaux ont incorporé de véritable test de cette hypothèse alors que ça n’a jamais été le cas et que ça ne pourrait l’être. Pour prendre l’exemple simple des membranes/placenta partagés par une certaine proportion de paires de MZ mais d’aucune paire de DZ, aucune étude de jumeaux n’a jamais vérifié (et ne pourrait le faire) que l’ensemble des paramètres biologiques (mais non génétiques) susceptibles d’affecter le développement de ces foetus durant toute la gestation n’avaient pas été plus similaires entre MZ qu’entre DZ. Lorsque des tests de cette hypothèse sont incorporés, ils sont extrêmement rudimentaires et imparfaits. Par exemple, “vérifier” que les parents ou les pairs ne traitent pas plus similairement leurs enfants MZ que ne le font les parents ou pairs de DZ simplement en leur posant la question repose sur du déclaratif par nature peu fiable et n’adresse que la part des comportements conscients.
D’autre part elle laisse croire que seuls les détracteurs des études de jumeaux qui les rejètent “en bloc” jugent que l’hypothèse des environnements également similaires n’est pas valide, or nombre de chercheurs de ce champ reconnaissant que les MZ font l’expérience d’environnements plus similaires que ne le font les DZ (cf Bouchard & McGue, Faraone, Flint, Rutter, Smith, etc cités par Joseph, 2012 p.70), ce qu’ils sont bien obligés de faire puisque ça a été mis en évidence par diverses études : la majorité des MZ (et aucun des DZ) partagent le même placenta ou les mêmes membranes in utero, on a tendance à les traiter de manière plus similaire du fait de leur ressemblance physique, ils développent des liens plus intimes, partagent davantage d’activités et s’identifient plus l’un à l’autre que les DZ (cf par ex. Horwitz et al.2003). Simplement, ces chercheurs bottent en touche soit en disant que c’est à leur détracteurs de prouver au cas par cas que c’est ça qui explique la variabilité apparemment génétique du trait qu’ils ont mesurée (ce qui est impossible), soit en disant que c’est la plus grande proximité génétique des MZ qui crèe leur plus grande proximité environnementale du fait de leurs comportements plus similaires (ce qui est une pétition de principe et n’adresse qu’une part de la proximité environnementale citée ci-dessus).
Réf citée :
– Joseph, 2012, The ‘‘Missing Heritability’’ of Psychiatric Disorders: Elusive Genes or Non-Existent Genes?, Applied Developmental Science, vol.16(2), p.65-83
– Horwitz et al, 2003, Rethinking twins and environments: possible social sources for assumed genetic influences in twin research, Journal of Health and Social Behavior, vol.44(2), p. 111-129
Votre manière de rejeter les résultats des études GCTA en faisant des raisonnements par l’absurde sur la base d’exemples de corrélations gènes-environnement n’est vraiment pas correcte.
L’exemple de Gouyon sur l’accent anglais est vraiment très mauvais. Si les études de génétique se faisaient au niveau mondial, on mélangerait tout: variabilité ethnique, variabilité ethnique, variabilité culturelle, variabilité linguistique, et donc évidemment on ne saurait pas à quoi attribuer la variabilité phénotypique. Mais personne ne fait ça. Chaque étude se fait dans un pays donné, dans une langue donnée, et autant que possible sur une population d’une ethnie donnée. Sur ce dernier point, la plupart des études excluent les participants des ethnies minoritaires. En plus de cela, les études GCTA ont les moyens de modéliser la variabilité génétique “ethnique” (population stratification), et de l’inclure dans le modèle statistique (si vous regardez l’article de Davies et al. 2011, ce sont les 4 composantes mentionnées comme covariables).
Par conséquent, la variabilité génétique qui est corrélée à la variabilité du phénotype dans les études GCTA n’est pas confondue avec de la variabilité ethnique, ni avec de la variabilité entre quelques groupes humains que ce soit, y compris éventuellement sociaux. Notez que cela joue contre les auteurs, en contribuant à potentiellement minorer l’estimation de l’héritabilité du phénotype, en négligeant l’impact de variants génétiques qui à la fois diffèreraient entre certains groupes et qui joueraient un rôle causal sur le phénotype (si de tels variants existent).
Pour résumer, l’exemple de Gouyon sur l’accent anglais, tout comme vos exemples sur les yeux bridés et les baguettes ou les populations immigrées en France (http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2012/02/16/intelligence-et-genetique/#note10) sont sans pertinence pour critiquer les études GCTA.
Les exemples de l’accent anglais et autres sont des illustrations simples destinées à faire comprendre le défaut de principe de ces études. Le fait de limiter les études GCTA à une “ethnie” donnée (au sens culturel du terme) ne supprime pas ce défaut de principe : à l’intérieur d’une “ethnie” donnée il existe des “cultures familales” diverses et une infinité de différences qui peuvent être corrélées avec les gènes (cf plus haut l’exemple donné par Dehaene pour les maths).
De plus, les groupes “ethniques” considérés dans ces études sont définis en termes de de proximité biologique et non culturelle. Lorsque ces chercheurs disent qu’ils retiennent uniquement des individus “sans ascendance non caucasienne”, ça définit un groupe d’individus partageant une relative proximité génétique mais qui peut contenir une grande variabilité culturelle qui n’a pas de raison a priori de n’avoir aucune corrélation avec la variabilité génétique.
De manière générale, les simulacres de prise en compte de composantes “environnementales” y compris et au-delà de la notion de “culture” sont bien dérisoires : comme vu plus haut, les notions grossières telles que l’appartenance à une classe économique et sociale sont très, très loin d’épuiser l’éventail de ces composantes qui sont infiniment plus subtiles, et rien ne permet de supposer a priori que ces composantes n’ont aucune corrélation avec le génotype dans les sous-ensembles de population considérés dans ces études. Prenons un autre exemple basé sur deux hypothèses qui à ma connaissance n’ont rien de fantaisistes : s’il existe des terrains génétiques plus propices que d’autres à certaines infections virales ou bactériennnes et si certaines infections sont susceptibles d’avoir un impact sur le développement du cerveau soit directement, soit indirectement (par exemple via un accès de fievre provoqué dans une phase critique du développement postnatal), alors on pourra trouver une corrélation entre génotype et phénotype dont le facteur causal véritable sera l’infection, et non l’effet biologique sur le cerveau des gènes concernés.
L’étude de Davies (2011) que vous citez, sur l’héritabilité de l’ “intelligence cristallisée” (gc) et de l’ ‘intelligence fluide” (gf), souffre de ce défaut de principe et de divers autres :
– Cette étude menée sur la réunion de cohortes de personnes âgées suivies dans le cadre d’études du vieillissement cognitif (3 cohortes d’Ecossais d’âges moyens allant de 65 à 79 ans et 2 cohortes d’habitants du nord de l’Angleterre d’âge médian de 65 ans), toutes “sans indice d’ascendance non-caucasienne”, ne permet pas d’établir une conclusion sur les “caucasiens” en général (pour autant que cette notion ait une quelconque pertinence) ni même sur les “caucasiens britanniques”, ni a fortiori sur l’espèce humaine en général.
– Les auteurs ont retenu pour leur analyse 549 692 des SNPs trouvés dans leur échantillon (aucun de ces SNP n’était associé de manière statistiquement significative à gc ou à gf, et seul le gène FNBP1L était significativement associé à gf mais cette association n’a pas été retrouvée dans l’échantillon de réplication.) C’est la variabilité de l’ensemble de des SNPs considérés simultanément qui leur permet de “rendre compte” (statistiquement) de 40 % et 51 % de la variabilité de gc et gf respectivement. J’imagine que vous ne supposez pas que ces 549 692 SNPs répartis sur l’ensembles des autosomes au moins (cf infra) interviennent de manière causale dans le façonnage du substrat cérébral de l’ “intelligence”. Je note en tout cas que les auteurs supposent quant à eux que ces SNPs sont simplement statistiquement associés aux véritables facteurs causaux, dont cette étude ne dit rien et dont rien n’empêche qu’ils soient non génétiques pour une part indéterminée d’entre eux.
– Après avoir dit qu’ils avaient retenu pour leur analyse 549 692 SNPs, ils indiquent en 4ème page que ces SNP sont situés sur les autosomes, mais bizarrement on voit les chromosomes X et Y dans la figure 1 qui disparaissent de la figure 2 : si vous avez une explication, je suis preneuse. Dans l’hypothèse où le chromosome X ne serait pas pris en compte, ça tendrait à contredire votre idée du nécessaire “large recouvrement” entre gènes impliqués dans la construction du substrat biologique de l’intelligence et gènes impliqués dans la variabilité de ce substrat, à moins de supposer que l’heritabilité génétique de g soit en fait bien plus élevée que le 50 % habituellement avancé (d’autant que comme les auteurs le soulignent, puisqu’il existe beaucoup d’autres variantes génétiques que les SNP, ce résultat n’est pas une estimation de l’héritabilité génétique de l'”intelligence” mais une estimation de sa borne inférieure).
– Ils ont tenté de répliquer sur un échantillon indépendant l’association avec FNBP1L et ils ont utilisé cet échantillon pour faire un test de prédiction, mais bizarrement ils ne disent pas s’ils ont répliqué leur estimation de l’héritabilité sur cet échantillon. Il aurait pourtant été intéressant de savoir si on retrouvait dans cet échantillon des valeurs proches de 40 et 51 %, sachant qu’il ne s’agissait cette fois pas de personnes âgées.
– En appliquant à un échantillon indépendant leur modèle satistique rendant compte de 41 et 51% de gf et de gc sur l’échantillon initial, les auteurs n’ont réussi à prédire que moins de 1 % de la variance de gf et de gc, et ce malgré la proximité génétique des individus de cet échantillon soulignée par eux. Outre qu’elle ne dit rien des véritables facteurs causaux de la variabilité de l’intelligence, cette étude ne permet donc pas non plus d’établir la moindre prédiction. Les auteurs expliquent le paradoxe de la grande valeur “explicative” de leur modèle statistique combinée à une valeur prédictive quasi-nulle par le fait que leur estimation de la taille de l’effet de chaque SNP était entachée d’une grande marge d’erreur (car l’échantillon initial était trop petit). Une explication alternative est que leur modèle prend en compte tellement de paramètres qu’on arrive à le faire relativement bien coller aux observations mais qu’il n’a aucune pertinence, i.e. qu’on trouverait autant de modèles différents que d’échantillons considérés. L’avenir nous dira quelle était la bonne explication.
Voici un gène, ADRA2B, qui influence à la fois l’impact des émotions sur la mémoire épisodique, et la susceptibilité au syndrome de stress post-traumatique:
de Quervain, D. J., Kolassa, I. T., Ertl, V., Onyut, P. L., Neuner, F., Elbert, T., & Papassotiropoulos, A. (2007). A deletion variant of the alpha2b-adrenoceptor is related to emotional memory in Europeans and Africans. Nat Neurosci, 10(9), 1137-1139.
J’ajoute que les hypothétiques corrélations gènes-environnement que vous mentionnez n’affectent pas non plus les estimations d’héritabilité dans les études de jumeaux. En effet, que l’on considère le SES, l’ethnie, ou tout autre chose qui diffère entre les familles, ces facteurs ne diffèrent pas entre jumeaux MZ et jumeaux DZ, et par conséquent ne sont pas confondus avec les différences génétiques qui servent à l’estimation de l’héritabilité.
Les exemple de corrélations gènes-environnement que je cite plus haut (ex : gènes/croissance, gènes/susceptibilité à diverses infections, gènes/apparence physique), qui ne sont pas hypothétiques, sont bien évidemment susceptibles d’affecter les estimations d’héritabilité dans les études de jumeaux. C’est encore une fois parce que vous n’envisagez que des facteurs environnementaux grossiers tels que SES ou “ethnie” que vous ne voyez pas que des corrélations gènes-environnement peuvent interférer dans ces études.
“la confusion classique entre la question de la genèse d’une caractéristique chez un individu d’une part, et celle de l’origine des différences entre individus dans cette caractéristique d’autre part”
“Or dire que le patrimoine génétique d’un individu est un facteur déterminant dans la genèse de ses dispositions psychiques ne permet nullement de conclure que la variabilité des dispositions psychiques entre individus de patrimoines génétiques normaux est en partie déterminée par la variabilité de ceux-ci.”
La deuxième phrase est littéralement correcte, mais vous abusez en disant qu’il s’agit d’une confusion classique. Il y a tout de même nécessairement un large recouvrement entre les gènes qui participent à l’intelligence humaine et ceux qui participent aux différences individuelles. Tout gène du premier ensemble qui admet des variations significatives au sein de l’espèce va typiquement engendrer des variations dans le phénotype (et donc faire partie du deuxième ensemble). Evidemment, l’association entre variation génétique et variation phénotypique ne peut pas simplement se supposer, elle doit se prouver (et c’est pour ça que votre phrase reste correcte). Mais on ne peut tout de même pas insinuer qu’il y a indépendance totale entre les deux ensembles de gènes, ni que le second est vide, ce qui reviendrait à supposer qu’aucun des milliers de gènes faisant partie du premier ensemble n’admet de variations, ce qui est clairement faux. Ce qui nous amène à la citation suivante de Roubertoux et Carlier.
“Il y a tout de même nécessairement un large recouvrement entre les gènes qui participent à l’intelligence humaine et ceux qui participent aux différences individuelles”
=> Si on part du principe que des variantes génétiques “participent aux différences individuelles” par des mécanismes biologiques, alors il est effectivement assez probable que ces variantes concernent des gènes qui participent à la genèse des dispositions psychiques humaines. Mais votre “nécessairement” n’est pas justifié a priori pour tout type de variabilité génétique et tout type de différences individuelles. C’est ce que je montre dans ce texte et ce qu’exprime la phrase que vous jugez correcte.
“Tout gène du premier ensemble qui admet des variations significatives au sein de l’espèce va typiquement engendrer des variations dans le phénotype (et donc faire partie du deuxième ensemble).”
=> Il s’agit encore une fois d’une pétition de principe qui n’est pas vraie a priori pour tout type de variation génétique et de variation phénotypique. Dans mon texte je m’efforce de distinguer la question Q1bis des autres questions pour cerner précisément ce dont on parle. Vos deux phrases ci-dessus reformulent le problème de manière générale et réinstallent ainsi une confusion qui empêche de sérier les questions. On peut trouver une multitude de contre-exemples à votre seconde phrase si on distingue bien la question de la variabilité commune de celle des anomalies génétiques invalidantes, puisque une multitudes de telles anomalies ont été identifiées qui causent un retard mental alors qu’on n’a à ce jour pas trouvé une seule variante génétique des gènes correspondants (ni d’autres gènes d’ailleurs) associée de manière statistiquement significative et robuste à la variabilité commune de l’ “intelligence” (QI, facteur g ou autre).
« L’héritabilité est forte lorsque la variabilité génétique est grande. Or on sait que lorsqu’un caractère a une grande valeur adaptative, les allèles correspondants sont rapidement sélectionnés au détriment des formes concurrentes, réduisant du même coup la variabilité génétique et l’héritabilité. Si donc la variabilité d’un caractère est grande, c’est que celui-ci n’a pas subi de forte pression sélective ou que ses valeurs moyennes ont une valeur adaptative. Concernant l’intelligence, il faut choisir : on ne peut pas à la fois affirmer qu’il s’agit d’un trait hautement adaptatif, et lui accorder une héritabilité élevée. »
Pierre Roubertoux est idéologiquement bloqué sur la question de l’héritabilité de l’intelligence, ce qui l’amène à faire des arguments peu convaincants. On peut immédiatement opposer un contre-exemple: la capacité à digérer le lactose après le sevrage a une grande valeur adaptative, et pourtant elle n’est pas fixée au sein de l’espèce humaine. Le variant du gène codant la lactase qui en est responsable s’est diffusé très vite au sein de l’espèce humaine, mais n’a pas terminé sa course, et reste très inégalement partagé (il reste notamment minoritaire dans la plupart des populations asiatiques).
L’argument de Roubertoux suppose en fait que l’évolution de l’espèce humaine serait en quelque sorte terminée, que son génome serait figé, que l’intelligence humaine serait un trait “fixé”, et qu’aucun des gènes sous-jacents n’admettrait plus de variations. Cette supposition résonne avec l’idée romantique et naïve selon laquelle, depuis l’avènement de la Culture, l’homme se serait dégagé (comme par magie!) des contraintes de la Nature, et qu’il évoluerait désormais culturellement mais plus génétiquement. Mais rien n’est plus faux. L’époque actuelle n’est pas plus la fin de l’évolution que l’espèce humaine n’en est le sommet. Nous vivons simplement un instantané de l’évolution de notre espèce en train de se faire.
L’idée de trait fixé est peut-être valable pour des espèces dont l’environnement n’a pas changé depuis longtemps, ou pour des traits non affectés par les changements récents de l’environnement. En ce qui nous concerne, les traits de notre espèce (cognitifs et physiques) sont d’autant moins fixés que notre environnement n’a pas cessé de se modifier au cours des derniers 200000 ans (changements climatiques, migrations, innovations technologiques) et ce encore plus dans les derniers 10000, avec l’avènement de l’agriculture, de l’écriture, l’augmentation de la taille des sociétés humaines et de la densité des populations, etc., etc. Evidemment l’homme est lui-même largement responsable des changements de son environnement. Ceux-ci impliquent que certains variants génétiques qui étaient avantageux dans l’environnement passé ne le sont plus, et vice-versa que certains variants qui étaient neutres ou désavantageux deviennent avantageux. Autrement dit, la sélection des traits et des variants génétiques opère continuellement. Par ailleurs il est évident que les inventions humaines font évoluer notre environnement cognitif plus que tout autre aspect. Chaque époque sollicite nos capacités cognitives de manière nouvelle, et ce changement a tendance à s’accélérer. L’évolution de l’intelligence humaine est donc en cours, elle n’est certainement pas terminée et ne le sera probablement jamais.
Ce scénario, qui peut sembler quelque peu théorique, est en fait appuyé par les études de génomique qui montrent que la variabilité génétique est actuellement maximale dans l’espèce humaine, que de nombreux gènes ont subi une pression de sélection dans notre histoire récente (10000 ans) et que le rythme de notre évolution est en accélération. Pour conclure je vous laisse un peu de lecture sur ces sujets. (demandez-moi les pdf si nécessaire)
Bien entendu rien de tout ceci ne constitue des preuves des influences génétiques sur l’intelligence humaine, qui se situent ailleurs et qui ont déjà été évoquées. Ce sont juste des contre-arguments aux arguments bons marchés évoqués par certains.
Hawks, J., Wang, E. T., Cochran, G. M., Harpending, H. C., & Moyzis, R. K. (2007). Recent acceleration of human adaptive evolution. Proc Natl Acad Sci U S A, 104(52), 20753-20758.
Laland, K. N., Odling-Smee, J., & Myles, S. (2010). How culture shaped the human genome: bringing genetics and the human sciences together. Nat Rev Genet, 11(2), 137-148.
Nielsen, R., Hellmann, I., Hubisz, M., Bustamante, C., & Clark, A. G. (2007). Recent and ongoing selection in the human genome. Nat Rev Genet, 8(11), 857-868.
Novembre, J., & Di Rienzo, A. (2009). Spatial patterns of variation due to natural selection in humans. Nat Rev Genet, 10(11), 745-755.
Sabeti, P. C., Varilly, P., Fry, B., Lohmueller, J., Hostetter, E., Cotsapas, C., . . . Lander, E. S. (2007). Genome-wide detection and characterization of positive selection in human populations. Nature, 449(7164), 913-918.
Je suis d’accord : critiquer les calculs d’héritabilité génétique lorsqu’ils portent sur le QI mais pas lorsqu’ils portent sur d’autres traits psychologiques est idéologique, et c’est notamment à Roubertoux que je pensais lorsque j’ai écrit qu’il était amusant de constater que la pertinence des estimations d’héritabilité génétique était présentée de manière différenciée selon qu’on parle du QI ou des traits de la personnalité (cf http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2013/12/19/alzheimer-facteurs-derisque/#note21). Pour ma part, le scepticisme méthodologique que je développe vis-à-vis des recherches en génétique comportementale est le même que le trait sur lequel elles portent soit a priori susceptible de sous-tendre une hiérarchisation sociale des individus ou non.
Je suis d’accord pour dire que cet argument de Roubertoux n’est pas suffisant pour convaincre que l’héritabilité génétique de l’intelligence est nécessairement bien plus faible que le “50 % environ” martelé depuis des années. Je ne faisais pas spécifiquement référence à ce paragraphe, mais à l’article de Roubertoux dans son entier. Dans cet article, il développe plusieurs arguments convergeant vers cette conclusion, conclusion qui est la sienne : je ne dis pas “cette héritabilité est négligeable, puisque Roubertoux lui-même le dit et le démontre”. Si vous relisez le contexte de ma citation, vous verrez que je le cite :
– pour montrer que l’affirmation de Pierre-Henri Gouyon selon laquelle les généticiens peuvent mesurer la part de variation qui est due [l’italique est important] aux gènes pour le QI des enfants comme pour la taille du blé est fallacieuse, puisque le plus éminent des généticiens du comportement français réfute lui-même la pertinence de cette mesure;
– en disant que les arguments de Roubertoux à l’appui de l’idée que les estimations d’héritabilité génétique du QI ne permettent pas d’inférer l’existe d’une chaîne de causalité biologique entre variantes génétiques et variabilité du QI restent recevables.
Par ailleurs, votre contre-exemple ne me convainc pas. En effet, la capacité à digérer le lactose après le sevrage n’a pas une grande valeur adaptative en général mais seulement dans certains contextes écologiques (au sens large du terme, i.e. climat + denrées commestibles disponibles + technologies de transformation du lait disponibles + pratiques alimentaires culturelles => valeur adaptative de cette capacité), ce qui peut expliquer son inégale répartition au sein de l’espèce humaine selon les aires géographico-culturelles considérées.
Si on considère que cet exemple est un bon argument contre l’idée de Roubertoux au sujet de l’intelligence, ça signifie qu’on fait l’hypothèse que les contextes écologiques dans lesquels se sont développées les différentes populations humaines ne conféraient pas la même valeur adaptative aux mêmes formes ou degrés d’intelligence, et que des prédispositions génétiques à développer telle forme ou tel degré d’intelligence sont aujourd’hui inégalement réparties selon l’aire géographico-culturelle considérée. Est-ce ce que vous pensez ?
“Chaque époque sollicite nos capacités cognitives de manière nouvelle, et ce changement a tendance à s’accélérer. L’évolution de l’intelligence humaine est donc en cours, elle n’est certainement pas terminée”
=> Une évolution actuelle et rapide de l’intelligence humaine ne peut avoir lieu que s’il existe une variabilité génétique susceptible de faire l’objet d’un processus de sélection qui serait le moteur de cette évolution. On ne peut dire “et donc” que sous cette hypothèse. Rien ne permet d’exclure l’hypothèse que les pressions de sélection subies par notre espèce ont conduit à faire émerger un cerveau humain certes programmé génétiquement mais “programmé pour apprendre”, comme le disait François Jacob, c’est-à-dire à sélectionner des dispositions génétiques permettant au cerveau de tous les humains (sauf anomalies génétiques) de s’adapter à ces nouvelles sollicitations cognitives. Prenons l’exemple de la lecture que vous connaissez bien mieux que moi : diriez-vous que l’apparition de l’écriture et la grande valeur adaptative associée à la capacité de lire a été ou est le moteur d’une évolution génétique de l’espèce humaine, par sélection de variantes génétiques optimisant les capacités de lecture, ou que le cerveau humain est suffisamment souple pour utiliser efficacement à cet usage des régions du cerveau qui n’ont pas initialement été “programmées pour ça” ?
Rapidement sur le gène de la lactase:
Bien sûr la valeur adaptative d’un trait dépend du contexte écologique, mais avoir accès à une nouvelle source de nutrition facile et abondante (le lait ovin et bovin) est adaptative dans tous les contextes où la nourriture est rare, c’est-à-dire partout et tout le temps à part les pays développés depuis le 20ème siècle. Sans aucun doute c’était adaptatif aussi en Asie il y a 10000 ans, et si le nouvel allèle apparu au moyen-orient à cet époque s’y est moins diffusé, cela doit simplement être dû aux échanges génétiques insuffisants entre asiatiques d’une part et européens et moyen-orientaux d’autre part pendant cette période.
Bref, il ne suffit pas qu’un trait soit adaptatif, encore faut-il que l’allèle sous-jacent ait à la fois le temps et l’occasion de se diffuser dans l’ensemble de l’espèce.
Un article pour approfondir:
Ingram, C. J., Mulcare, C. A., Itan, Y., Thomas, M. G., & Swallow, D. M. (2009). Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence. Human Genetics, 124(6), 579-591.
Merci pour votre démarche, je me demandais si l’émotion était innée et la raison acquise et vous m’avez apporté une partie de la solution.
Je découvre votre débat sur l’innée et l’acquis et c’est passionnant pour moi qui ne suis pas de la partie. Je suis intéressé de voir que globalement vous êtes d’accord pour dire que la responsabilité du développement d’un individu est partagé entre les gènes et l’environnement sans que cela puisse être quantifié (je ne sais donc pas si ce mot « partagé » est adapté). Ce qui est satisfaisant est de constater, qu’en définitive, je trouve, que les réponses que vous apportez aux idées que vous dénoncez, relèvent du bon sens.
J’ai deux questions :
1- L’acquis peut-il s’inscrire dans les gènes et par la même devenir transmissible au même titre que les autres composantes de l’inné ?
2- En informatique sont stockés en mémoire deux type de données. D’une part les données paramétriques (une valeur) d’autre part les données fonctionnelles (des modes d’actions auxquels il faut affecter des valeurs pour les activer). Sait-on si les données du cerveau sont de même nature (il y a-t-il des recherches en ce sens ?) ? Sinon, existe-t-il un autre type de données ? Peut-être (probablement) le typage de données est-il plus flou (plus riche ?) dans le cas du cerveau.
Ces deux modes de stockage de l’information peuvent être choisis pour décrire le même objet. Il s’agit souvent en informatique de choix personnel du programmeur ou de recherche d’optimisation. La variabilité de performance des individus ( ?). Ne pourrait-elle pas venir de ce genre de choix opéré, plus ou moins consciemment, par les individus ?
1- S’inscrire “dans” les gènes à proprement parler non, mais des modifications épigénétiques acquises peuvent être transmises à la génération suivante et contribuer ainsi au bagage inné d’un individu. Cependant, ces modifications touchant l’expression des gènes et non le code génétique lui-même sont réversibles, au contraire des mutations génétiques. L’épigénétique est un domaine de recherche relativement récent, et l’étendue de ce phénomène et ses implications concrètes restent largement à déterminer.
2- Le codage de l’information dans le cerveau est en effet plus flou (plus riche) : entre autres éléments, l’activité des neurones et la transmission de l’information entre neurones ne sont pas binaires, et par ailleurs rien n’indique qu’il y ait dans le cerveau des types de cellules (ex : astrocytes vs neurones) ou des régions dédiées à des données paramétriques et d’autres à des données fonctionnelles. En tout cas, à ma connaissance personne ne mène de recherches visant à explorer une telle hypothèse, et les modèles mathématiques et informatiques du cerveau existant ne sont pas basés sur ce principe.
Odile Fillod critique en effet beaucoup ses confrères, doit on comprendre que ses confrères sont donc des incapables et qu’Odile Fillod ait elle la science infuse ?
Vous aviez déjà posté un commentaire du même acabit, et quelqu’un y avait assez bien répondu ici : https://allodoxia.odilefillod.fr/2014/07/23/camion-poupee-jeux-singes/#comment-1772. Si vous n’avez rien d’autre à faire que suggérer que ce que je dis est sûrement faux parce qu’il y a plein de gens qui ne pensent pas la même chose que moi, alors vous perdez votre temps en venant sur ce blog. PS : c’est la dernière fois que je fais perdre le leur à mes lecteurs en publiant ce type de remarque stupide et que je perds le mien à y répondre.
Bonjour,
Autant je n’ai aucun doute sur l’interaction biologique/environnement pour construire l’individu et l’idée que les deux sont interdépendants. Néanmoins, n’y-t-il jamais de situations où l’un prédomine l’autre ? Je ne comprends pas trop… Si on considère que pour une même situation, les gens réagiront différemment, ne peut-on donc pas penser que ce sont les gènes qui prédominent ? De même, si une personne réagit par exemple de manière calme à toutes sortes de situations différentes, ne peut-on pas penser qu’il y a une prédominance des gènes ? Egalement si on part du principe qu’une personne est réactive à telle ou telle situation, ne peut-on pas penser que c’est parce que génétiquement, elle a plus de sensibilité pour réagir à ce type de situation ? Auquel cas il y a là aussi une prédominance des gènes…
Sans vouloir dire que les gènes sont le nerfs de tout car encore une fois, je suis bien convaincue et cela me semble aller de soi, que, sans l’environnement, nous ne sommes pas grand chose ou du moins, notre capital génétique ne peut s’exprimer. Mais de là à dire que c’est 100% ou 50/50 selon les auteurs pour les deux versants biologique comme environnementale, je suis perdue…
J’espère que vous pourrez m’éclairer.
Merci beaucoup.
Je suis embêtée pour vous répondre, car il me semble que vous n’avez pas bien compris ce que j’ai écrit. Il y a bien dans certaines “situations” ou certains environnements des caractéristiques dont la variabilité est à “prédominance” génétique (voire à 100% d’origine génétique), et inversement pour d’autres. Je ne vois rien dans ce que j’ai écrit qui ressemble à l’affirmation qu’il n’y a “jamais de situations où l’un prédomine [sur] l’autre”.
Par ailleurs, mon point n’est pas de dire que c’est “100% ou 50/50 selon les auteurs”.
Enfin, il est bien clair que tout le monde ne réagit pas pareil dans une même situation ou n’obtient pas les mêmes scores à des tests de capacités cognitives, et ces réactions ou scores montrent souvent une stabilité certaine au cours de la vie, mais ce simple constat ne permet pas de conclure à une prédominance des gènes. La formation de la personnalité, du “tempérament” et de l’intellect se fait dès le départ en interaction avec l’environnement, de sorte que par exemple, une personne qui réagit “de manière calme à toutes sortes de situations différentes” réagit peut-être ainsi parce que son vécu développemental a construit chez elle cette forme de tranquillité. L’influence relative des différents facteurs potentiels est à déterminer au cas par cas. On ne peut pas affirmer de manière générale quoi que ce soit du type “les traits de la personnalité sont principalement déterminés par le bagage génétique”. La littérature scientifique produite par les tenants de ce type d’hypothèse contredit elle-même la validité d’une telle affirmation générale.
Merci pour cet article très fourni. Deux questions.
Vous prêtez à Gouyon de considérer comme “dépassé” le débat sur l’inné et l’acquis alors qu’il introduit son propos en disant que c’est un « sujet qui reste terriblement d’actualité aussi bien sur le plan politique que scientifique ». Ce qui semble dépassé selon Gouyon n’est pas la nécessaire analyse de la part de l’un et l’autre déterminant – le “débat” inné-acquis, au plan scientifique, donc – mais sa traduction en combat idéologique déconnecté, sur le modèle de l’échange inculte entre Sarkozy et Onfray. On ne comprend pas plus en quoi c’est l’approche de ce dernier que Gouyon prendrait « plus particulièrement pour cible » : Gouyon rassure simplement Onfray sur le fait qu’on peut accepter le rôle des gènes tout en sachant qu’il reste possible de changer le monde (pour le dire vite) en modifiant l’environnement. Il contredit tout autant Sarkozy par ailleurs.
L’analogie de la crêpe est intéressante mais sa conclusion n’induit-elle pas en erreur ? Ce n’est pas par ce que les variantes de recettes ne produisent pas de différences sur la couleur qu’elles n’influencent pas cette couleur. Mais elles l’influencent toutes de la même manière.
Imaginons que la seule variation d’une recette à l’autre soit le nbre de pincées de sel, varier ce paramètre ne modifiera pas la couleur de la pâte. Mais ça ne signifie pas que la recette dans son ensemble n’a pas une incidence sur cette couleur : les crêpes sont toutes « beiges » du fait de l’œuf contenu dans la recette. En langage colorimétrique TSL on pourrait dire que les recettes de pâte à crêpe définissent toutes la (même) teinte et que les différences d’ingrédients effectivement utilisés et la « main » du pâtissier déterminent la saturation et la luminosité.
N’est-ce pas plutôt dans ce sens qu’il faut saisir l’idée de l’« évidence » de l’influence génétique ?
P.-H. Gouyon exprime l’idée que le “débat inné/acquis” est dépassé au sens où les discours du “tout inné” et ceux du “tout acquis”, qu’il renvoie à deux croyances historiques ou théories pseudo-scientifiques idéologiquement et historiquement marquées que Sarkozy et Onfray endossent dans leur “échange inculte”, pour reprendre vos termes, ont été définitivement balayés (il dit : « Evidemment, c’est aussi faux l’un que l’autre. […] la variation que j’observe dans une population, c’est la somme des effets de l’environnement plus des effets des gènes. Et […] évidemment, hein, ce qui compte, c’est de comprendre qu’il y a toujours de l’environnement et des gènes qui jouent, dans quasiment tous les caractères. »).
C’est cette affirmation appliquée à toute variation observée dans une population que je critique. Gouyon affirme en substance, pour reprendre l’un des caractères cités par Sarkozy et Onfray, que s’il y a des personnes pédophiles et d’autres qui ne le sont pas, c’est “évidemment” en partie dû à des différences génétiques entre eux et en partie dû à des différences environnementales, puisqu’il affirme qu’Onfray comme Sarkozy ont tous deux “évidemment” tort.
“On ne comprend pas plus en quoi c’est l’approche de ce dernier que Gouyon prendrait « plus particulièrement pour cible » ” : je ne l’explique pas dans le présent billet, je ne fais que rendre compte de ce que j’ai perçu à l’écoute de cette conférence.
Je ne comprends pas votre second paragraphe car je ne dis évidemment pas que la recette de la pâte à crêpe dans son ensemble n’a pas d’incidence sur la couleur. Comme vous le dites, les crêpes sont effectivement (presque) toutes « beiges » du fait de l’œuf contenu dans la recette et c’est bien là que se situe l’« évidence » de l’influence génétique sur les traits humains : les humains sont par exemple (presque) tous dotés de mains à 5 doigts du fait du contenu du génome humain. Dire cela ne fait qu’enfoncer une porte ouverte, et l’objet de ce billet est justement de montrer que cette évidence-là n’est généralement pas ce qui est en question dans le “débat inné/acquis”.
PS (pour aller au bout de mon analogie) : le débat inné/acquis porterait typiquement sur la question de savoir à quoi est dû le fait, dans une population donnée, que certaines personnes ont des mains à 6 doigts et d’autres 5. Or la réponse n’est pas “évidemment” que les deux jouent. Il pourrait se trouver que dans cette population, tous les cas de personnes à 6 doigts soient de cause environnementale (ex : substance tératogène absorbée par la gestatrice durant la grossesse), ou au contraire qu’il soient tous de cause génétique, dus au fait que toutes les personnes concernées sont porteuses d’une mutation génétique ayant cet effet.
Bonjour, j’aimerais vous faire quelques remarques suite à votre échange avec M. Ramus.
Ça sera en deux points.
Le premier est sur l’argument de la plasticité cérébrale :
Vous devriez savoir qu’une large fenêtre temporelle ouverte aux apprentissages et à la transmission culturelle n’est pas contradictoire avec le fait que les différences individuelles dans les capacités d’apprentissage soient en partie dues à des différences génétiques. C’est juste une question différente.
Prolongeons votre raisonnement: si la durée de l’exposition à l’environnement faisait nécessairement croître l’importance relative de l’environnement par rapport aux gènes, alors vous devriez prédire que l’héritabilité de l’intelligence et d’autres traits cognitifs diminue avec l’âge. Or c’est le contraire qui est observé, que l’on estime l’héritabilité par les jumeaux ou par le génome. La raison est que tous les individus ne sont pas égaux face à l’environnement, ils ont des prédispositions qui les orientent vers des environnements qui renforcent encore l’effet de ces prédispositions (corrélations gènes-environnement actives et évocatives).
Quelques références pour creuser:
Plomin, R., & Deary, I. J. (2014). Genetics and intelligence differences : Five special findings. Mol Psychiatry. https://doi.org/10.1038/mp.2014.105
Plomin, R. (2014). Genotype-Environment Correlation in the Era of DNA. Behavior Genetics, 44(6), 629‑638. https://doi.org/10.1007/s10519-014-9673-7
Rimfeld, K., Malanchini, M., Krapohl, E., Hannigan, L. J., Dale, P. S., & Plomin, R. (2018). The stability of educational achievement across school years is largely explained by genetic factors. Npj Science of Learning, 3(1), 16. https://doi.org/10.1038/s41539-018-0030-0
“Vous devriez savoir […]” : je le sais évidemment et cela transparaît très clairement dans tout ce que j’ai écrit. Vous ne savez visiblement pas lire.
“Prolongeons votre raisonnement: si la durée de l’exposition à l’environnement faisait nécessairement croître l’importance relative de l’environnement par rapport aux gènes, alors vous devriez prédire que l’héritabilité de l’intelligence et d’autres traits cognitifs diminue avec l’âge” : ce n’est pas mon raisonnement, vous ne savez décidément pas lire. Je recopie/colle ce que j’ai écrit au cas où vous arriveriez cette fois à le lire correctement : “Je dis seulement – reprenant ici l’argument de Changeux – qu’une phase longue pendant laquelle le cerveau est très plastique donne a priori plus de prise aux interactions avec l’environnement, plus de poids à leurs effets que chez les individus d’une espèce dans laquelle le processus de maturation est très court.”
Rien dans ce que j’ai écrit n’implique que je devrais prédire que l’héritabilité de l’intelligence et d’autres traits cognitifs diminue avec l’âge.
Deuxième point : Vous soulevez la question de savoir dans quelle mesure les associations génétiques reflètent des effets génétiques causaux. C’est une question importante, que vous balayez un peu rapidement par un argument d’incrédulité. Pour ce qui est des variations génétiques rares, on connait plus de 1000 gènes dont des mutations ont un impact sur l’intelligence humaine, la causalité est prouvée au-delà de tout doute raisonnable, et les mécanismes précis sont partiellement compris dans une bonne partie des cas. Pour ce qui est des variations génétiques fréquentes (celles mesurées dans les analyses génomiques), c’est plus compliqué car les effets sont faibles. Si vous consultez les études génomiques récentes, vous verrez que de nombreux efforts sont néanmoins faits pour tester les mécanismes causaux. Par exemple, on examine dans quels tissus sont exprimés les gènes associés au phénotype. Il se trouve que la plupart des gènes associés à des traits cognitifs sont exprimés dans le cerveau, plutôt que dans le gros orteil. Ce n’est pas ce que prédisent ceux qui pensent que ces associations statistiques ne reflètent aucun mécanisme causal. De même, pour chaque SNP associé à un trait cognitif, on examine à quels autres traits il est associé. Dans la plupart des cas, on trouve qu’il est associé à des caractéristiques cérébrales anatomiques ou fonctionnelles, plutôt qu’à des traits physiologiques ou anatomiques sans rapport avec la cognition. A nouveau, ce n’est pas ce que vous prédiriez si tout cela n’était que du bruit statistique. Bref, on a tout de même un faisceau convergent de données montrant que les associations statistiques observées dans les GWAS reflètent bien, pour la plupart d’entre elles, des mécanismes causaux plausibles. Vous pouvez retrouver ce genre d’analyses par exemple dans le dernier GWAS du niveau d’éducation:
Cordialement
“Pour ce qui est des variations génétiques rares, on connait plus de 1000 gènes dont des mutations ont un impact sur l’intelligence humaine, la causalité est prouvée au-delà de tout doute raisonnable, etc” : encore un homme de paille… J’ai notamment écrit dans ma réponse à F. Ramus de décembre 2013, dans laquelle j’appelais une nouvelle fois à bien distinguer la question de la variabilité commune de celle des anomalies génétiques invalidantes, qu’une MULTITUDE de telles anomalies ont été identifiées qui CAUSENT un retard mental”, donc si on laisse de côté la discussion de votre “plus de 1000”, vous argumentez une nouvelle fois en faveur d’une chose que j’aurais ignorée ou niée alors que je l’ai au contraire affirmée. C’est assez agaçant.
“Pour ce qui est des variations génétiques fréquentes (celles mesurées dans les analyses génomiques), c’est plus compliqué car les effets sont faibles” : c’est “plus compliqué” pas seulement parce que les effets (au sens statistique du terme) sont faibles, mais aussi notamment parce qu’ils sont souvent mal ou pas répliqués quand on passe d’une population à une autre.
“Si vous consultez les études génomiques récentes, vous verrez que de nombreux efforts sont néanmoins faits pour tester les mécanismes causaux” : j’ai consulté des GWAS récents et je sais que “des efforts sont faits” pour tester des mécanismes causaux, merci.
“Il se trouve que la plupart des gènes associés à des traits cognitifs sont exprimés dans le cerveau, plutôt que dans le gros orteil” + “on a tout de même un faisceau convergent de données montrant que les associations statistiques observées dans les GWAS reflètent bien, pour la plupart d’entre elles, des mécanismes causaux plausibles” : je serais curieuse de savoir comment vous avez établi ces deux “la plupart”. Quant à ce que cela montre ou pas, c’est à discuter au cas par cas – et pas pour évaluer si tel mécanisme causal est plausible ou non, mais pour évaluer si c’est le plus plausible pour expliquer telle ou telle association.
“Ce n’est pas ce que prédisent ceux qui pensent que ces associations statistiques ne reflètent aucun mécanisme causal” : je ne vois pas en quoi cette phrase me concerne puisque je n’ai jamais affirmé une telle chose.
PS : je ne mettrai pas en ligne les deux commentaires stupides et méprisants que vous venez de renvoyer suite à mes deux réponses et qui pointent vers une vidéo à laquelle je n’ai pas envie de faire de la publicité. Allez voir ailleurs si j’y suis. Marre des trolls qui écrivent sous pseudo.