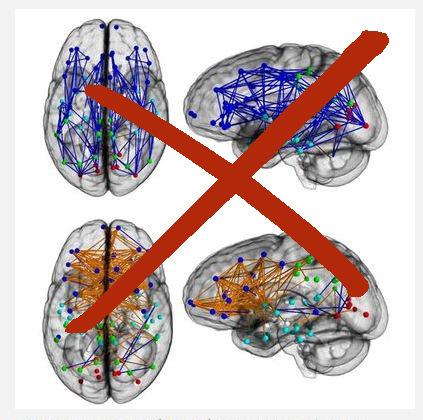 A en croire maints commentateurs de l’actualité de décembre 2013, des chercheurs auraient démontré l’existence d’une différence frappante entre les « connectomes » cérébraux des femmes et ceux des hommes, et celle-ci serait à l’origine d’une forme de complémentarité de leurs aptitudes et comportements. L’étude en question était pourtant très (très) loin d’autoriser les conclusions annoncées. Ce nouveau cas de validation imaginaire du bienfondé de certains stéréotypes de genre est exemplaire. Comme souvent, cette construction d’une fausse information a été sous-tendue par un tropisme hétérosexiste, favorisée par le manque d’éthique des producteurs de l’article scientifique, et permise par le dysfonctionnement structurel des médias en matière de sciences.
A en croire maints commentateurs de l’actualité de décembre 2013, des chercheurs auraient démontré l’existence d’une différence frappante entre les « connectomes » cérébraux des femmes et ceux des hommes, et celle-ci serait à l’origine d’une forme de complémentarité de leurs aptitudes et comportements. L’étude en question était pourtant très (très) loin d’autoriser les conclusions annoncées. Ce nouveau cas de validation imaginaire du bienfondé de certains stéréotypes de genre est exemplaire. Comme souvent, cette construction d’une fausse information a été sous-tendue par un tropisme hétérosexiste, favorisée par le manque d’éthique des producteurs de l’article scientifique, et permise par le dysfonctionnement structurel des médias en matière de sciences.
Chapitres
Introduction – L’événement scientifique de décembre 2013
Une observation faite sur un échantillon biaisé et très particulier
L’étude d’artefacts grossiers d’interprétation délicate, pas des connexions cérébrales
Pas d’inversion des ratios de connectivité inter-/intra-hémisphères selon le sexe
Des images qui ne représentent pas du tout ce qu’on a dit
Des différences infimes au regard de la variabilité indépendante du sexe
L’oubli fâcheux de tenir compte de facteurs de confusion
Des observations à confirmer, d’ores et déjà non convergentes avec d’autres
Des conséquences fonctionnelles non seulement spéculatives mais fantaisistes
Rien n’indique que les différences résultent d’une sexuation naturelle du cerveau
Pourquoi cet article a fait l’objet d’une vulgarisation particulièrement désastreuse
– Introduction
– Un article scientifique de très faible qualité
– Un comité éditorial peu regardant voire pousse-au-crime
– Le comportement des auteurs après la publication de l’article
– La force des images
– La réponse à une demande sociale
Conclusion
L’EVENEMENT SCIENTIFIQUE DE DECEMBRE 2013
Les journalistes accrédités ont été informés le 27 novembre 2013, résumé à leur intention et texte intégral à l’appui, de l’article à paraître dans la revue scientifique éditée par l’Académie des sciences des Etats-Unis [1]. Dès la fin de l’embargo fixé par la revue au 2 décembre à 15h heure locale, 20h à Londres et 21h à Paris, les médias nord-américains et britanniques se sont mis à bruisser de la nouvelle, les médias français se réveillant quant à eux le lendemain matin. Avant d’en rendre compte au grand public, les journalistes spécialisés avaient eu cinq jours pour lire l’article et demander des éclaircissements à son auteur correspondant, mais comme d’habitude les choses se sont passées bien différemment. Dans leur quasi-totalité, les médias francophones se sont contentés de recycler les informations de sources secondaires, et ce en les détériorant généralement : voir dans l’Annexe 2 un aperçu de l’annonce de cette étude.
Circulation circulaire d’une pseudo-information
En France, c’est une dépêche émise par un journaliste de l’AFP en charge du suivi des publications scientifiques faites dans les revues américaines, basé à Washington pour « mieux répondre aux décalages horaires » des clients de l’AFP (et non pour être proche de l’illusoire « terrain » que constitueraient les labos de la région) [2], qui lance dans la nuit le processus de « circulation circulaire de l’information » (Bourdieu, 1996). Malheureusement, sa dépêche n’est une fois de plus [3] qu’un résumé-paraphrase du communiqué de presse diffusé sur Eurekalert! par l’employeur des auteurs principaux, dégradant de surcroît singulièrement l’information que celui-ci contenait : voir dans l’Annexe 3 la comparaison des deux et la description des profondes altérations opérées par le journaliste.
Dès 7h36 le 3 décembre, France 2 diffuse dans Télématin, sa matinale aux 1.4 millions de téléspectateurs désormais « resserré[e] sur l’info pure et dure » (Armati, 2014), un reportage reprenant les principaux éléments de la dépêche AFP (voir sa retranscription dans l’Annexe 4). Le reportage est mis en ligne une heure plus tard sur le site FranceTVinfo, accompagné d’un texte lui aussi très largement inspiré de la dépêche, et est sélectionné dans le zapping du portail masculin Gentside.
Tout au long de la journée et les jours suivants se succèdent les reprises commentées du reportage de France 2 et les reprises ou paraphrases de la dépêche AFP sur les sites de la presse régionale (Dernières Nouvelles d’Alsace, Le Dauphiné Libéré, L’Est Républicain, La Dépêche, Le Berry Républicain, Midi Libre, La Nouvelle République), les sites d’information généralistes nationaux (RTL, Europe 1, Free actualité, Yahoo news, Metronews, LCI-TF1, Le Point), les sites spécialisés (Maxiscience , Pourquoi Docteur, Doctissimo, Top Santé, Top Actus Santé, Sante Magazine) et les sites destinés aux femmes (Journal des Femmes, Au Féminin.com, TerraFemina), ainsi que les reprises de ces reprises (Le Nouvel Obs reprenant Pourquoi Docteur, Free actualité encore reprenant cette fois Metronews, Yahoo news encore reprenant cette fois Maxisciences, Culture Femme reprenant Europe 1, etc). Quelques médias se démarquent en remontant au communiqué de presse Eurekalert! (Santé Log) ou en se basant sur des articles de médias anglophones (Maxisciences s’appuyant sur Live Science et The Guardian, L’Express et Le Figaro s’appuyant sur BBC News, Futura-Sciences paraphrasant Live Science) ou en sollicitant un avis d’ « expert » (M6), mais ignorant toujours avec superbe la source primaire de l’information. Et lorsque (très rarement) des éléments d’information sont puisés directement dans l’article scientifique, ce ne sont pas les données factuelles qui y figurent mais seulement leur commentaire fallacieux par les auteurs qui est repris en substance (Pour La Science, Le Quotidien du Médecin).
Très vite, des producteurs habituels [4] de discours pseudo-scientifique de naturalisation du genre se félicitent de la clarté et de la solidité des résultats de l’étude, indiquant les leçons à en tirer.
Premières instrumentalisations par des journalistes spécialisés et experts engagés
Ainsi, sur le site du magazine Pour la Science, le journaliste scientifique spécialisé en neurosciences et en psychologie Sébastien Bohler affirme que l’étude « marque une date clé ». Selon lui, « une chose semble maintenant certaine : il faudra que le débat public (surtout en France, où l’on reste très en retard sur la majorité des autres pays) intègre cette notion des différences neuropsychologiques liées au sexe. » Dans son billet plus détaillé auquel l’article renvoie sur Scilogs (autre site de Pour La Science), il introduit quelques bémols mais enfonce le clou : « C’est une découverte lourde de conséquences et qui nous oblige à réfléchir. Elle fait suite à de longues recherches sur les différences cérébrales entre hommes et femmes, parfois contestées. Elle est décisive car pour la première fois, des clichés du cerveau montrent des différences très nettes sur des échantillons fortement significatifs […] En fait, ces observations sont passionnantes, parce que [e]lles permettent de partir d’une base scientifique ferme pour admettre qu’il y a des différences dans la structure du cerveau en fonction du sexe ».
Sur le site Le Plus du Nouvel Obs, la chroniqueuse invitée Peggy Sastre qui y tient le blog « sexe, science et al. » et passe pour être une journaliste scientifique [5] se réjouit quant à elle que cette étude soit bien « passée » dans les médias et que ses observations incontestables aient apparemment laissé sans voix les critiques habituels de ce genre d’annonces. Confortée par ces nouvelles données scientifiques dans son mépris de ceux qui persistent à « nier les différences sexuelles cérébrales », elle en profite pour dézinguer de manière grossièrement mensongère le livre de Rebecca Jordan-Young qu’elle n’a pas lu [6].
Sur Atlantico, c’est le psychiatre et « directeur d’enseignement à l’Université Paris VI » Jean-Paul Mialet qui s’enhardit : « [c]ette fois, nous sommes en présence d’une étude qui montre des différences flagrantes et peu contestables », des données qui ne pourront plus être « négligées au profit d’autres données, les données culturalistes ». Il est temps de prendre acte du fait que les femmes « ont une disposition particulière pour les soins, grâce à leur empathie et leur souci de l’humain » et de « s’interroger sans arrière-pensée sur l’influence du sexe sur certaines aptitudes et encourager leur développement » (il donne à ce propos l’information certainement glanée dans le documentaire dont j’ai parlé ici qu’en Norvège, « pays d’avant-garde pour l’égalité des sexes », malgré les millions dépensés « dans la parité », « 90% des infirmiers sont des femmes et 90% des ingénieurs sont des hommes »).
Sur son blog à l’intitulé trompeur « Politis », le biologiste Philippe Poindron, professeur honoraire de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, exulte : « Les pauvres LGBT, les pauvres constructivistes, les pauvres imbéciles bernanosiens qui nient la réalité ! Cette fois-ci, les résultats sont absolument confondants de clarté (pour ce que j’ai pu comprendre). Ils touchent à la structure du cerveau du mâle et de la femelle de l’homme, et ils concluent qu’ils ne sont pas faits pour la même tâche. […] Les différentes régions du cerveau de l’homme ne sont pas connectées entre elles de la même façon que celles du cerveau de la femme. Il en résulte un mode d’appréhension du monde qui n’est pas identique chez l’homme et chez la femme, et un développement différents des différentes fonctions cérébrales. […] De toute manière, cette étude est un coup mortel porté aux théoriciens du genre. Je serais Judith BUTLER (ce qu’à Dieu ne plaise), je me ferais du souci quant à l’avenir de ma théorie ».
Il faut dire que cette étude semble avoir de quoi susciter leur enthousiasme. Ne vient-elle pas de « révéler » que « les cerveaux des hommes et des femmes sont branchés très différemment » (AFP, etc), et plus précisément de produire des images qui « établissent que chez les hommes, les connexions intrahémisphériques sont plus fournies », alors que « [c]hez les femmes, à l’inverse ce sont les connexions entre les deux hémisphères qui prédominent » (Le Quotidien du Médecin) ? Et puisqu’elle « suggère que le cerveau masculin est structuré pour faciliter les échanges d’informations entre le centre de la perception et celui de l’action » et montre que chez les femmes, « les branchements relient l’hémisphère droit, ou siège la capacité d’analyse et de traitement de l’information, à l’hémisphère gauche, centre de l’intuition » (AFP, etc), cette étude ne permet-elle pas de « confirmer » que « le cerveau des hommes et des femmes fonctionne différemment » en même temps que « la véracité de certains stéréotypes » (Le Nouvel Obs – Pourquoi Docteur) ?
Pas si vite…
Hélas pour les auteurs de ces comptes-rendus, et surtout hélas pour tous ceux qui les ont crus, ce n’est pas du tout cela que les chercheurs ont montré. Sans même lire l’article scientifique, et a fortiori en consacrant les quelques minutes nécessaires à la lecture de ses cinq pages et quelques lignes, le caractère délirant de l’interprétation de ses résultats sautait aux yeux et justifiait une critique immédiate. Peu après la publicisation de l’étude, de nombreux spécialistes s’en sont chargé dans les médias ou blogs spécialisés anglo-saxons [7]. J’ai préféré pour ma part prendre le temps d’analyser de manière plus approfondie à la fois le contenu de l’article, la méthodologie précise de l’étude et ses comptes-rendus dans l’espace médiatique francophone. Pour pouvoir mesurer à quel point ils étaient problématiques, je vous invite maintenant à me suivre dans une visite commentée de ce que les chercheurs ont réellement fait et observé.
UNE OBSERVATION FAITE SUR UN ECHANTILLON BIAISE ET TRES PARTICULIER
Tout d’abord, soulignons que ce qui a été observé dans cette étude n’est pas une différence entre « les femmes » et « les hommes », ni même entre « des femmes » et « des hommes », mais plutôt une différence entre des filles et des garçons, que ceux-ci étaient issus d’une population humaine bien spécifique, et que cet échantillon était notablement biaisé en raison de sa méthode de constitution. Commençons par décrire celle-ci, et pour cela voyons d’abord le contexte de l’étude ayant donné lieu à cet article : il sera utile de l’avoir en tête pour la suite.
Un contexte bien particulier ayant pesé notamment sur la constitution de l’échantillon
Cette étude s’inscrit dans un vaste projet mené par le Brain Behavior Lab de l’Université de Pennsylvanie, codirigé par Raquel Gur et son mari Ruben, en collaboration avec l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) [8]. Le but affiché de ce projet, pour lequel Raquel Gur a obtenu de l’Institut National de la Santé Mentale étatsunien un financement de plus de 14 millions de dollars entre septembre 2009 et septembre 2012 (il devait prendre fin en septembre 2011 mais a été prolongé d’un an) était d’avancer dans « la compréhension et le traitement des troubles neuropsychiatriques développementaux ». Il se traduisait en deux objectifs audacieux formulés en ces termes par Raquel Gur : « établir les substrats neuronaux des trajectoires de développement des phénotypes comportementaux » et « établir les réseaux de gènes sous-jacents à la vulnérabilité neuronale conduisant aux troubles mentaux ». Dans ce but, les chercheurs ont d’abord caractérisé, notamment via une batterie de tests neurocognitifs informatisés mise au point à cet effet par le couple Gur, le profil psychologique d’une cohorte de jeunes préalablement génotypés. Sur un sous-ensemble d’entre eux, ils ont procédé en moyenne environ trois mois plus tard à des enregistrements d’imagerie cérébrale par résonnance magnétique : IRM structurelle classique, IRM de diffusion (DTI), et IRM fonctionnelle au repos, durant un test de mémoire de travail sur des formes géométriques complexes (fractales), et durant un test d’identification d’émotions faciales. Toutes ces données psychologiques, génétiques et de neuroimagerie étant recueillies, restait à les croiser dans tous les sens pour trouver des corrélats et en faire des articles. C’est ce que les chercheurs ont commencé à faire, et l’article dont il est question ici est l’un d’entre eux.
La cohorte d’étude a été constituée de jeunes malades ayant consulté l’une des structures de soin affiliées au CHOP, ayant à cette occasion donné leur sang et ayant ainsi pu être génotypés, et dont les parents avaient accepté d’être recontactés ultérieurement pour participer à une « étude génomique des troubles pédiatriques ». Parmi les 50 813 volontaires, 10 000 ont été tirés au sort de manière à constituer un échantillon contenant autant de filles que de garçons, autant d’ « afro-américains » que de « caucasiens », et autant de sujets de chaque âge dans la tranche considérée, à savoir 8 à 21 ans au démarrage des évaluations psychologiques. Parmi ceux-ci, 9428 ont finalement été gardés après un premier entretien ayant permis d’exclure ceux qui ne souhaitaient plus participer et ceux dont le niveau d’anglais ou les capacités mentales ou sensorimotrices étaient insuffisants pour participer aux tests neurocognitifs. Après que tous ont passé ces tests, les recruteurs en charge du volet de neuroimagerie du projet ont cherché à recontacter 5977 d’entre eux. Entre les 217 n’ayant pu être joints, les 654 n’ayant plus voulu participer et les 2424 exclus en raison de maladies graves (ex : cancer), de troubles médicaux susceptibles de biaiser les mesures (ex : épilepsie, traumatisme crânien, anomalie connue de l’anatomie cérébrale) ou de contre-indication à l’IRM (ex : grossesse en cours, piercing non-amovible, risque de présence de résidus métalliques, nombre significatif de tatouages amateurs), restaient 2682 jeunes éligibles. 1719 d’entre eux ont été tirés au hasard en s’assurant d’une répartition homogène en termes de sexe et d’âge, dont 1445 ont finalement mené à son terme le volet de neuroimagerie (83 ne se sont pas présentés, 76 n’ont pu être reçus en raison de la surcharge de travail de l’équipe, 36 se sont avérés trop anxieux ou claustrophobes pour pouvoir rester dans l’appareil, et pour 25 il y a eu un « problème technique »).
Dans un article descriptif de ce volet de neuroimagerie du projet, ces 1445 participants sont présentés comme étant des « adolescents » (Satterthwaite et al, 2014, p. 546), et on constate que presque tous avaient entre 9 et 21 ans au moment de l’enregistrement des données d’IRM (voir la Fig. 1 ci-dessous).
Un échantillon d’adolescents non représentatif et incorporant des biais liés au sexe
Pour l’article comparant filles et garçons dont il est question ici, les données d’IRM de diffusion de 949 d’entre eux ont été retenues pour l’analyse. Leur âge moyen était de 15.11 ans, et comme on vient de le voir ils avaient presque tous entre 9 et 21 ans, même si l’article signale qu’ils avaient entre 8 et 22 ans.
On ne sait pas sur quels critères les données d’imagerie de 34.3 % des sujets (496 sur 1445) ont été exclues a posteriori. On peut seulement imaginer que les auteurs ont procédé de manière similaire à ce qui est exposé dans Satterthwaite et al (2013a) rapportant une analyse des données d’IRM fonctionnelle (où l’échantillon est également qualifié d’ « échantillon d’adolescents », p. 16252). Pour ce dernier, les données de 494 sujets ont été exclues en raison de mouvements excessifs pendant l’enregistrement des images (216), d’usage de psychotropes ou de drogues (168), d’incapacité à effectuer le test avec un niveau de performance minimal (95), d’antécédents médicaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du cerveau (77), d’antécédents psychiatriques (51), d’images incomplètes (23) ou d’anomalie cérébrale découverte à cette occasion (1). Ce qui est en tout cas certain, c’est que les critères d’exclusion ont créé des biais de sélection différents pour les garçons et les filles, puisqu’à partir d’un échantillon devant être équilibré en termes de sexes il ne reste plus ici que 428 garçons pour 521 filles.
Les maigres données fournies dans l’article au sujet de ces jeunes, à savoir seulement les âges moyens et pourcentages de chaque « race » [9] par sexe, montrent que l’échantillon était significativement biaisé sous deux autres aspects au moins. D’une part, 46.3 % des filles étaient auto-déclarées « afro-américaines » contre seulement 35.5 % des garçons : les deux groupes différaient donc en moyenne en termes d’environnement socioculturels au moins, sans parler d’éventuelles différences physiologiques d’origine génétique ou non (par exemple, la puberté semble être aux Etats-Unis actuellement en moyenne plus précoce chez les filles se déclarant « afro-américaines » que chez celles se déclarant « caucasiennes »). D’autre part, la puberté étant plus précoce chez les filles que chez les garçons et l’âge moyen des filles étant de surcroît légèrement supérieur à celui des garçons dans l’échantillon (15.3 ans vs 14.9 ans), les deux groupes n’étaient a priori pas du tout comparables en termes de stade de développement pubertaire. Cette hypothèse est confirmée par la description de l’échantillon de 947 jeunes âgés en moyenne de 15.2 ans retenu dans Satterthwaite et al (2013a) déjà cité : il contenait 287 filles considérées comme post-pubères (stade de Tanner estimé à 5) contre seulement 138 garçons considérés comme tels.
Disons en synthèse que l’échantillon utilisé pour procéder à la comparaison des groupes de sexe était loin de constituer un échantillon représentatif de la tranche d’âge 9-21 ans de la population dont il a été tiré et incorporait au moins trois biais de sélection substantiels susceptibles d’avoir des effets sur la comparaison des deux groupes, qu’un échantillon de cette tranche d’âge ne saurait être représentatif des « femmes » et des « hommes » de cette population, et que cette population urbaine et suburbaine de la côte Est des Etats-Unis ne saurait elle-même être représentative des êtres humains en général. Comme cela a été souligné dans TangledWoof, si on ne peut évidemment pas reprocher aux auteurs de n’avoir pas utilisé un échantillon représentatif des divers environnements socioculturels existants, on peut en revanche être choqué qu’une observation faite sur un tel échantillon ait été généralisée, par eux d’abord puis par d’autres, aux « femmes » et aux « hommes » en général.
L’ETUDE D’ARTEFACTS GROSSIERS D’INTERPRETATION DELICATE, PAS DES CONNEXIONS CEREBRALES
Venons-en à l’objet de la comparaison filles/garçons dont les résultats sont rapportés dans l’article, à savoir certaines propriétés du « connectome » que les chercheurs ont élaboré à partir des données d’IRM de diffusion. Savoir comment cet objet a été construit permet de comprendre à quel point l’interprétation qui a été faite des résultats était hasardeuse dans le meilleur des cas, fallacieuse ou franchement erronée la plupart du temps.
Reconstitution d’une image partielle, grossière et incertaine des principales voies neuronales
Contrairement au scanner (imagerie par rayons X) et à l’IRM structurelle classique, produisant des sortes de clichés au sein desquels ont peut distinguer différentes structures anatomiques en fonction de leur composition physico-chimique, l’IRM de diffusion ne montre pas directement de telles structures. Il s’agit d’une technique basée sur l’étude des micromouvements des molécules d’eau : à l’aide d’un appareil d’IRM, on enregistre en rafale pendant un court laps de temps des milliers de clichés, et à partir de ceux-ci on reconstitue le « film » du déplacement spontané des molécules d’eau. Cette technique est de ce fait particulièrement sensible aux mouvements du sujet.
Dans le cerveau, les molécules d’eau se diffusent préférentiellement le long des faisceaux de fibres enrobées de myéline qui forment la matière blanche. En calculant les directions principales de diffusion de ces molécules dans la matière blanche, on peut reconstituer le trajet probable des faisceaux de fibres reliant les différentes régions du cortex entre elles et avec les régions sous-corticales, et sur cette base élaborer une image de tractographie telle que celle reproduite ci-dessous (Fig. 2).
Ces faisceaux correspondent en quelque sorte aux grandes autoroutes de l’information : loin de permettre de reconstituer le réseau des millions de milliards de connexions entre neurones du cerveau, cette technique ne permet en particulier pas d’appréhender la connectivité locale à l’intérieur de la matière grise.
Un faisceau de fibres reliant deux régions peut être constitué de projections de la première vers la seconde, de projections en sens inverse, ou d’un mélange des deux en proportions variables. L’usage de cette technique, qui ne permet pas de déterminer la direction des connexions, interdit donc toute interprétation en termes de « connexions de […] vers […] ».
Le nombre de faisceaux de fibres varie selon divers paramètres, notamment la résolution de l’image et les algorithmes utilisés aux différentes étapes de sa fabrication. Par ailleurs, on ne sait pas combien il y a d’axones, c’est-à-dire de véritables connexions neuronales, à l’intérieur d’un faisceau donné. Pour estimer la « force » de la connectivité entre deux régions du cerveau, c’est-à-dire à quel point elles sont « fortement » connectées, les chercheurs se sont donc basés sur une mesure indirecte : le volume apparent occupé par les faisceaux reconstitués. Ils ont considéré que le nombre de fibres passant dans une zone donnée de l’image était égal à 2 par pixel de l’image en 3D obtenue, un pixel correspondant ici à un cube de 1.9 x 1.9 x 2.0 mm. Avec cette technique, la densité des connexions est ainsi surestimée ou sous-estimée selon l’épaisseur de la gaine de myéline entourant les axones et selon le volume disponible faisant que les connexions sont plus ou moins densément serrées les unes contre les autres.
Construction d’un connectome arbitraire parmi une infinité de possibles, encore plus grossier et incertain
Le terme « connectome » a été créé en 2005. Désignant au départ la description complète de la connectivité structurelle du système nerveux d’un organisme, il est désormais utilisé pour désigner de manière plus large tout plan des connexions structurelles ou fonctionnelles établi à une échelle donnée. Le connectome d’un cerveau à l’échelle microscopique est le plan détaillé de toutes les connexions existant entre ses neurones. Un tel plan étant pour l’instant, et sans doute pour longtemps encore, impossible à établir pour un cerveau humain, les connectomes de cerveau qui sont élaborés par les chercheurs sont macroscopiques. Différentes techniques existent pour ce faire : on peut par exemple construire un connectome macroscopique à partir de données d’IRM fonctionnelle plutôt que d’IRM de diffusion, ce qui donnera des résultats différents. Notons au passage que les chercheurs disposaient ici de données d’IRMf, dont l’utilisation permet d’appréhender plus directement les relations fonctionnelles entre zones cérébrales ainsi que le sens des connexions et leur type (excitatrice vs inhibitrice). Ils ont d’ailleurs publié dans Satterthwaite et al (2013b) les résultats d’une analyse faite sur cette même cohorte de jeunes (n’intégrant pas de comparaison entre groupes de sexes) basée sur la construction d’un connectome issu de ces données d’IRMf. Pourquoi avoir choisi de n’exploiter que les données d’IRM de diffusion pour faire la comparaison filles/garçons, et une différence aurait-elle (ou a-t-elle) été trouvée entre connectomes fonctionnels ? Impossible à dire, les auteurs passant complètement sous silence cette question.
Pour l’article en question ici, ils ont construit pour chaque sujet un connectome structurel macroscopique correspondant à une modélisation de son cerveau sous la forme d’un réseau virtuel constitué de nœuds reliés par des arêtes. Pour construire ce réseau virtuel macroscopique, ils ont d’abord parcellisé le cerveau en régions et posé qu’à chacune d’elles correspondait un nœud. La méthode de parcellisation du cerveau et sa finesse sont variables selon les études employant cette méthode. On définit typiquement entre 50 et 120 régions (et donc nœuds) lorsqu’on utilise l’un ou l’autre des atlas existants basés sur des considérations anatomiques ou venues de l’imagerie fonctionnelle, mais jusqu’à plusieurs milliers lorsque la parcellisation est faite de manière automatique. Les connectomes basés sur des parcellisations différentes d’un même cerveau peuvent avoir des propriétés très différentes, et on ne sait pas à ce jour dans quelle mesure cela reflète une variabilité des propriétés du réseau de connexions physiques réelles selon l’échelle à laquelle il est considéré ou s’il s’agit simplement d’un artefact méthodologique (cf Reus et van den Heuvel, 2013).
Ici, les auteurs ont choisi de parcelliser le cerveau en 95 régions au total. Pour le cortex, ils ont utilisé un atlas existant parcellisant chaque hémisphère du cortex en 34 régions, définissant ainsi 68 régions. Ils ne disent pas comment ils ont procédé pour partitionner le reste du cerveau en 27 régions, l’atlas auquel ils renvoient dans l’article pour plus de détails s’avérant ne traiter que du cortex. Les données présentes dans l’article permettent de comprendre que 2 de ces 27 régions correspondent au cervelet (hémisphère droit et gauche), 2 au noyau caudé et 2 au putamen, et qu’ils ont considéré une seule région inter-hémisphérique. Pour les 20 restantes, on ne peut que supposer qu’il y avait au minimum le thalamus (x2), le pallidum (x2), le noyau accumbens (x2), l’hippocampe (x2) et l’amygdale (x2), comme dans d’autres études ayant comme ici utilisé l’application Freesurfer (ex : van den Heuvel et Sporns, 2011 ; Lim et al, 2014), mais je ne sais pas ce qu’étaient les 10 autres (j’ai posé la question à l’auteure correspondante, et pour toute réponse elle m’a fait savoir qu’elle n’avait pas le temps d’y répondre).
Une fois cette liste de nœuds définie, la méthode de construction du réseau a consisté à calculer, pour chacun des 95×95 couples de régions (Ri, Rj), la probabilité que chaque fibre théorique (localisée et « comptée » comme on l’a vu plus haut à partir des données de l’IRM de diffusion) touche à la fois Ri et Rj. Notons qu’il y a sans doute eu à cette étape une nouvelle déperdition d’information dont l’article de PNAS ne rend pas compte. A titre indicatif, van den Heuvel et Sporns (2011) utilisant une méthode similaire rapportent que 47% des fibres théoriques n’ont pu être affectées à un couple de régions soit parce qu’elles n’en touchaient qu’une, soit parce qu’elles traversaient la matière blanche sans en toucher aucune.
Les auteurs auraient pu ne bâtir sur cette base qu’un connectome non pondéré, c’est-à-dire décider qu’au-delà d’un certain seuil de probabilité de présence de fibres reliant deux régions il existait une arête entre les deux nœuds correspondants et qu’en-deçà il n’en existait pas. C’est ce que certains chercheurs se contentent prudemment de faire, mais eux ont été plus ambitieux : ils ont attribué à chaque arête un « poids » censé représenter la « force » de la connexion entre les deux régions représentées par leurs nœuds respectifs. Il existe différentes méthodes pour ce faire, sans qu’il soit possible de savoir quelle est la bonne si tant est qu’il y en ait une (à mon avis ça n’est pas le cas, ou tout au moins ça dépend de ce qu’on souhaite analyser sur cette base). Par exemple, van den Heuvel et Sporns (2011) analysent conjointement quatre variables : la variable binaire ci-dessus (connexion présente/absente) et trois autres qui correspondent à trois manières différentes de pondérer les connexions dont ils expliquent les avantages respectifs. Ici, les auteurs ont utilisé une méthode différente des trois précédentes. Selon leurs termes, le poids qu’ils ont attribué à chaque arête représente une « probabilité conditionnelle normalisée de chemin » entre deux régions, mais il correspond en fait plutôt à une « surface théorique de connexion » entre deux régions, ce qui introduit à nouveau une variable dépendant du volume des régions considérées [10]. De plus, ils n’expliquent pas pourquoi ils ont choisi cette curieuse méthode. Ils indiquent seulement qu’elle était similaire à celles « trouvées dans d’autre études », citant à l’appui quatre études dont aucune n’a en réalité utilisé de méthode comparable, comme c’est le cas de toutes les études citées par ailleurs dans cet article [11]. Je trouve étrange qu’ils soient incapables de citer ne serait-ce qu’une étude ayant utilisé cette méthode de calcul ou même une méthode approchante, qu’ils citent des références censées étayer leur choix alors que c’est tout le contraire, et qu’ils ne justifient pas celui-ci.
Enfin, il faut noter qu’en raison de la nature probabiliste de la méthode de tractographie utilisée, ils ont sans doute trouvé un grand nombre d’arêtes ayant une probabilité non nulle d’exister bien qu’il n’existe en réalité pas de connexions cérébrales directes entre les régions correspondantes, comme c’est toujours le cas avec cette technique. Pour adresser ce problème, les chercheurs éliminent normalement les arêtes assorties d’une probabilité inférieure à un certain seuil de façon à obtenir un degré de connectivité global compatible avec ce qu’on sait de la connectivité anatomique réelle du cerveau au niveau de parcellisation considéré. C’est ce qui a par exemple été fait dans deux articles qu’ils citent : Gong et al (2009a) a fixé un seuil unique aboutissant à ne retenir que 329 arêtes sur les 3003 théoriquement possibles dans leur connectome, et Gong et al (2009b) a testé les différences entre les sexes pour 37 valeurs différentes de ce seuil, de manière à faire varier le nombre d’arêtes considérées d’environ 240 à 810 sur les 3003 théoriquement possibles. Il est dommage que les auteurs n’aient pas eu la rigueur de ces derniers, et il est très surprenant qu’ils n’aient même pas appliqué un seuil unique, ce qui semble être le cas car ils n’en font pas état.
En synthèse, la technique utilisée ne permet pas de voir le réseau des connexions entre neurones, mais seulement de reconstituer le tracé des voies neuronales reliant entre elles des zones relativement éloignées du cerveau. Le connectome que les chercheurs ont élaboré sur cette base nous éloigne plus encore de la réalité biologique. Il s’agit d’une modélisation partielle, probabiliste et très grossière de la véritable connectivité cérébrale, et d’une modélisation arbitraire : rien ne permet de penser que le mode de parcellisation choisi et le nombre de régions définies sont appropriés pour étudier la connectivité cérébrale. Par ailleurs, le poids attribué à chaque arête du connectome n’a qu’un rapport lointain avec la « force » réelle des connexions cérébrales qu’elle est censée représenter, et ce poids a été calculé d’une manière inusuelle dont le choix n’est pas justifié. Enfin, divers facteurs tels que le mouvement du sujet au moment de l’enregistrement de l’image, l’épaisseur des gaines de myéline qui entourent ses connexions cérébrales et le volume de sa boîte crânienne sont susceptibles de faire varier les propriétés du connectome qui ont servi à comparer filles et garçons.
PAS D’INVERSION DES RATIOS DE CONNECTIVITE INTER-/INTRA-HEMISPHERES SELON LE SEXE
Les connectomes sont habituellement analysés à l’aide des outils de la théorie des graphes, en calculant diverses propriétés mathématiques qu’il est du reste souvent très délicat d’interpréter en termes de caractéristiques du cerveau ou de son fonctionnement [12]. Ici, les auteurs ont choisi de comparer la moyenne obtenue sur chaque groupe de sexe de chacun des « poids » des arêtes (« analyse par connexion »), ainsi que les moyennes de cinq propriétés des connectomes dont deux seulement correspondant à des propriétés standards de la théorie des graphes.
Les résultats de ces comparaisons ont souvent été interprétés comme montrant chez les filles une dominance de la connectivité inter-hémisphérique par rapport à la connectivité intra-hémisphérique, et une dominance inverse chez les garçons (voire carrément, comme le laisse entendre la dépêche AFP, comme montrant que les femmes n’auraient que des « branchements » reliant les deux hémisphères au contraire des hommes pourvus d’un « grand nombre de branchements » dans chaque hémisphère). Les comptes-rendus les plus précis ont également signalé que ce constat ne valait pas pour le cervelet, où ces différences seraient inversées.
Ainsi, selon le chapeau de l’article publié sur Atlantico, l’étude « montre que le cerveau d’un homme a plus de connexions à l’intérieur des hémisphères, alors que le cerveau d’une femme a plus de connexions entre les hémisphères », ce que confirme Jean-Paul Mialet dans le corps de l’article : « Après moyennage des données, les faisceaux de connexion du cerveau masculin apparaissent longitudinaux, s’étendant d’avant en arrière dans chaque hémisphère, alors que dans le cerveau féminin, les faisceaux apparaissent transversaux, interconnectant les deux hémisphères ». Selon la journaliste d’AuFéminin.com, « Chez ces messieurs, les résultats de cette étude montrent une plus grande connectivité neuronale entre le devant du cerveau, siège de la coordination de l’action, et l’arrière, où loge le cervelet, source de l’intuition. Chez les femmes, c’est la connexion entre l’hémisphère droit, où siège la capacité d’analyse et de traitement de l’information, à l’hémisphère gauche, centre de l’intuition, qui prime ». De même, Le Quotidien du Médecin explique : « Au niveau anatomique, les images établissent que chez les hommes, les connexions intrahémisphériques sont plus fournies. Chez les femmes, à l’inverse ce sont les connexions entre les deux hémisphères qui prédominent. Et c’est l’inverse au niveau du cervelet ». Dans le même sens, Futura-Sciences précise : « Si l’on se focalise uniquement sur les branchements, ils s’orientent différemment selon le genre. Pour les hommes, ceux-ci sont plus denses au sein d’un même hémisphère, donc pour des liaisons d’avant en arrière. Chez les femmes, en revanche, les trajectoires perpendiculaires sont renforcées, car elles disposent de davantage de connexions entre chacun des hémisphères. […] L’analyse globale révèle que chez les hommes, l’information passe bien entre le cortex frontal […] et le cervelet […]. À l’intérieur de cette structure, les scientifiques ont malgré tout observé de nombreuses connexions d’un hémisphère à l’autre. […] Les femmes quant à elles montrent davantage de câblages entre l’hémisphère droit […] et son homologue de gauche ». Maxisciences s’est distingué par son insistance sur l’inversion dans le cervelet : « Au niveau de cette structure cérébrale également divisée en deux hémisphères, c’est l’inverse qui a été observé : les hommes montraient plus de connexions entre les hémisphères et les femmes davantage de connexions à l’intérieur des hémisphères, renforçant encore la conclusion au niveau des aptitudes de chacun ».
L’examen attentif des résultats rapportés par les auteurs montre qu’il n’en est rien. Voici leur description, dans laquelle je pointe en passant quelques problèmes supplémentaires.
Analyse par « connexion» (par arête)
La première comparaison entre filles et garçons correspond à ce que les auteurs ont appelé « analyse par connexion ». Ils ont d’abord calculé à l’intérieur de chaque groupe de sexe la moyenne des « poids » des 4465 arêtes pouvant en théorie relier deux nœuds différents du connectome. Ensuite, ils ont comparé ces deux poids moyens pour chaque arête et identifié celles pour lesquelles ils différaient de manière statistiquement significative après correction pour comparaisons multiples [13]. Signalons que le test statistique assez particulier qu’ils ont utilisé pour décider de la significativité d’une différence était plus à risque de faire émerger des différences en fait inexistantes (dans la population censée être représentée par cet échantillon) que celui utilisé dans d’autres études, y compris des études qu’ils citent ici et y compris par eux-mêmes dans un autre article [14].
Il résulte de cette première comparaison trois différences exprimées en ces termes par les auteurs : dans la partie du cerveau située au dessus du cervelet (région supratentoriale), la plupart des arêtes de poids moyen chez les garçons plus lourd que le poids moyen chez les filles étaient intra-hémisphériques et la plupart des arêtes de poids moyen chez les filles plus lourd que le poids moyen chez les garçons étaient inter-hémisphériques ; par ailleurs, le poids moyen des arêtes entre hémisphère gauche du cervelet et hémisphère droit du cortex était plus lourd chez les garçons que chez les filles.
Aucune de ces trois différences n’est quantifiée : on ne connaît ni le nombre ou pourcentage des arêtes existantes pour lesquelles ils ont trouvé une différence entre les sexes, ni l’ampleur des écarts entre les poids. Le seul élément quantitatif précis pouvant être déduit du l’illustration fournie par les auteurs est que seules deux arêtes ayant une extrémité dans le cervelet et reliant l’hémisphère opposé étaient en moyenne plus lourdes chez les garçons que chez les filles, que les garçons avaient aussi deux arêtes en moyenne plus lourdes ayant une extrémité dans le cervelet reliant le lobe pariétal du même hémisphère, et que les filles n’avaient aucune arête ayant une extrémité dans le cervelet en moyenne plus lourde que les garçons.
En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette première comparaison indique donc qu’en dehors du cervelet il y avait une plus grande connectivité inter-hémisphérique chez les filles que chez les garçons et une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles. En revanche, elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.
Ratio de connectivité hémisphérique (HCR) de chaque « lobe »
La seconde comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « ratio de connectivité hémisphérique » (HCR) de chaque lobe, un lobe correspondant à un regroupement de régions. L’emploi du terme « lobe » par les auteurs est pour le moins ambigu, car habituellement ce terme est utilisé uniquement pour désigner les lobes du cortex (frontal, temporal, pariétal et occipital gauches et droits, soit 8 lobes), mais des éléments de l’article [15] indiquent qu’ils ont également considéré deux « lobes » correspondant aux hémisphères gauche et droit du cervelet, et peut-être deux « lobes » correspondant aux regroupements des 12 régions sous-corticales de chaque hémisphère (hors cervelet), la région sous-corticale située entre les deux hémisphères ayant a priori été laissée de côté pour l’analyse par lobe.
Ils ont défini le ratio de connectivité hémisphérique d’un lobe comme étant égal au nombre d’arêtes ayant une extrémité dans ce lobe et l’autre extrémité n’importe où dans le même hémisphère, divisé par le nombre d’arêtes ayant une extrémité dans ce lobe et l’autre extrémité n’importe où dans l’autre hémisphère. Ils ne disent pas pourquoi cette comparaison a été faite sur la base du connectome non pondéré, c’est-à-dire en comparant les nombres d’arêtes plutôt que leurs poids, à la différence des cinq autres comparaisons. On suppose que pour ce calcul comme pour les quatre exposés ci-après, ils ont pris en compte non seulement les 4465 arêtes entre nœuds différents mais aussi les 95 arêtes reliant chaque nœud avec lui-même, bien que ça ne soit pas précisé.
Ils rapportent que la moyenne de ce ratio était plus grande chez les garçons que chez les filles dans les lobes frontaux, temporaux et pariétaux du cortex, ne disant pas ce qu’il en était pour les autres lobes, ce qui suggère qu’il n’y avait pas de différences (cf Table 2 ci-dessous). On note que même dans l’hypothèse où le cervelet aurait en fait été inclus dans le lobe occipital et non considéré comme un lobe à part, les résultats ne montreraient pas de différence entre filles et garçons pour cette mesure.
En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, disons que cette comparaison indique que le ratio connectivité intra-hémisphérique / connectivité inter-hémisphérique était en moyenne plus grand chez les garçons que chez les filles sauf dans le lobe occipital (arrière du cerveau) où il n’était pas différent. Elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.
Poids de connectivité lobaire (LCW) de chaque « lobe »
La troisième comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « poids de connectivité lobaire » (LCW) de chacune des paires de « lobes » différents ou identiques. Le poids de connectivité d’une paire de lobes a été défini par eux comme étant égal à la somme des poids des arêtes connectant une région de l’un à une région de l’autre. Les auteurs ne disent à nouveau pas ce qu’ils entendent exactement par « lobe », mais on comprend qu’ils ont au minimum comparé garçons et filles pour les 36 paires de lobes du cortex (24 paires de lobes différents et les 8 paires de lobes identiques). Ils ne précisent pas qu’ils ont fait une correction pour comparaisons multiples, ce qui suggère qu’ils ne l’ont pas faite.
Ils rapportent dans le texte de l’article que le poids de connectivité lobaire était en moyenne plus grand chez les garçons que chez les filles pour les paires de lobes situés à l’intérieur d’un même hémisphère, et qu’il était en moyenne plus grand chez les filles que chez les garçons entre les lobes frontaux gauche et droit. En présentant autrement leur table listant les paires pour lesquelles ils ont trouvé une différence statistiquement significative entre les sexes, on remarque notamment qu’ils n’ont pas trouvé de différence pour les connexions entre lobe frontal et lobe occipital, qu’il y avait une différence pour seulement 19 paires de lobes du cortex sur 36, et qu’il y avait une différence pour une seule paire inter-hémisphérique sur 16 (cf Table 3 ci-dessous).
En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette comparaison indique encore une fois une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles, quoique pas partout et en particulier pas pour les connexions à longue distance reliant l’avant et l’arrière du cortex, et une plus grande connectivité inter-hémisphérique chez les filles que chez les garçons (quoique très localisée puisque trouvée seulement dans le lobe frontal). Elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.
Coefficient de participation (PC) de chaque nœud du connectome
La quatrième comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « coefficient de participation » (PC) de chacun des 95 nœuds du connectome (ou 94 si le nœud inter-hémisphérique n’a été attribué à aucun « lobe »). Le coefficient de participation d’un nœud correspond, via une formule bizarre difficile à traduire en termes simples, à une fonction du poids total des arêtes connectant ce nœud rapporté au poids total des arêtes le connectant à des nœuds du même lobe.
Les auteurs indiquent dans le texte de l’article que ce coefficient est « proche de 1 si les connexions du nœud sont distribuées uniformément dans tous les lobes et égal à 0 si toutes restent à l’intérieur de son lobe d’appartenance ». Cependant, le paragraphe détaillant la méthode de calcul montre qu’il mesure la répartition non des connexions mais du poids des arêtes, et qu’il n’adresse pas la question de l’uniformité de cette répartition : un coefficient de participation faible indique seulement qu’au niveau du nœud considéré, le poids de la connectivité avec d’autres lobes est « réduit » et/ou le poids de la connectivité à l’intérieur de son propre lobe est « accru ». Par ailleurs, la précision de l’intervalle des valeurs possibles [0 à 1] ne s’accompagne d’aucune précision concernant les valeurs effectivement observées. Notons également qu’ils n’ont manifestement pas fait de correction pour comparaisons multiples, ce qui était pourtant nécessaire [16].
Ils rapportent avoir trouvé que « de nombreuses régions dans les lobes frontaux, pariétaux et temporaux avaient un PC significativement supérieur chez les filles que chez les garçons, tandis que le cervelet était la seule région ayant un PC supérieur chez les garçons ». En examinant les données détaillées dans leurs figure 3 et table 3, on remarque qu’ils n’ont pas trouvé de différence dans le lobe occipital, qu’il y avait une différence pour seulement 16 nœuds de l’hémisphère gauche sur 47 (dont 1 correspondant au cervelet et 2 à des régions sous-corticales, le noyau caudé et le putamen) et 14 nœuds de l’hémisphère droit sur 47 (dont 1 correspondant au cervelet et 2 aux mêmes régions sous-corticales), et que les deux nœuds correspondant aux hémisphères gauche et droit du cervelet sont effectivement les seuls pour lesquels la différence est en faveur des garçons. En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette comparaison n’apporte cependant aucune information.
Modularité et transitivité pondérées
La cinquième comparaison a porté sur la modularité moyenne des connectomes, une quantification de la mesure dans laquelle un réseau de nœuds peut-être divisé en regroupements faiblement interconnectés de nœuds intensément interconnectés. L’intensité de cette connectivité a été définie ici en tenant compte du poids des arêtes. Les auteurs rapportent avoir trouvé que la modularité moyenne globale (un seul chiffre) était supérieure chez les garçons.
La dernière comparaison a porté sur la transitivité moyenne des connectomes, une quantification de la propension du connectome à contenir des triangles, c’est-à-dire de la propension des nœuds à être connectés aux nœuds connectés à ceux avec lesquels ils le sont. Comme pour la précédente propriété, le calcul tient compte du poids des arêtes. Les auteurs rapportent avoir trouvé que la transitivité moyenne était supérieure chez les garçons dans le cerveau pris globalement, et qu’elle l’était également dans les lobes frontaux gauches et droit et temporaux gauches et droits. Ils indiquent que ces résultats sont compatibles avec l’idée d’une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles, et que le dernier suggère une plus grande connectivité intra-lobes chez les garçons que chez les filles.
Notons que ces deux comparaisons ne donnent ni information en termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, ni information sur le cervelet en particulier, et que les auteurs n’ont pas trouvé de différence entre les sexes dans la transitivité de 4 des 8 lobes considérés. Il convient également de souligner que bien que les auteurs décrivent la transitivité comme quantifiant l’intensité des connexions que les nœuds entretiennent avec leur « voisins » et que ces résultats sont « indicatifs d’une connectivité locale, à courte portée » accrue chez les garçons relativement aux filles, la notion de « voisin » telle qu’elles est définie dans un graphe ne renvoie en fait pas du tout à une notion de proximité physique : deux nœuds sont « voisins » s’ils sont directement reliés entre eux par une arête, même si les régions qu’ils représentent sont physiquement très éloignées dans le cerveau.
En synthèse, tous les extraits de la vulgarisation de cette étude cités plus haut affirment des choses qui ne correspondent à aucune des données rapportées dans l’article : on ne sait ni si les connexions intra-hémisphériques « prédominaient » (pour autant que cette notion puisse être définie) sur les connexions inter-hémisphérique chez les garçons, ni si c’était l’inverse chez les filles, et on ne voit pas d’ « inversion » dans le cervelet de ce qui a été observé dans la région supratentoriale. Mais pourtant, vous demandez-vous peut-être, ces caractéristiques n’apparaissent-elles pas clairement sur les images qui ont été diffusées ? Le « connectome masculin » n’est-il pas rempli de lignes bleues représentant les connexions intra-hémisphériques, avec presque pas de lignes oranges représentant les connexions inter-hémisphériques, et le connectome féminin inversement rempli d’orange avec presque pas de bleu ?
DES IMAGES QUI NE REPRESENTENT PAS DU TOUT CE QU’ON A DIT
C’est en effet ce que laissent croire ces images aux lignes bleues et oranges qui semblent avoir été comprises au mieux comme montrant d’un côté les principales connexions cérébrales chez les sujets masculins de l’étude et de l’autre celles chez les sujets féminins, au pire comme montrant d’un côté les connexions cérébrales dans le cerveau masculin typique et de l’autre celles dans le cerveau féminin typique.
Sur les vingt et un items de vulgarisation ou commentaire que j’ai analysés contenant une reproduction de ces images, dans quatre cas elles étaient non légendées (Les Nouvelles News, Santé Log, Médias-Presse-Info, Psycho Media) et dans tous les autres la légende était inappropriée (voir Annexe 5). Certains ont en outre particulièrement insisté sur ces images comme si elles étaient décisives et en renforçant leur interprétation erronée, tels L’Express et Sébastien Bohler dans Pour La Science et sur SciLogs. Afin de s’assurer que ces images étaient interprétées comme il se devait, voici en effet ce que ce dernier a expliqué : « Le cerveau du haut représente en bleu les connexions internes repérées sur 428 hommes. Les connexions sont “verticales”, et courent principalement à l’intérieur de chaque hémisphère. Le cerveau du bas représente en orange les connexions internes repérées sur 521 femmes. Elles sont majoritairement “horizontales”, reliant entre eux les deux hémisphères cérébraux. […] Ceci est l’image de deux cerveaux, l’un masculin, l’autre féminin (une vue de dessus, une vue de côté). […] Les différences sont tellement visibles qu’elles sautent aux yeux. Chez l’homme : câblage principalement de haut en bas sur le cliché A, c’est-à-dire à l’intérieur de chaque hémisphère cérébral (moitié de cerveau). Chez la femme, câblage plus transversal, de gauche à droite, connectant les deux hémisphères entre eux. ». Le hic, c’est que ces images ne montrent pas du tout cela.
Notons tout d’abord que les auteurs ne rapportent à aucun moment l’existence de connexions présentes au moins chez certains individus d’un groupe de sexe et absentes chez tous ceux de l’autre groupe, et nul doute que s’ils avaient trouvé une telle différence structurelle ils l’auraient signalée. En d’autres termes, s’ils avaient montré les connectomes en représentant une arête dans le « connectome moyen » d’un groupe de sexe dès lors qu’elle avait un poids moyen non nul dans ce groupe, on aurait sans doute pu constater que celui des garçons était identique à celui des filles.
Pour fabriquer les fameuses images, les chercheurs ont en fait passé en revue chacune des 4465 paires de nœuds du connectome et utilisé les résultats de leur « analyse par connexion » (cf supra) comme suit : si le poids moyen de l’arête correspondant à cette paire était statistiquement supérieur chez les garçons, ils ont dessiné un trait la représentant dans les images du haut étiquetées « males » ; s’il était statistiquement supérieur chez les filles, ils ont dessiné un trait la représentant dans les images du bas étiquetées « females » ; si les moyennes n’étaient pas significativement différentes, ils n’ont dessiné aucun trait. Voir ci-dessous les images et leur légende corrigée par mes soins (Fig. 4).
Un exemple fictif simple permet de bien saisir la différence entre ce que représentent ces images et ce que leurs commentateurs ont dit ou suggéré qu’elles représentaient. Imaginons que les chercheurs aient mesuré la taille des yeux, de la bouche, du nez et des oreilles rapportées à la surface du visage dans un échantillon d’hommes et de femmes. Imaginons qu’ils aient trouvé que les yeux étaient en moyenne un peu plus grands chez les femmes, la bouche un peu plus grande chez les hommes, et que les autres mesures n’étaient pas significativement différentes. Ils auraient alors représenté un visage étiqueté « femmes » n’ayant que des yeux et un visage étiqueté « homme » n’ayant qu’une bouche, leur texte accompagnant ces images permettant de comprendre comment elles avaient été obtenues. Et voici ce qu’en auraient dit les vulgarisateurs de l’étude, ne remarquant pas l’absence d’oreilles et de nez : « Ceci est le cliché de deux visages moyens, l’un masculin obtenu sur 428 hommes, l’autre féminin obtenu sur 521 femmes. Les différences sont tellement visibles qu’elles sautent aux yeux : les femmes ont des yeux et pas de bouche, et c’est l’inverse chez les hommes. Cette étude semble confirmer scientifiquement certains stéréotypes et la complémentarité remarquable de l’homme et de la femme : elle est conçue pour observer et se taire, lui est optimisé pour parler sans se préoccuper de ce qui l’entoure. »
DES DIFFERENCES INFIMES AU REGARD DE LA VARIABILITE INDEPENDANTE DU SEXE
Les auteurs et les médias ont beaucoup insisté sur le fait que les connectomes des hommes et des femmes étaient « très différents », voire « complémentaires », allant jusqu’à affirmer pour certains que l’étude montrait que le cerveau « a un sexe ». Les connectomes étaient pourtant au contraire très similaires, et en particulier inaptes à permettre de prédire le sexe d’une personne.
Rappelons tout d’abord que les auteurs ne rapportent aucune différence qualitative dans la structure du connectome, c’est-à-dire en termes d’arêtes parfois ou toujours présentes dans un groupe de sexe mais pas dans l’autre. Les seules différences rapportées sont des différences quantitatives issues de la comparaison des poids des arêtes : ce n’est qu’en comparant leur moyenne chez les filles à leur moyenne chez les garçons que les auteurs ont mis en évidence des différences statistiquement significatives. Rappelons également que les six comparaisons entre filles et garçons réalisées par les auteurs correspondent à celles de très nombreuses valeurs (dont plusieurs centaines pour l’analyse par connexion et près de 100 pour le coefficient de participation), et les auteurs n’ont trouvé de différence significative que pour un sous-ensemble d’entre elles (dont pas plus d’une centaine pour l’analyse par connexion et 30 pour le coefficient de participation). Mais le plus important n’est pas là.
Quand bien même ils auraient trouvé une différence moyenne statistiquement significative ne serait-ce que pour une seule arête du connectome, ça pourrait être important si elle était signifiante [17]. Les différences significatives rapportées dans l’article sont-elle signifiantes ? A défaut d’information sur leur signification concrète (par exemple comment cela se traduirait éventuellement en différences en nombre de connexions cérébrales réelles) ou sur leur impact éventuel (par exemple comment cela se traduirait en différences d’efficacité de la collaboration entre telles régions du cerveau, voire de performance à tel test), on ne peut juger de leur signifiance qu’à l’aune de la variabilité observée dans chaque groupe. Cela se traduit par des questions telles que : y a-t-il beaucoup plus de garçons que de filles dont le connectome est plus proche de celui du « garçon moyen » que de celui de la « fille moyenne » ? Une paire fille-garçon tirée au hasard a-t-elle beaucoup plus que 50% de chances de présenter une différence allant dans le sens de la différence moyenne observée qu’une différence en sens inverse ? La variabilité interindividuelle des connectomes dépend-t-elle beaucoup du sexe des sujets ? Il est impossible de quantifier précisément la réponse à ces questions car les auteurs n’ont pas fourni les éléments nécessaires. On peut cependant calculer des valeurs indicatives de la taille d’effet du sexe et de la part de variance indépendante du sexe pour les différences rapportées dans l’article, et le résultat indique que la réponse aux questions ci-dessus est très clairement négative (cf Table 4 ci-dessous).
On constate en effet que la différence entre les sexes de plus grande ampleur rapportée dans tout l’article (celle dans le « poids de la connectivité lobaire » entre lobes frontal et pariétal droits, en moyenne plus grand chez les garçons) a une taille d’effet qui selon les conventions d’interprétation en usage correspond à une différence de taille « petite » à « moyenne ». Elle est par exemple nettement plus petite que la différence moyenne de stature entre hommes et femmes (que personne, je pense, n’aurait l’idée de qualifier de complémentarité). La représentation graphique de cette différence sous forme de distributions théoriques montre un important recouvrement entre les sujets des deux groupes de sexe, un nombre non négligeable de garçons ayant un « poids de connectivité entre lobes frontal et pariétal droit » plus petit que la « fille moyenne » ; plus de 94 % de la variabilité interindividuelle de ce poids apparaît indépendante du sexe (voir Table 4 ci-dessus, ligne sur fond bleu).
En ce qui concerne la seule différence significative en termes de connectivité intra-hémisphérique rapportée dans l’article, à savoir le « poids de la connectivité lobaire » entre lobes frontaux gauche et droit en moyenne plus grand chez les filles, le recouvrement des distributions théoriques des deux groupes est encore plus frappant, et près de 98 % de la variabilité de ce poids est indépendante du sexe (voir Table 4, première ligne).
En fait, la grande taille de l’échantillon tant vantée par les auteurs et par certains commentateurs enthousiastes a un inconvénient : elle permet de rendre statistiquement significatives des différences d’ampleur insignifiante. Concrètement, les résultats rapportés dans l’article ne mettent en évidence aucune différence structurelle et montrent que sur l’ensemble des comparaisons faites par les chercheurs, les filles et les garçons étaient en moyenne soit non statistiquement différents, soit très peu différents au regard de l’ampleur des variations existant indépendamment du sexe. Outre que ce constat contredit l’interprétation qui a été faite de cette étude, la faible taille des effets apparents du sexe rend ceux-ci très fragiles : il suffirait d’un léger biais non corrigé dans l’analyse statistique pour les annuler, ce qui nous amène au point suivant.
L’OUBLI FACHEUX DE TENIR COMPTE DE FACTEURS DE CONFUSION
J’en viens maintenant à la description d’un défaut saillant de la méthode d’analyse statistique employée par les auteurs lorsqu’ils ont comparé le groupe des filles au groupe des garçons : ils avaient à leur disposition au moins cinq variables dont il aurait fallu systématiquement contrôler les effets, ce qu’ils n’ont pas fait.
Mouvement lors de l’acquisition des images d’IRM de diffusion
Les auteurs disposaient d’une mesure du mouvement de la tête de chaque jeune durant l’enregistrement des données d’IRM, et ils savaient parfaitement que ce paramètre, dont ils ont tenu compte dans un autre article, était susceptible de biaiser les propriétés d’un connectome construit à partir de ce type de données [18]. Concernant spécifiquement les connectomes construits à partir de données d’IRM de diffusion, Yendiki et al (2013) a ainsi rapporté que de modestes différences de mouvement pouvaient causer de fausses différences entre groupes au niveau de leurs connectomes moyens. Il est donc aussi étonnant que regrettable que les auteurs n’aient pas tenu compte de ce paramètre ici. S’il n’y pas de raison de penser a priori qu’il y a eu une grosse différence entre groupes de sexe pour ce paramètre, l’échantillon est suffisamment grand pour que même un très faible de biais de sexe dans le degré d’immobilité à l’intérieur de l’appareil ait pu donner lieu à des différences statistiquement significatives au niveau des connectomes.
Âge
Selon Satterthwaite et al (2013b), article déjà cité publié par nos auteurs, dans la plage d’âge considérée ici les connexions entre régions éloignées tendent à se renforcer avec l’âge alors que les connexions de courte portée tendent à s’affaiblir (ils citent trois études à l’appui de cette assertion, et concluent que leur propre étude confirme cette idée bien que l’effet soit moins net après prise en compte du paramètre mouvement évoqué ci-dessus). Comme on l’a vu, l’échantillon utilisé pour la présente étude était légèrement biaisé en termes d’âges, les filles étant en moyenne un peu plus âgées que les garçons. Il était par conséquent impératif de contrôler ce paramètre afin de ne pas fausser la comparaison des deux groupes, or curieusement ils disent l’avoir fait pour l’analyse par connexion et le « poids de connectivité lobaire » (LCW), mais ni pour le « ratio de connectivité hémisphérique » (HCR), ni pour le « coefficient de participation » (PC), ni pour la modularité, ni pour la transitivité.
Stade de développement pubertaire ou de croissance
Durant l’enfance et l’adolescence, la matière blanche du cerveau est l’objet d’un processus de la maturation caractérisé notamment par une tendance à l’augmentation du diamètre des axones (les fibres nerveuses dont la technique utilisée ici essaie de rendre compte) et de l’épaisseur des gaines de myéline qui les entourent (à la surface desquelles le molécules d’eau se diffusent, définissant les contours utilisés pour reconstituer des faisceaux de fibres théoriques et estimer leur nombre). Selon Giedd et al (2012), article dont l’auteur principal est résolument engagé dans la recherche de corrélats biologiques de différenciation du cerveau liés au sexe, le volume de matière blanche augmenterait même plus rapidement chez les garçons à l’adolescence (il précise que les facteurs causaux de cette différence ne sont pas élucidés, et qu’on ne sait pas s’il faut l’attribuer à une augmentation plus rapide de l’épaisseur des gaines de myéline, à celle du diamètre des axones ou à autre chose).
Du fait des modalités de construction des connectomes comparés ici, ce processus de maturation est fort susceptible d’avoir un impact sur leurs propriétés. C’est justement ce que rapporte un article cité par les auteurs eux-mêmes : Hagmann et al (2010) ont observé qu’au fil de ce processus de maturation, certaines propriétés des connectomes évoluaient régulièrement sur leur échantillon de sujets âgés de 2 à 18 ans. Ils mettent notamment en évidence une évolution qu’ils interprètent en termes de maturation plus précoce des connexions entre régions éloignées du cortex qu’entre régions proches.
Pire, dans Satterthwaite et al (2013a), article déjà cité publié par nos auteurs, ils soulignent eux-mêmes que « de multiples études ont montré que la maturation du cerveau peut dans certains cas être plus fortement associée à la puberté et au développement sexuel qu’à l’âge chronologique » (p. 16252, ma traduction), et pour cette analyse-là ils ont en conséquence testé l’association statistique non seulement avec l’âge, mais aussi avec le stade pubertaire. Il est donc à nouveau étonnant et regrettable que les auteurs n’aient pas contrôlé cette variable dans le présent article. C’est d’autant plus gênant qu’en l’occurrence, comme on la vu, il y avait dans leur échantillon un énorme biais de sexe en termes de stade de développement pubertaire.
Appartenance ethnique déclarée
Comme on l’a vu également, il y avait aussi un gros biais de sexe en termes d’appartenance ethnique déclarée par les sujets de leur échantillon. Cette appartenance est susceptible d’être partiellement corrélée avec des caractéristiques sociales, culturelles ou biologiques de nature à avoir un impact soit sur la trajectoire développementale de la connectivité cérébrale, soit sur sa mesure indirecte et imparfaite effectuée ici. Du reste, les auteurs l’ont jugée suffisamment importante non seulement pour décrire de façon détaillée dans l’article la répartition par « race » des sujets, mais aussi pour contrôler cette variable lorsqu’ils ont calculé les différences entre les sexes dans le « poids de connectivité lobaire » (LCW). Curieusement à nouveau, ils ne disent pas l’avoir fait pour les cinq autres comparaisons (analyse par connexion, HCR, PC, modularité et transitivité).
Différences de volume intracrânien et différences neuroanatomiques liées
Selon Giedd et al (2012), revue de la littérature sur les différences entre les sexes observées par IRM structurelle (dont le premier auteur est le principal contributeur à ce champ de recherches), la différence neuroanatomique la plus robuste observée entre les sexes est le volume total du cerveau, en moyenne plus grand d’environ 10% chez les garçons/hommes que chez les filles/femmes, « [l]es autres différences morphométriques dépendent de si, et le cas échéant comment, les volumes des sous-composants du cerveau sont rapportés au volume total du cerveau, les plus grandes tailles d’effet du sexe ayant été observées pour le noyau caudé, l’amygdale et l’hippocampe, et [sic] le cervelet » (p. 7-9, ma traduction), et dans la plage d’âges considérée il existe également des écarts entre garçons et filles dans les volumes moyens de matières grise et blanche. Nos auteurs l’écrivent eux-mêmes : « les personnes de sexe masculin ont un crâne plus grand, proportionnellement à leur plus grande taille, et un plus grand pourcentage de matière blanche, qui contient les fibres axonales enrobées de myéline, et de liquide céphalo-rachidien, tandis que les femmes ont un plus grand pourcentage de matière grise rapporté au volume intracrânien. […] De plus, les différences développementales dans la croissance des tissus suggèrent qu’il existe une différence anatomique entre les sexes durant la maturation, bien qu’aucun lien avec les différences comportementales observées n’ait été établi » (Ingalhalikar et al, p. 823, ma traduction).
Ces différences moyennes entre les sexes sont presque entièrement expliquées par la différence moyenne de taille de leur crâne ou de volume de leur cerveau. C’est en tout cas ce qu’on observe statistiquement, et c’est compréhensible : selon le volume intracrânien, les tissus cérébraux ont plus ou moins de place pour se développer et ils sont plus ou moins susceptibles de se densifier en réponse à cette contrainte selon leur type (matière grise vs matière blanche par exemple); par ailleurs, selon le volume du cerveau la demande énergétique pour le faire fonctionner, le coût de construction et de maintenance de ses connexions et les temps de conduction de l’information d’une extrémité à l’autre diffèrent toutes choses par ailleurs, ce qui induit des contraintes sur les propriétés de son « câblage ». De ce fait, la taille du crâne ou le volume du cerveau peuvent être corrélés avec diverses propriétés telles que le diamètre des axones, l’épaisseur des gaines de myéline, la densité de la matière grise ou encore la connectivité à longue distance qui sont toutes susceptibles d’avoir un impact direct sur les propriétés du connectome, et comme plusieurs critiques de cette étude l’ont souligné, des différences entre les sexes observées ici pourraient ainsi être dues à cette différence de taille du cerveau et non au sexe en propre [19].
Pour ma part, j’ai identifié un risque de biais supplémentaire lié à la méthode de calcul du « poids » des connexions choisie par les auteurs. En effet, ils le calculent de telle sorte qu’il dépend de la surface en valeur absolue des parcelles de cerveau considérées et du nombre total de fibres détectées dans chacune. En combinant cette méthode de calcul avec les biais possibles évoqués ci-dessus, on voit comment de fausses différences de « connectivité » ont pu être construites (voir la Figure 5 ci-dessous simulant la création de différences fictives de connectivité entre hémisphères gauche et droit).
Quoi qu’il en soit précisément, il est évident que la différence moyenne de taille du cerveau entre filles et garçons a interféré d’une manière ou d’une autre avec la mesure de leurs différences de « connectivité », et il est étonnant que les auteurs ne s’en soient pas souciés et n’évoquent même pas ce sujet. C‘est d’autant plus étonnant que dans Gong et al (2009b), Yan et al (2011) et Dennis et al (2013), études de connectomes structurels qu’ils citent en prétendant réévaluer leurs conclusions concernant les différences entre les sexes, les chercheurs ont quant à eux inclus ce paramètre dans l’équation de régression afin de ne pas confondre un éventuel effet propre du sexe avec celui de la taille du crâne ou du volume du cerveau [20].
En synthèse, s’il est bien-sûr impossible d’affirmer que les cinq variables qu’on vient de passer en revue (mouvement, âge, stade pubertaire, appartenance ethnique déclarée, volume intracrânien ou cérébral) expliquent les différences entre les sexes trouvées ici, il est tout aussi impossible qu’aucune d’elles n’ait interféré avec ces différences. Il est à la fois dommage et surprenant, puisque les auteurs savaient qu’elles pouvaient avoir un effet et puisqu’ils les avaient à leur disposition, qu’ils n’aient pas systématiquement contrôlé les quatre premières et calculé ce que serait l’effet statistique du sexe indépendamment de la cinquième.
DES OBSERVATIONS A CONFIRMER, D’ORES ET DEJA NON CONVERGENTES AVEC D’AUTRES
Comme on l’a vu, cette étude souffre de multiples faiblesses qui réduisent à la fois la généralisabilité de ses résultats et leur degré de certitude. Elle pourrait cependant être digne d’une certaine considération si elle venait couronner un ensemble d’études ayant comparé des connectomes féminins et masculins, peut-être tout aussi imparfaites individuellement mais formant dans leur ensemble un faisceau d’indices convergents.
Des résultats préliminaires, à répliquer et étendre
Les auteurs ne citent aucune étude de connectomes structurels ayant comparé les deux sexes à l’aide de la même méthodologie qu’eux, notamment en termes de modalités de parcellisation du cerveau, de mesures comparées et de mode de calcul de celles-ci, et je n’en ai trouvé aucune. Par conséquent, il s’agit d’une étude qu’on peut qualifier de préliminaire : tant qu’elle n’aura pas été répliquée, ses résultats ne sauraient être pris pour acquis, c’est-à-dire considérés comme valables de manière générale pour la tranche d’âge considérée (9-21 ans). Etablir ce résultat pour « les hommes et les femmes » en général nécessitera a fortiori de l’étendre, c’est-à-dire de la répliquer sur au moins un échantillon représentatif d’adultes.
Au-delà de ce premier point, on peut se demander si des études adressant une question différente mais néanmoins proche ont abouti à des conclusions convergentes. Les auteurs citant justement sept articles ayant rapporté l’étude de différences entre les sexes dans des connectomes structurels ou des « connectomes fonctionnels similaires » (p. 823), voyons si leurs données convergeaient avec celles de la présente étude.
Absences de convergence et divergences dans les sept études antérieures citées par les auteurs
1. Concernant Tomasi & Volkow (2012a), Ingalhalikar et al indiquent de manière sibylline que l’étude a « révélé des différences entre les sexes et des effets de l’interaction sexe x hémisphère ». Disons plutôt que cette étude sur 913 personnes a apporté de nouvelles données non conclusives à la question non résolue de savoir s’il existe des différences entre les sexes dans la latéralisation du fonctionnement cérébral, question traditionnellement mise en relation avec celle d’une éventuelle différence entre les sexes dans le volume des connexions inter-hémisphériques rapporté au volume total du cerveau ou dans la morphologie du corps calleux. Or je note qu’en ce qui concerne le cortex frontal, seule région pour laquelle Ingalhalikar et al ont trouvé une différence de connectivité inter-hémisphérique entre filles et garçons, les différences observées par Tomasi et Volkow suggèrent que certains réseaux de neurones à l’intérieur du cortex frontal sont au contraire en moyenne moins connectés entre hémisphères chez les femmes que chez les hommes (et que c’est l’inverse pour d’autres) [21]. Par ailleurs, la différence la plus « proéminente » selon Tomasi et Volkow a été trouvée dans le cortex temporal, leurs données suggérant une moindre connectivité inter-hémisphérique chez les hommes, alors qu’Ingalhalikar et al n’ont pas trouvé de différence sur ce point pour cette région.
2. Concernant Tomasi & Volkow (2012b), Ingalhalikar et al indiquent qu’il a révélé « une plus grande connectivité fonctionnelle locale chez les femmes que chez les hommes ». Sous l’hypothèse (la leur) qu’une plus grande connectivité fonctionnelle soit liée à une plus grande connectivité structurelle, il s’agirait donc d’un résultat plutôt opposé au leur. De fait, les données de cette étude menée sur 561 adultes suggèrent une connectivité locale en moyenne plus forte chez les femmes que chez les hommes à la fois globalement dans le cerveau et dans 22 des 27 régions d’intérêt considérées, les 5 autres ne présentant pas de différence entre les sexes [22]. De plus, les différences trouvées dans le cortex frontal supérieur, le cortex frontal médian et le corps du noyau caudé étaient parmi les plus grandes (t = 7.14 à 7.95), et la différence trouvée dans le cervelet la plus faible (t = 4.79). Tomasi et Volkow précisent : « Nos résultats sont cohérents avec la plus grande connectivité anatomique globale [i.e. dans l’ensemble du cerveau pris globalement] rapportée dans des études basée sur l’imagerie de diffusion », citant ici Gong et al (2009b).
3. Gong et al (2009b) est justement l’un des sept articles cités par Ingalhalikar et al, qui écrivent que cette étude a trouvé « une plus grande connectivité corticale globale » chez les femmes. Cette étude de connectomes structurels basés sur des données d’IRM de diffusion faite sur 95 adultes âgés de 19 à 85 ans a utilisé une parcellisation du cortex similaire (en 78 régions), le reste du cerveau n’ayant pas été étudié. Les chercheurs ont calculé le poids des arêtes par une méthode différente et quant à eux neutralisé l’effet de la taille du cerveau pour dégager l’effet propre du sexe. Ils ont trouvé des différences significatives entre les sexes sur leurs trois comparaisons : les connectomes des femmes avaient en moyenne une plus grande connectivité corticale globale, c’est-à-dire un plus grand « poids » (dans le sens donné par Ingalhalikar et al à ce terme) global de l’ensemble des arêtes du connectome, mais aussi une plus grande « efficacité globale » et une plus grande « efficacité locale » [23].
4 & 5. Iturria-Medina et al (2007) et Iturria-Medina et al (2008) sont cités par Ingalhalikar et al comme ayant rapporté l’existence de certaines caractéristiques globales dans « des connectomes structurels des [deux] genres » (sic). En fait, aucune de ces études portant respectivement sur 5 et 20 sujets n’adresse la question des différences entre les sexes, et le sexe des sujets n’est même pas indiqué dans ces deux articles (!).
6. Concernant Yan et al (2011), Ingalhalikar et al écrivent là encore de manière sibylline qu’il rapporte « des différences entre les sexes dans l’efficacité ». L’article en question rapporte le résultat de la comparaison des groupes de sexe sur 72 sujets âgés de 18 à 27 ans, à partir de connectomes structurels pondérés (par une méthode différente) du cortex parcellisé en 78 régions, de cinq mesures standard de la théorie des graphes (cf définitions en note [12]) : quatre de connectivité globale (coefficients moyen de regroupement brut et normalisé, longueurs de chemin caractéristiques brute et normalisée) et une de connectivité locale (betweenness centrality normalisée). Ils n’ont pas trouvé de différence significative pour les deux mesures de longueur de chemin et le coefficient de regroupement normalisé. Concernant ce coefficient brut, ils l’ont trouvé supérieur chez les femmes même après prise en compte de la taille du cerveau (bien que ça diminue l’écart), interprétant ce résultat en termes de d’ « efficacité locale » (cf [12]) supérieure chez elles. Pour la betweenness centrality, ils l’ont trouvée supérieure chez les femmes dans trois régions du cortex et chez les hommes dans deux. On ne relève nulle convergence entre ces résultats et ceux d’Ingalhalikar et al.
7. Enfin, nos auteurs écrivent que Dennis et al (2013) ont trouvé des différences insignifiantes entre les sexes sur un échantillon de connectomes structurels de 439 sujets âgés de 12 à 30 ans. L’article en question rapporte le résultat de la comparaison des groupes de sexe sur onze mesures standard de la théorie des graphes, sept de connectivité globale (longueurs de chemin caractéristiques brute et normalisée, coefficients moyens de regroupement brut et normalisé, efficacité globale, small-worldness, modularité) et quatre de connectivité locale (efficacité locale, betweenness centrality, degré et coefficient de regroupement). Au niveau global, ils n’ont trouvé une différence que sur le coefficient moyen de regroupement normalisé et le small-worldness, un peu supérieurs chez les femmes, commentant ce résultat en écrivant qu’il « suggère que les femmes ont des réseaux davantage regroupés, hautement ségrégés, que les hommes », ce qui ne va pas franchement dans le sens de l’interprétation qu’Ingalhalikar et al ont fait de leurs propres résultats. Ils précisent en outre qu’après contrôle de l’âge et du volume intracrânien, seule une différence tout juste significative subsistait dans le small-worldness, devenant non significative après correction pour comparaisons multiples (en utilisant la procédure de false-discovery-rate ou FDR). Notons que lorsqu’ils ont fait ces comparaisons par hémisphère, ils n’ont trouvé aucune différence significative pour aucune des sept mesures dans l’hémisphère gauche, et dans l’hémisphère droit une différence de small-worldness seulement, après correction par FDR, et ce uniquement en utilisant leur équation de régression simplifiée ne tenant compte que de l’âge mais pas du carré de l’âge. Notons surtout qu’ils n’ont pas trouvé de différence entre les sexes pour la modularité contrairement à Ingalhalikar et al, et pas de différence entre les sexes dans l’efficacité globale contrairement à Gong et al (2009b). Au niveau local, ils ont trouvé après correction pour comparaisons multiples (par FDR tenant compte du nombre de nœuds et du nombre de mesures testées) des différences significatives sur deux des quatre mesures, l’efficacité locale et le degré, qui vont dans le même sens que ce qu’ont trouvé Gong et al (2009b) et Yan et al (2001). Leurs données détaillées par nœuds montrent qu’ils n’ont trouvé de différence significative entre les sexes que pour trois nœuds, l’un où l’efficacité locale était à peine inférieure chez les femmes, un autre où le degré était supérieur chez les femmes, et un autre où c’était l’inverse.
Concernant cette septième étude, disons en synthèse que si ces résultats ne peuvent être qualifiés de divergents d’avec ceux examinés ici, ils ne sont en tout cas pas convergents. Remarquons également que le commentaire fait pas nos auteurs sur cet article est pour le moins déplacé. En effet, au vu de la quasi-inexistence de différences significatives entre les sexes qu’il rapporte, ils ajoutent : « une analyse détaillée sur un très gros échantillon est nécessaire pour élucider la question des différences entre les sexes de manière fiable, ainsi que nous le faisons ici », or la modularité est la seule des onze mesures qu’ils ont réexaminée ici, en outre avec une méthodologie différente.
Remarques tirées de deux autres études
Dans sa critique d’Ingalhalikar et al publiée dans le Huffington Post, Lise Eliot cite Asato et al (2010) comme ayant montré « des différences opposées – c’est-à-dire des “câbles bleus” renforcés chez les filles ». Cette étude a porté sur le développement de la matière blanche de l’enfance à l’âge adulte inférée de la comparaison de 114 sujets âgés de 8 à 28 ans. Ses résultats étayent la notion déjà documentée que ce développement se poursuit tout au long de cette période, et suggèrent que la majorité des faisceaux de connexions se développent plus tôt chez les filles, avec des exceptions toutefois. Je ne dirais pas pour ma part que les résultats assez fragiles de cette étude contredisent ceux d’Ingalhalikar et al, mais en tout cas ils ne les confortent pas spécialement et soulignent encore une fois l’erreur fondamentale consistant à les extrapoler aux femmes et hommes en général alors qu’ils ont été obtenus sur des enfants, adolescents et post-adolescents dont l’âge et le stade de développement n’ont pas été contrôlés correctement.
Il convient également de signaler que quelques jours après cette publication tonitruante dans PNAS, un autre groupe de chercheurs a publié une étude comparant le développement de la connectivité chez 121 femmes et hommes également à l’aide de connectomes structurels (Lim et al, 2014). Loin d’autoriser les conclusions tranchées d’Ingalhalikar et al, ses résultats également fragiles complexifient encore le paysage de ce champ de recherche balbutiant. Elle n’a quant à elle bénéficié d’aucune publicité auprès du grand public, ceci expliquant en partie cela.
De mon exploration de ce champ de recherche, je retire pour ma part la conclusion suivante : au vu de l’infinie variété des méthodologies de construction des connectomes et des formules de calcul de leurs diverses propriétés, ce champ n’est pas près de faire émerger des conclusions claires et robustes. Bien-sûr, ça n’empêchera pas que soient annoncées au fil de ses tâtonnements les « découvertes » qui ne manqueront pas d’être montées en épingle dès lors qu’elles prétendront apporter une réponse simple à telle ou telle vieille question sur le fonctionnement du psychisme humain en général, sur les différences entre « enfants » et « adolescents », entre « malades mentaux » et sujets « sains », entre « hommes » et « femmes », ou pourquoi pas entre « race blanche » et « race noire ». Ceci nous amène à la question des conséquences fonctionnelles éventuelles des différences putatives de connectivité que cette étude est censée avoir révélées, à laquelle je viens maintenant.
DES CONSEQUENCES FONCTIONNELLES NON SEULEMENT SPECULATIVES MAIS FANTAISISTES
Les annonces des résultats de cette étude ne se sont pas limitées à la description erronée des différences trouvées entre connectomes féminins et masculins, à leur amplification voire leur caricature, à l’invention que ces différences étaient visibles au scanner, à la présentation inappropriée des soi-disant images de connectomes, à la reformulation audacieuse des différences de « poids » d’arêtes en termes de nombre de connexions neuronales réelles, à l’attribution d’une direction imaginaire à ces arêtes, à la généralisation abusive de ces observations aux « hommes » et « femmes » et à l’affirmation mensongère plus ou moins explicite que cette étude les avaient établies.
En plus de tout cela, l’existence de conséquences fonctionnelles de ces différences putatives de connectivité a été affirmée, et un certain nombre de différences fonctionnelles supposées ont été présentées. Souvent décrites comme établies en général, ces différences fonctionnelles ont également été présentées comme ayant été constatées par les chercheurs dans une étude connexe voire dans cette étude elle-même.
L’étude n’apporte aucune donnée relative à des différences fonctionnelles ou cognitives
« Les cerveaux des hommes et des femmes fonctionnent très différemment », a ainsi titré LCI-TF1 pour annoncer cette étude, L’Express titrant quant à lui « Les femmes et les hommes n’utilisent pas leur cerveau de la même façon » et Santé Log « Les différences homme-femme expliquées par le connectome », ce site d’information destiné aux professionnels de la santé précisant : « De précédentes études ont montré des différences dans le cerveau selon les sexes, mais aucune n’avait encore associé des schémas de connections neuronales à des compétences cognitives. Ici, des connectomes spécifiques homme-femme, révèlent […] une différence nette dans les capacités cognitives respectives ». Sur FranceTVinfo, on a pu lire au sujet des cerveaux des hommes et des femmes que l’étude « livre de nouvelles informations sur leur fonctionnement ». Pour Top Actus Santé titrant « Le cerveau fonctionne différemment selon le sexe ! », c’était tout aussi clair : « Grâce à l’étude attentive par scanner du cerveau d’hommes et de femmes, des chercheurs […] ont découvert que le fonctionnement du cerveau masculin et du cerveau féminin n’est pas le même ». Idem pour la journaliste d’AuFéminin.com : « les principales connexions neuronales ne se font pas entre les mêmes zones cérébrales, ce qui agit directement sur les aptitudes développées par chacun », ou encore dans le chapeau de l’article de Peggy Sastre sans doute ajouté par la rédaction du site Le Plus du Nouvel Observateur : l’étude « montre que les cerveaux fonctionnent différemment selon le sexe ».
Pourtant, les observations dont l’article en question est le compte-rendu ne portent ni sur des aspects cognitifs ou comportementaux, ni sur des données d’imagerie fonctionnelle cérébrale : il s’agit d’une étude de neuroimagerie structurelle stricto sensu. A partir de données d’IRM de diffusion, les chercheurs ont fabriqué une image (partielle, incertaine et arbitrairement biaisée) des principaux réseaux de fibres connectant différentes régions du cerveau entre elles, ont fabriqué une moyenne des filles et une moyenne des garçons et rapporté certains résultats de la comparaison de ces deux moyennes, point final. Donc non, non et non, cette étude n’a ni montré que les cerveaux des filles et garçons examinés fonctionnaient différemment, ni que les premières utilisaient leur cerveau différemment des derniers, ni même livré la moindre information sur le fonctionnement de leurs cerveaux respectifs.
En fait, l’idée que des différences fonctionnelles, cognitives ou comportementales auraient été observées dans cette étude est notamment venue du paragraphe suivant de la dépêche AFP : « Des études dans le passé avaient déjà montré des différences dans les cerveaux masculin et féminin, notent les auteurs. Mais, soulignent-ils, cette connectivite neuronale de régions cérébrales dans l’ensemble du cerveau n’avait jamais été liée auparavant à de telles aptitudes cognitives dans un aussi grand groupe ». Il s’agit malheureusement d’une mauvaise traduction combinée à une attribution fautive : ce ne sont pas les auteurs de l’étude mais l’attaché de presse de l’école de médecine de l’Université de Pennsylvanie qui a écrit quelque-chose d’approchant (sans l’attribuer aux auteurs), et sa phrase ne signifiait pas cela en anglais.
Les auteurs n’ont pas (pu ?) établi(r) de lien entre connectivité et cognition ou fonctionnement
Les auteurs auraient effectivement pu lier « cette connectivite neuronale » à des « aptitudes cognitives ». Ca fait un bon moment que le couple Gur a en effet le projet de mettre en relation des données de neuroimagerie et des données « comportementales » (ce terme recouvrant habituellement sous leur plume tout type de données sur la cognition, le profil psychologique ou les troubles psychiatriques) dans l’espoir de comprendre ce que les différences entre les sexes dans les secondes doivent aux différences entre les sexes dans les premières. Ainsi, dans leur chapitre de Principles of Gender-Specific Medicine publié en 2004, premier ouvrage de référence d’un courant de pensée et de recherches issu de mobilisations féministes dont on n’a malheureusement pas fini de voir les retombées, voici quelles étaient leurs suggestions concernant les recherches à mener : « Le manque de données sur les relations entre mesures neurobiologiques et comportementales fait obstacle à la compréhension des effets des différences [cérébrales] entre les sexes sur le fonctionnement du cerveau et sur les manifestations de divers phénomènes cliniques. Les études disponibles ont suggéré des parallèles intéressants entre différences entre les sexes sur des mesures comportementales et différences entre les sexes sur les plans neuroanatomique et neurophysiologique. Cependant, très peu d’études ont effectivement corrélé le comportement avec les paramètres biologiques correspondant à ce type de différences. Lorsque nous aurons une meilleure appréciation de la nature et de l’ampleur de ces corrélations, nous serons capables de répondre à plusieurs questions concernant l’étiologie et les conséquences des différences entre les sexes sur la santé et la maladie. » (Gur & Gur, 2004, p.68, ma traduction).
Comme on l’a vu plus haut, l’étude de neuroimagerie dont il est question ici n’est que l’un des volets d’un projet plus vaste consistant justement à mettre en relation ce type de données de neuroimagerie avec des données psychologiques (et des données génétiques). Dans un article connexe consacré à l’analyse des différences entre garçons et filles observées lorsque les sujets de cette cohorte ont passé la batterie de test informatisée mise au point par leurs soins, nos auteurs expliquent d’ailleurs ceci : « la présente étude à grande échelle démontre la faisabilité de l’obtention de données neuropsychologiques fiables fournissant des informations sur les différences selon l’âge et le sexe. Ces données peuvent être combinées avec des mesures phénotypiques dans des domaines comportementaux spécifiques associés à des troubles développementaux, avec des données de neuroimagerie sur la structure et le fonctionnement du cerveau, et avec des paramètres génomiques afin de stimuler des découvertes permettant de faire le lien entre processus moléculaires et processus comportementaux » (Gur et al, 2012, p. 263, traduit et souligné par moi).
C’est formidable : après tant d’années à ne pouvoir que « suggérer des parallèles », le couple Gur a enfin eu à sa disposition, recueillies sous sa houlette et selon une méthodologie définie par ses soins sur un échantillon de taille exceptionnellement grande, à la fois des données de neuroimagerie structurelle dont celles ayant permis d’élaborer les fameux connectomes, les résultats d’une batterie de tests cognitifs, et des données de neuroimagerie fonctionnelle au repos, durant un test de mémoire de travail sur des formes géométriques et durant un test d’identification d’émotions faciales (deux tâches pour lesquelles des différences entre les sexes sont censées exister). Ils ont donc forcément profité de cette situation exceptionnelle pour mettre tout cela en relation, n’est-ce pas ?
Eh bien, apparemment, non. A ce jour ils n’ont rien publié concernant les différences entre les sexes observables sur leur cohorte dans les trois études de neuroimagerie fonctionnelle ou dans les connectomes fonctionnels en résultant (tels ceux bâtis dans des études qu’ils citent à partir de données d’IRMf au repos), et ils ne disent pas pourquoi ils n’ont rapporté l’analyse que de connectomes structurels. Est-ce parce qu’il n’y avait pas de différences dans ces études ou ces connectomes-là, ou parce que les différences observées n’étaient pas conformes à leur attentes ou impossibles à interpréter dans le cadre théorique qui est le leur ? Ils n’ont rien publié non plus concernant l’étude des corrélations entre les différences de connectomes et les différences de performances aux tests cognitifs observées dans leur cohorte (rapportées dans Gur et al, 2012, e-publication le 12 janvier 2012). Comment cela se fait-il ? Mystère, aucun journaliste n’ayant eu l’idée de leur poser la question. Il reste possible qu’ils soient en train de préparer de telles publications, puisqu’ils ont mis leurs données sous embargo jusqu’en janvier 2015 afin sans doute que personne ne leur ravisse la primeur de leur prochaine découverte, mais il me semble curieux qu’ils ne fassent pas état de ce projet.
Une chose est certaine en tout cas, c’est que les différences entre les sexes dans le connectome qu’ils ont rapportées ici étaient quant à elles parfaitement conformes à leurs attentes : « La combinaison d’un moindre volume global de matière blanche et d’une taille accrue du corps calleux [chez les femmes] suggère une différence fondamentale allant dans le sens d’une optimisation de la connectivité inter-hémisphérique relativement à la connectivité intra-hémisphérique. Par conséquent, nous nous attendrions à trouver des différences entre les sexes dans les comportements requérant différentes quantités de communication inter-hémisphérique relativement à la connectivité intra-hémisphérique. » (Gur & Gur, 2004, p. 68, ma traduction).
Qu’en est-il, justement, des différences de « comportements » observées dans cette cohorte de jeunes : étaient-elles aussi « frappantes » que celles dans le connectome, et effectivement en relation avec différents ratios de communication inter- vs intra-hémisphérique ?
Des différences observées dans les tests cognitifs insignifiantes et qui n’ont rien à voir avec ce qu’on a dit
L’idée fausse d’un lien observé par ces chercheurs entre différences de connectomes et différences fonctionnelles, cognitives ou comportementales a été renforcée par un autre paragraphe de la dépêche AFP : « Les observations faites dans cette recherche correspondent aux résultats d’une étude sur les comportements effectuée par l’Université de Pennsylvanie qui a mis en évidence des différences prononcées entre les deux sexes. Cette recherche a ainsi montré que les femmes sont supérieures aux hommes pour la capacité d’attention, la mémoire des mots et des visages ainsi qu’aux tests d’intelligence sociale, mais les hommes les surpassent en capacité et vitesse de traitement de l’information ».
Ce dernier paragraphe de la dépêche résulte là encore d’une mauvaise traduction, mais ici combinée à un effacement énonciatif : ce qui est affirmé comme s’il s’agissait d’un fait, d’une information obtenue à sa source, n’est que la (très) mauvaise traduction de la reprise, faite par l’attaché de presse, de la description faite par les auteurs des résultats d’une autre étude. Cette description n’avait malheureusement pas grand-chose à voir avec les véritables résultats de l’étude en question, comme aurait pu le constater Jean-Louis Santini s’il s’était donné la peine de la lire.
L’article cité, Gur et al (2012), rapporte une analyse des résultats de 3 448 jeunes de la cohorte à la batterie de tests neurocognitifs. Ca va sans dire (mais il semble nécessaire de le préciser au moins pour certains journalistes scientifiques), cette étude faite sur un échantillon de préadolescents, adolescents et post-adolescents âgés de quinze ans en moyenne et habitant dans la région de Philadelphie ne saurait avoir « montré que les femmes sont supérieures aux hommes » pour quoi que ce soit ni que « les hommes les surpassent » en quoi que ce soit. L’article souffre de nombreux biais et faiblesses, et je note qu’alors que les auteurs expliquent qu’ils ne présentent que l’analyse des résultats du premier tiers des participants, ils n’ont deux ans après toujours pas publié l’analyse sur l’échantillon complet des 9 428 jeunes. Mais concentrons-nous sur les différences cognitives rapportées dans cet article, récapitulées dans la Table 5 ci-dessous.
On remarque en particulier que le seul test pour lequel la performance moyenne des garçons a été significativement supérieure à celle des filles est celui consistant à faire tourner une ligne sur un écran d’ordinateur pour la rendre parallèle à une autre. C’est cela qui a été formulé par les auteurs et dans le communiqué de presse en termes de performances supérieures en « traitement des informations spatiales » (bien que les chercheurs n’aient pas trouvé de différence pour la mémoire spatiale et aient observé de meilleures performances des filles au test de raisonnement non-verbal), et qui grâce à la suppression du mot « spatiales » est devenu sous la plume de Jean-Louis Santini dans la dépêche AFP et ses reprises : « Cette recherche a ainsi montré que […] les hommes les surpassent en capacité […] de traitement de l’information ».
On remarque également que le seul test pour lequel la rapidité moyenne des garçons a été significativement supérieure à celle des filles est celui consistant à appuyer le plus grand nombre de fois possibles sur la barre d’espace du clavier d’un ordinateur pendant 10 secondes. C’est cela qui a été formulé par les auteurs et dans le communiqué de presse en termes de performances supérieures en « rapidité sensorimotrice » (aux tests cognitifs les chercheurs ont en revanche observé une rapidité supérieure chez les filles pour 5 tests sur 12 et chez les garçons pour aucun test), et qui grâce à la suppression du mot « sensorimotrice » est devenu sous la plume de Jean-Louis Santini dans la dépêche AFP et ses reprises : « Cette recherche a ainsi montré que […] les hommes les surpassent en […] vitesse de traitement de l’information ».
Tout cela est déjà édifiant, mais ça n’est pas tout. Comme on l’a vu plus haut, sur un gros échantillon comme celui-ci, même des différences d’ampleur insignifiante peuvent se retrouver statistiquement significatives. Est-ce que les différences entre les sexes trouvées dans cette étude étaient réellement « prononcées » ? Dans l’article, les auteurs eux-mêmes disent des tailles d’effet statistique du sexe qu’elles étaient « petites comparées aux effets du groupe d’âge » (Gur et al, 2012, p.262), et c’est ce qu’on constate en effet : voir la Table 6 ci-dessous.
Les médias anglophones ayant également repris sans sourciller la description fallacieuse des résultats faite par les auteurs (qui n’était toutefois pas entachée des énormités résultant de leur mauvaise traduction par l’AFP), Cordelia Fine a souligné dans The Conversation puis Slate que si on tirait au hasard un garçon et une fille de cet échantillon, leur différence à onze des treize scores ayant présenté une différence significative serait dans le « bon » sens moins de 53 fois sur 100. Ca n’est guère mieux pour les deux différences les plus prononcées, à savoir le test d’alignement de deux lignes (« capacités spatiales ») et celui consistant à différencier joie, tristesse colère ou peur sur un visage (« cognition sociale ») : d’après mes calculs de part de variance indépendante du sexe, le sexe des sujets rendrait compte de moins de 2 % de la variabilité de la précision (0 % de la rapidité) sur le premier, et de moins de 2 % de la variabilité de la précision (moins de 3 % de la rapidité) sur le second. A titre de comparaison, plus de 82 % de la variance de la précision au test d’identification des émotions sur un visage serait explicable par un effet statistique des groupes d’âge constitués par les auteurs, et l’effet statistique moyen du niveau d’étude des parents sur la performance à ces tests était nettement supérieur à celui du sexe.
Des interprétations spéculatives post hoc
Cela étant dit, l’ampleur très modeste des différences entre les sexes trouvées dans les performances cognitives et sensorimotrices n’est pas incohérente avec celle tout aussi modeste des différences trouvées dans les connectomes. Bien qu’il eut fallu rapprocher les deux séries de données pour en avoir le cœur net, l’hypothèse que ces différences cognitives et sensorimotrices puissent être mises en relation avec une différence de ratios de connectivité inter- vs intra-hémisphérique reste valable.
En effet, ce qui est pratique avec les études sur les différences cognitives entre les sexes, c’est que quelle que soit la différence qu’on trouve (et en cherchant bien on en trouve toujours), on arrive toujours à en proposer une explication ad hoc en termes de différences neuroanatomiques, au besoin en faisant apparaître ou en inversant les différences qui vont bien (par exemple en les corrigeant ou non par la taille du cerveau ou en choisissant bien le mode de calcul de celle-ci). La comparaison des déclarations antérieures des mêmes auteurs met en évidence ce caractère ad hoc, ou plus exactement post hoc puisqu’il s’agit à chaque fois d’une interprétation a posteriori de ce qui a été observé.
Dans un article publié en 2000, ils prétendaient avoir montré une différence de latéralisation de l’activité cérébrale entre hommes et femmes susceptible selon eux d’expliquer la soi-disant supériorité des femmes dans les « tâches verbales » et celle des hommes dans les « tâches spatiales ». Voici ce qu’ils écrivaient alors : « L’activation était davantage latéralisée à gauche pour les tâches verbales et à droite pour les tâches spatiales, mais les hommes ont présenté une activation à gauche pour la tâche spatiale non observée chez les femmes. […] Les résultats suggèrent que l’incapacité à activer l’hémisphère approprié dans les régions directement impliquées dans la performance à une tâche pourrait expliquer certaines différences de performance entre les sexes. Ils étendent également, pour une tâche spatiale, le principe selon lequel l’activation bilatérale dans un système cognitif distribué est sous-jacent aux différences de performance entre les sexes » (Gur et al, 2000, p.157, ma traduction). On note qu’alors que la supériorité des capacités spatiales masculines serait, selon l’interprétation donnée à l’étude sur les connectomes structurels, à mettre en relation avec une moindre communication entre les deux hémisphères, ils la mettaient alors en relation avec une plus grande activation conjointe des deux hémisphères lors de la réalisation d’une tâche spatiale. On peut certes toujours élaborer un scénario réconciliant ces deux hypothèses, mais leur cohérence me semble loin d’être frappante.
Autre exemple, voici ce qu’on peut lire dans European Dana Alliance (2005) en lien avec un article de Ruben Gur dans le Journal of Neuroscience : « Comment se fait-il, s’est donc demandé Ruben Gur, que les femmes, dont le cerveau est généralement plus petit que celui des hommes, obtiennent des résultats tout aussi bons qu’eux dans les tests d’intelligence ? Les recherches, y compris les siennes, montrent aussi que les hommes réalisent de meilleurs scores dans les épreuves testant les compétences spatiales, alors que les femmes obtiennent de meilleurs résultats dans les tests verbaux. Selon l’auteur, ce phénomène s’expliquerait par le fait que l’on trouve dans les deux cerveaux une proportion différente de substance grise et de substance blanche. Les tâches spatiales, explique Ruben Gur, requièrent davantage de substance blanche que n’en possèdent la plupart des femmes, dont le crâne est généralement trop petit pour contenir les quantités de cette substance qu’il faudrait pour réaliser de bons scores à ce genre de tests. » (souligné par moi)
Des affirmations fantaisistes basées sur des idées infondées concernant le cerveau
Comme on vient de le voir, les conséquences éventuelles des très modestes différences moyennes trouvées entre les connectomes des filles et des garçons de cet échantillon restent entièrement spéculatives. Tout ce qu’on a pu lire sur la validation ou la confirmation de certains stéréotypes l’est a fortiori, et relève même de la pure fantaisie. Ces affirmations ou suggestions reposent toutes sur un plaquage de la mésinterprétation et surinterprétation des résultats de l’étude sur des idées infondées concernant le cerveau.
Les comptes-rendus médiatiques de l’étude ont en effet véhiculé au passage diverses idées dépourvues de tout fondement scientifique, telles celle que le cervelet est particulièrement important pour l’intuition (même l’idée plus commune qu’il est dédié au contrôle moteur est discutable [24]), celle que l’hémisphère gauche est le siège de l’intuition et l’hémisphère droit celui de l’analyse (selon la dépêche AFP avant sa correction pitoyable et selon tous les médias qui l’ont reprise sans sourciller), celle qu’a l’inverse l’hémisphère gauche est le siège de l’analyse et l’hémisphère droit celui de l’intuition, celle qu’il existe dans le cerveau un centre de la perception et un centre de l’action (situés soit respectivement à l’avant et à l’arrière de celui-ci, soit les deux à l’avant selon les cas), ou encore celle implicite qu’un cerveau serait d’autant plus « multitâche » qu’il a des connexions inter-hémisphériques et d’autant plus « mono-tâche » qu’il en a moins.
La liste non exhaustive des principales informations erronées véhiculées dans les principaux médias francophones ayant annoncé la « découverte » publiée dans PNAS permet de se faire une idée quantitative de l’ampleur des dégâts (voir Annexe 6). Pour voir ce que ça a pu donner concrètement, voici les deux extraits correspondants des reportages diffusés sur France 2 et M6, où l’on constate en particulier que loin d’améliorer la qualité de l’information, le recours à un expert présumé, ici un neurologue du CHU de Montpellier, peut s’avérer au contraire catastrophique.
France 2 : « [Voix off] Chez l’homme, l’activité neuronale est plus grande entre le devant du cerveau, qui gère l’action, et l’arrière, important pour l’intuition, un constat qui expliquerait pourquoi ils sont en moyenne plus aptes à apprendre et exécuter une seule tâche, comme faire de la navigation ou du ski, mais ils traitent aussi l’information plus vite que les femmes. Les femmes, elles, sont plus à même de faire plus de choses à la fois, de créer du lien social, et elles ont une plus grande mémoire des mots et des visages car leurs connexions neuronales sont plus importantes entre l’hémisphère droit du cerveau, permettant la capacité d’analyse, et l’hémisphère gauche, centre de l’intuition. »
M6 : « [Voix off] Le cerveau de l’homme, plus gros et asymétrique, montre d’importantes connectivités, ici en bleu, entre le devant du cerveau, base de la coordination, et l’arrière, où se trouve le cervelet, centre de la perception. [Dr Cherif Haroum] Ce qui fait du cerveau masculin un cerveau qui est plus rapide dans le traitement de l’information, un cerveau en quelque sorte exécutif, hein, mais qui en fait un cerveau également plus mono-tâche. […] [Voix off] Pour les femmes, de nombreuses connexions, que l’on voit en orange, relient l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit, concentrées principalement à l’avant du cerveau, là où se jouent l’intuition et l’analyse. [Dr Cherif Haroum] C’est-à-dire multitâche, hein, un peu comme Windows, elle est capable d’exécuter, euh, plusieurs tâches, hein, elle a une plus grande capacité de mémoire, également, des mots, des visages, et une plus grande intelligence sociale. »
RIEN N’INDIQUE QUE LES DIFFERENCES RESULTENT D’UNE SEXUATION NATURELLE DU CERVEAU
Projetons-nous maintenant dans l’avenir. Supposons qu’on a confirmé l’existence des différences rapportées dans l’article de PNAS, qu’elles ont une quelconque signifiance et valent donc la peine qu’on étudie leur genèse. Reste alors à savoir ce qui les cause : résultent-elles entièrement de la myriade de contraintes matérielles et psychologiques qu’imprime le système culturel de genre sur le développement du cerveau humain, ou bien sont-elles au moins en partie causées par un processus naturel, programmé biologiquement, de sexuation du cerveau ?
La plupart des neurologues et chercheurs en neurosciences ou en sciences cognitives ayant commenté cette étude (je ne parle pas ici des faux experts en neurosciences, tels l’économiste chantre d’une neuroéconomie charlatanesque basée notamment sur des propriétés imaginaires de l’ocytocine Paul Zak [25]) ont souligné que la validité de cette dernière hypothèse n’avait rien d’évident. Le neurologue Jean-Christophe Bier interrogé dans La Libre Belgique s’est même déclaré « pas du tout convaincu » par cette hypothèse, privilégiant quant à lui celle que les différences entre les sexes observées dans cette étude sont « purement culturelles ». Les militants français contre la « théorie du genre », quant à eux, ont au contraire interprété l’étude comme fournissant la preuve scientifique de la sexuation naturelle du cerveau, tels Philippe Poindron (voir le passage de son billet cité en introduction), la page Facebook de La Manif Pour Tous – Calvados (relayant l’article de The Guardian le 3 décembre à 14h avec le commentaire « Où quand la science montre que l’idéologie du genre va contre le réel »), la chaîne web Gloria.TV (relayant une heure plus tard le reportage de France 2 et l’article du Midi Libre en titrant « La science ridiculise la Théorie du genre ! »), le président de l’Association catholique des Infirmières et Médecins le lendemain (dans un ramassis d’inepties publié sous le titre « Qui peut encore croire au gender ? » sur un faux site d’information [26]), ou encore Le Printemps Français alias @nelachonsrien (tweetant l’article de Maxisciences le 5 décembre).
Plus embêtant, de nombreux médias ont légitimé cette interprétation plus ou moins explicitement. L’une des modalités de cette légitimation a été l’emploi du mot « sexe » dans un contexte bien particulier ou celui de locutions telles que « la femme », « le cerveau masculin » ou encore « dimorphisme sexuel ». Ainsi, selon Top Actus Santé, les chercheurs « ont découvert que le fonctionnement du cerveau masculin et du cerveau féminin n’est pas le même », que « l’architecture du cerveau masculin et féminin est […] différente », c’est-à-dire que « le cerveau fonctionne différemment selon le sexe ». Le Point, Le Figaro Madame, Le Matin (journal suisse) ou encore Maxisciences ont quant a eux annoncé que l’étude montrait que le cerveau « a un sexe », ce dernier ajoutant : « Cette découverte permet de définir encore plus précisément le dimorphisme sexuel existant au niveau du cerveau humain ». M6 n’y est pas non plus allé avec le dos de la cuillère, la présentatrice du journal télévisé annonçant carrément : « les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus : une étude de l’académie des sciences [sic] américaine démontre que les cerveaux masculin et féminin sont différents ». Moins explicites mais lourds de sous-entendus par leur appel au champ lexical de la prédestination, de l’idéologie du don ou de l’inégalité de nature, France 2 n’a pas hésité à annoncer : « les hommes sont faits pour agir, les femmes pour réfléchir », le Midi Libre à titrer : « Pourquoi les femmes sont plus douées pour faire plusieurs choses la fois », et AuFéminin.com à titrer « Homme et femme : égaux ? Pas dans le cerveau ! », allant jusqu’à affirmer que la conclusion de l’étude est que « les hommes et les femmes n’ont pas le même cerveau ». L’hypothèse que les différences observées dans cette étude résultent d’un processus biologique de sexuation du cerveau est pourtant très loin d’être étayée.
Un effet biologique du sexe génétique ?
Pour commencer à éclairer la question de l’origine des différences observées, il aurait idéalement fallu disposer d’une estimation de l’effet statistique de la variable « effets cumulés du système culturel de genre sur la trajectoire de vie », mais cette variable est malheureusement impossible à obtenir et tout ce que les auteurs de l’article nous fournissent est l’effet statistique de la variable « sexe ». Le problème est que si on ne dispose d’aucune autre information, tout effet de cette variable est interprétable aussi bien en termes de processus biologique lié au « sexe biologique » qu’en termes d’effets de la culture : il est impossible de les différencier.
Les données disponibles concernant la plasticité de la connectivité cérébrale ne permettent pas non plus d’avancer, n’écartant définitivement ni l’hypothèse d’un pur effet biologique du sexe, ni celle d’un pur effet de la culture, ni celle d’un effet biologique du sexe amplifié ou contrecarré par celui de la culture. Puisque les chercheurs ont trouvé de nombreuses filles à connectome plus « masculin » que la moyenne des garçons et de nombreux garçons à connectome plus « féminin » que la moyenne des filles, une chose est néanmoins certaine : dans l’hypothèse où un effet naturel du « sexe biologique » existerait, les autres facteurs agissant sur le connectome, dont l’existence est en revanche certaine même s’ils restent à identifier précisément, sont au moins aussi puissants.
Pour plaider en faveur de l’hypothèse « effet biologique du sexe», un autre argumentaire auquel n’hésitent pas à avoir recours Raquel et Ruben Gur, qui tentent depuis 40 ans de montrer que l’organisation cérébrale est sexuée [27], est l’argument psycho-évolutionniste. Pour expliquer n’importe quelle différence psychologique ou cérébrale observée entre hommes et femmes, il est en effet extrêmement facile de bâtir un scénario ad hoc selon lequel ces différences sont le produit d’une adaptation du génome aux contraintes évolutives spécifiques ayant pesé sur chaque sexe. C’est ce qu’ils font pour cette étude dont ils sont à mon avis les véritables auteurs principaux [28], évitant cependant ici de dérouler un scénario trop précis afin d’échapper à la critique. Ils écrivent ainsi que « [l]es différences entre les sexes dans le comportement humain présentent une complémentarité adaptative », qu’elles « pourraient découler de rôles complémentaires dans la procréation et la structure sociale », et que comme les études ayant montré des différences cérébrales entre les sexes n’expliquent pas cette soi-disant complémentarité, ils ont mené cette étude qui « suggère que les cerveaux masculins sont structurés pour faciliter la connectivité entre perception et action coordonnée, tandis que les cerveaux féminins sont conçus pour faciliter la communication entre modes de traitement analytique et intuitif des informations » (Ingalhalikar et al, 2014, p.823, traduit et souligné par moi). Tout cela est bien beau, mais comme d’habitude il ne s’agit que d’un raisonnement circulaire qui ne constitue pas même un début de démonstration de l’hypothèse d’un processus biologique lié au sexe, et encore moins de celle plus audacieuse de sa sélection au cours de l’évolution en vertu de sa valeur adaptative.
Ces chercheurs auraient pu glaner des indices concrets en faveur de l’hypothèse biologique en mettant en relation les variations du connectome avec celles de variables biologiques liés au sexe. Par exemple, puisque tous les sujets de leur échantillon avaient été génotypés et puisque ces chercheurs avaient annoncé le projet de rapprocher leurs mesures phénotypiques et données de neuroimagerie avec « des paramètres génomiques » (cf supra), ils auraient pu rechercher des corrélations avec les dosages en certaines variantes génétiques variables selon que les sujets étaient XX ou XY. Apparemment ils ne l’ont pas fait, et en tout état de cause ils n’ont pour l’instant rien publié à ce sujet. Sans aller jusque là, ils auraient au moins pu faire en sorte que leur variable « sexe » corresponde à une notion de sexe génétique, quoique cette notion soit plus difficile à définir qu’il n’y paraît, or ça n’est pas le cas : ce qu’ils appellent « sexe » dans l’article est manifestement le « gender » déclaré par l’enfant ou ses parents lors de son admission à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.
Un effet des hormones « mâles » et/ou « femelles » faisant diverger les trajectoires développementales ?
Puisqu’ils se sont concentrés sur ce qui se passait au cours de la plage d’années encadrant l’adolescence, ils auraient de même pu rechercher des corrélations entre différences de connectome et différences de niveaux d’hormones gonadiques, mais cela ne faisait apparemment pas partie des données recueilles sur leurs sujets. Sans aller jusque là, ils auraient au moins pu tester des corrélations avec le stade de développement pubertaire. Las, comme on l’a vu plus haut, bien qu’ils aient eu à leur disposition cette variable sur l’importance de laquelle ils insistent pourtant dans un autre article, ils ne s’en sont curieusement pas souciés ici. Au lieu de cela, ils ont construit trois groupes d’âge qu’ils ont baptisés « enfants » (8 à 13.3 ans), « adolescents » (13.4 à 17 ans) et « adultes » (17.1 à 22 ans) qui ne correspondent à aucune logique en lien avec la puberté… ni d’ailleurs à aucune logique tout court : si les bornes ont été fixée à 13.4 et 17.1 ans, c’est uniquement parce que c’est ce qui permettait de répartir les sujets de l’échantillon en trois groupes de tailles équivalentes.
Si au moins ils avaient observé que les différences moyennes trouvées se mettaient en place « à l’adolescence » et restaient ensuite relativement stables, ça pourrait constituer un indice (faible mais mieux que rien) en faveur de l’hypothèse d’un effet organisationnel des hormones au moment de la puberté. Sur la base des différences entre connectomes des filles et des garçons dans chacun des trois groupes d’âge, Peggy Sastre sur Le Plus du Nouvel Observateur et Philippe Poindron ont ainsi avancé que les différences entre les sexes observées pouvaient vraisemblablement résulter d’un effet de la « puberté » ou des « neurostéroïdes sexuels ». Dans le même esprit, Le Quotidien du Médecin ou encore Sébastien Bohler dans Scilogs ont présenté les résultats de la comparaison de ces trois groupes comme manifestant une différenciation des trajectoires de développement à partir de l’adolescence. Est-ce vraiment ce qu’indiquent les éléments d’information rapportés dans l’article ?
Notons tout d’abord que ceux-ci ne manifestent pas un sens clair et convergent pour les six comparaisons filles/garçons analysées. Concernant le « ratio de connectivité hémisphérique » (HCR), le « poids de connectivité lobaire » (LCW) et les « coefficients de participation » (PC), les auteurs ne disent rien des effets éventuels du groupe d’âge (on peut donc supposer qu’il n’y en avait pas). Concernant la transitivité et la modularité, ils rapportent une augmentation ou une apparition de la différence entre garçons et filles dans le groupe « adolescents », mais une diminution de cette différence dans le groupe « adultes ». Concernant l’analyse par connexion, ils écrivent qu’elle suggère « le début d’une divergence de trajectoire développementale » dans le groupe d’ « adolescents », mais ajoutent que « cependant », les arêtes inter-hémisphériques davantage présentes chez les filles dans ce groupe « étaient concentrées dans le lobe frontal, alors que chez les adultes elles avaient moins d’arêtes significatives [sic] qui étaient dispersées dans tous les lobes » (Ingalhalikar et al, 2014, p.824, traduit par moi).
Observons par nous-mêmes les différences détaillées par arête montrées dans l’article pour chaque groupe d’âge : voir ci-dessous (B = groupe des 8 à 13.3 ans, C = groupe des 13.4 à 17 ans, D = groupe des 17.1 à 22 ans, arêtes de poids significativement plus lourd chez les garçons que chez les filles à gauche, chez les filles que chez les garçons à droite).
La puissance statistique étant équivalente pour les trois groupes, on peut faire plusieurs remarques. D’abord, la quasi-absence de différences dans le groupe des « enfants » milite en défaveur de l’hypothèse d’un effet organisationnel de la testostérone prénatale, le principal candidat régulièrement invoqué à l’appui des théories essentialistes concernant les différences entre hommes et femmes.
Ensuite, ce ne sont pas toujours les même arêtes qui diffèrent : des différences sont présentes chez les « adolescents » qui disparaissent chez les « adultes », et d’autres n’apparaissent que chez les « adultes ». Enfin, le nombre d’arêtes différentes tend à diminuer chez les « adultes » comparativement aux « adolescents ». Ces observations militent en défaveur de l’idée d’une « mise en place » des différences au moment de la puberté sous l’effet des hormones, et sont en tout cas incompatibles avec l’affirmation que « les différences s’accentuent surtout à partir de la puberté » (Le Plus – Nouvel Observateur), que « [c]es différences se mettent en place dès l’adolescence, d’abord au niveau frontal, puis à l’entrée dans l’âge adulte, dans l’ensemble de l’encéphale » (SciLogs), que « cette différence de câblage ne se marque vraiment qu’à partir de l’adolescence » (Jean-Paul Mialet dans Atlantico), ou encore que les différences de connectivité cérébrale sont « plus marquées entre les sexes dès 14 ans » (La Libre Belgique). Une autre hypothèse collerait mieux à ces données, compte tenu du décalage entre filles et garçons en termes de stades de maturité physiologique : le décalage induit du processus de maturation de la matière blanche susceptible de causer des artefacts de différences de connectivité commence à apparaître dans la première tranche d’âge car il y a plus de filles pubères, et commence à se résorber dans la dernière car les garçons commencent à « rattraper » les filles. Il manque malheureusement les données sur un groupe de vrais adultes (tous post-pubères) pour tester la plausibilité de cette hypothèse.
Il convient pour finir de souligner que si ces variations en fonction du groupe d’âge peuvent donner l’impression d’une différenciation des trajectoires développementales des deux sexes, les chercheurs ont en réalité échoué à mettre celle-ci en évidence. Comme ils l’admettent au détour d’une phrase qui semble n’avoir d’autre fonction que celle d’embrouiller le lecteur (à moins de l’interpréter comme la revendication de la trituration des données leur ayant permis de donner l’impression qu’ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient bien que ne l’ayant pas trouvé) [29], ils n’ont effectivement pas constaté d’effet significatif de l’interaction age x sexe, c’est-à-dire selon leurs propres termes pas de différences significatives entre filles et garçons dans les effets de la trajectoire développementale sur le connectome. C’est ce qu’a également admis Larry Cahill malgré son enthousiasme démesuré pour cette étude, qualifiant cette apparente « absence de différences entre les sexes robustes dans la trajectoire développementale des patterns de connectivité » d’intrigante voire déroutante (Cahill, 2014). En attendant, les dizaines de milliers de médecins français lecteurs de Quotidien du médecin auront quant à eux appris que selon les données de cette étude, « [a]u jeune âge, les trajectoires sont identiques, puis elles se différencient à l’adolescence ».
POURQUOI CET ARTICLE A FAIT L’OBJET D’UNE VULGARISATION PARTICULIEREMENT DESASTREUSE
Au fil de la lecture accablante des comptes-rendus de cette étude plus erronés et délirants les uns que les autres, un passage a réussi à me faire sourire : « Globalement (corrigez-moi si je me trompe), j’ai l’impression que cette étude est assez “bien” passée dans les médias. Je veux dire, je n’ai pas vu d’énormes distorsions de ses observations et, une fois n’est pas coutume, il me semble que les tenants du “il n’y a que les nazis pour penser qu’hommes et femmes ne sont pas cérébralement identiques” se sont faits assez discrets. » (Le Plus – Le Nouvel Observateur). Comment en effet ne pas sourire au vu de l’énormité des distorsions entre les observations rapportées dans l’article et leur présentation dans les médias ? Difficile également de ne pas sourire lorsqu’on voit que loin de se faire discrète, la critique a au contraire fusé dès le premier jour sur le web anglo-saxon, y compris sous la plume de chercheurs reconnus et dans des médias « légitimes » (voir les références dans l’Annexe 1). Je ne suis pas loin de partager l’avis exprimé à ce sujet par Dorothy Bishop dans Storify : « je pense que c’est un excellent exemple de la manière dont Twitter et les blogs peuvent permettre une discussion rapide des articles qui font l’actualité. On dit parfois que la nature non contrainte d’Internet n’est pas propice au débat rationnel, mais dans ce cas je pense que ça a bien fonctionné » (ma traduction).
Il est vrai que dans le monde francophone en revanche, la critique a été aussi rare que pauvre qualitativement. A part l’argument de la plasticité cérébrale – parfois manipulé de manière on ne peut plus maladroite, comme dans Le Matin, dans Causette, sur FranceTVinfo et dans Réponse à tout ! [30]–, je n’ai guère trouvé de trace des remarques faites dans le monde anglophone. Dans les rares cas où un média s’est abreuvé à une source anglo-saxonne développant certaines de ces remarques, elles ont été tronquées ou amoindries : voir L’Express versus BBC News, attribuant de surcroît à la BBC un paragraphe dont le sens est sérieusement distordu par la traduction [31], ou Maxiscience reprenant de Live Science l’idée que certains hommes pourraient néanmoins avoir des connectomes « féminins » et certaines femmes des connectomes « masculins », mais gâchant tout en affirmant qu’il y a donc un « dimorphisme sexuel » au niveau du cerveau humain et choisissant (logiquement) d’ignorer une autre limitation signalée dans sa source (celle qu’on ignore si ces différences structurelles causent des différences de fonctionnement du cerveau ou si c’est l’historique de fonctionnements différents qui les causent). De plus, dans la sphère francophone au contraire de l’anglophone, à l’exception notable de La Libre Belgique et RTL.be qui se sont appuyés sur le neurologue Jean-Christophe Bier, la critique a été presque exclusivement « féministe », c’est-à-dire exprimée dans des médias destinés aux femmes (Marie Claire, Free actualité Femmes, Femme Actuelle) ou explicitement féministes (Les Nouvelle News, Causette), ou bien basée sur l’invocation de propos de la neurobiologiste Catherine Vidal, perçue dans le débat public comme féministe engagée contre le neurosexisme (Réponse à tout !, Le Matin, FranceTVinfo) – on note d’ailleurs que le journal belge Le Vif , quant à lui non critique, se sert de cette étude pour tenter de la discréditer (« Cette étude vient contredire les propos de Catherine Vidal, directrice de recherche à l’Institut Pasteur, qui affirme que le cerveau n’a pas de genre »).
Indubitablement, la dépêche AFP a joué un rôle majeur dans le processus de désinformation qui a particulièrement touché la sphère francophone. C’est ainsi un mélange de paresse et d’incompétence qui a lancé ce processus, la désinformation faisant ensuite boule de neige par manque de temps, paresse et/ou incompétence des rédacteurs et journalistes qui se sont inspirés de sources secondaires sans remonter à la source la plus primaire disponible, à savoir l’article scientifique. Mais dire cela n’explique pas tout, et il convient de souligner que certaines caractéristiques de ce cas de fabrication d’une fausse découverte scientifique, fréquentes lorsqu’il s’agit de discours sur le sexe/genre, ont particulièrement favorisé ce processus. La première de ces caractéristiques est la très faible qualité de l’article scientifique.
Un article scientifique de très faible qualité (voire un concentré de mauvaises pratiques)
Un premier élément a miné à la base la qualité de l’article, qui est que le cadre dans lequel ont été recueilles les données ayant servi à le produire n’avait pas été conçu pour l’étude des différences cérébrales liées au sexe. Cela a notamment eu pour conséquences l’utilisation de données d’une plage d’âge bien peu appropriée à l’étude des différences entre « hommes » et « femmes » (adultes), des biais de sélection lors de la constitution de l’échantillon et l’absence d’attention à des variables nécessaires lorsqu’on souhaite adresser sérieusement la question des effets biologiques du sexe. L’une des exigences qui s’imposent aux chercheurs souhaitant travailler avec rigueur sur cette question est en effet d’identifier lors de la conception de l’étude les variables susceptibles d’affecter les résultats et de s’assurer autant que faire se peut de comparer des groupes de sexes similaires pour ces variables. Car les groupes de sexe tirés plus ou moins au hasard d’une population peuvent différer sur une multitude de variables (âge, stade de maturité physiologique, indice de masse corporelle, niveau et domaine d’études, activités pratiquées, statut socio économique, orientation sexuelle, religion, nationalité, configuration familiale, etc) qui peuvent s’avérer cruciales pour certains objets d’étude. Il serait par exemple inepte de prétendre étudier les effets biologiques du sexe sur les performances scolaires sans s’assurer que les garçons et filles comparés sont issus de milieux socio-économiques comparables, ceux sur les performances à un test ressemblant à un jeu vidéo sans s’assurer que les garçons et filles comparés ont un historique comparable de pratique de ce type de jeu, ou encore ceux sur l’obésité sans s’assurer que les garçons et filles comparés ont des pratiques alimentaires et un niveau d’activité physique comparables. Les chercheurs ne se sont souciés de rien de tel ici, même pas des niveaux hormonaux nécessaires pour tester l’hypothèse d’un effet de la puberté, et même pas de définir le sexe sur la base de critères biologiques.
Le second élément ayant miné la qualité de l’article scientifique est la volonté des chercheurs de mettre en évidence des différences entre les sexes, que ce soit par opportunisme sachant que les articles sur ce sujet bénéficient d’une publicité assurée, parce qu’ils n’avaient pas atteint les objectifs ayant motivé le financement de leur travaux et que ça permettait de donner l’impression que ceux-ci avaient néanmoins été utiles à quelque-chose, ou simplement parce qu’ils sont convaincus et souhaitent convaincre de l’existence de différences naturelles entre hommes et femmes sur le plan cognitif et comportemental, et d’autant plus attachés à le faire que cette hypothèse sous-tend leurs recherches depuis 40 ans en ce qui concerne les deux investigateurs principaux (cf note [27]).
Cette volonté de mettre en évidence certaines différences entre les sexes a eu pour conséquence un manque de transparence quant à la méthodologie de l’étude, et de nombreux biais (inconscients ou délibérés) dans l’analyse des données, dans la présentation des résultats et dans leur interprétation.
Concernant la transparence sur la méthodologie de l’étude, l’article est loin de se conformer au standard scientifique requérant qu’elle soit décrite suffisamment clairement pour pourvoir appréhender correctement ses résultats, et pour qu’elle puisse ultérieurement être répliquée par d’autres ou prise en compte dans une méta-analyse. Il est par exemple impossible de savoir quelles sont les 27 régions sous-corticales définies par les auteurs, comment ils ont défini les « lobes » ayant servi dans plusieurs calculs (qui ne correspondent pas à la définition usuelle puisqu’ils incluaient des noyaux sous-corticaux et le cervelet), comment ils ont calculé les valeurs t ayant servi à déterminer quelles étaient les différences statistiquement significatives (ce qui pourrait cacher des problèmes [32]), s’ils ont attribué un poids aux cellules de la diagonale de la matrice et s’en sont servi pour les comparaisons autres que l’analyse par arête, ou encore quel est le seuil qu’ils ont appliqué pour éliminer les fausses connexions si d’aventure ils en ont appliqué un.
Les auteurs ne donnent aucune information dans l’article sur les modalités de constitution de l’échantillon, et celles que j’ai glanées dans d’autres articles ne permettent pas de savoir précisément à quoi correspond ce sous-ensemble de 949 sujets de la cohorte, sans parler du fait que contrairement à ce qui relève du B-A-BA pour un chercheur en sciences sociales, ces représentants supposés de sciences plus « dures » ne se sont bien entendu pas souciés d’analyser les différences entre les jeunes inclus dans la cohorte et ceux exclus.
Par ailleurs, il est écrit dans l’article : « Les données rapportées dans cet article ont été déposées dans la base de données dbGaP ». Lorsque je l’ai consultée un mois après la publication de l’article, cette base ne contenait rien à part une description très synthétique du projet de recherche de Raquel Gur accompagnée de la mention « Individual level data will be coming soon ». Quelques informations accessibles ont été ajoutées depuis, mais les données individuelles finalement déposées le 31 janvier 2014 sont incomplètes et sous embargo jusqu’au 31 janvier 2015.
Concernant l’analyse des données, nous avons vu par exemple que les auteurs ont « oublié » de se demander quelle méthode de pondération des arêtes était la plus opportune, de se demander à partir de quel seuil de probabilité exclure les arêtes, de faire une correction pour comparaisons multiples chaque fois qu’il le fallait, de rapprocher les données du connectome de celles obtenues sur la batterie de tests cognitifs, ou encore d’inclure dans toutes les analyses statistiques les cinq facteurs de confusion probables qu’ils avaient à leur disposition. Il faut également signaler qu’outre ces cinq facteurs mentionnés plus haut, ils avaient également à leur disposition sur les sujets de cette cohorte le niveau d’étude des parents et le nombre moyen d’années de scolarisation des sujets, utilisés respectivement dans Gur et al (2012) et dans Gur et al (2013) mais pas ici (pourquoi ?).
Compte tenu du fait qu’ils ne prétendent pas avoir défini a priori la méthodologie d’analyse des données et que rien n’indique que ça puisse être le cas (comme on l’a vu, la manière dont ils ont pondéré le connectome ne correspond à rien dans la littérature scientifique antérieure, les mesures qu’ils ont élaborées non plus à part la modularité et la transitivité, la première étant calculée différemment de ce qui a été fait dans un article dont ils prétendent réévaluer les conclusions, une mesure a été faite sur le connectome non pondéré mais pas les autres sans qu’ils disent pourquoi, le contrôle par les variables « âge » et « race » dépend des mesures sans non plus aucune justification, etc), il ne me paraît pas déraisonnable de faire l’hypothèse qu’ils ont essayé différentes méthodes et choisi in fine de rapporter les résultats obtenus avec celles qui « marchaient » le mieux. Quoi qu’il en soit, le moins qu’on puisse dire est que les chercheurs n’ont pas suivi une méthodologie rigoureuse et argumentée, et que ce qu’ils ont fait n’est pas « une description complète des caractéristiques du réseau » de connexions malgré ce qui est indiqué dans l’abstract de l’article.
Concernant la présentation des résultats, c’est encore plus problématique et les biais sont flagrants. Il y a d’abord l’usage d’un vocabulaire ambigu pouvant s’avérer trompeur dans certains paragraphes : « lobes » comme on l’a vu, mais aussi « sous-cortical » qui tantôt inclut le cervelet, tantôt ne l’inclut pas (il est différencié des régions sous-corticale dans la fig. 1 et appelé « cortex cérébelleux » dans la fig. 3), « connexions » laissant entendre qu’on parle des connexions cérébrales alors qu’il s’agit des arêtes du graphe, et « voisins » laissant entendre qu’on parle de nœuds proches physiquement alors qu’il s’agit d’une notion de théorie des graphes qui n’a rien à voir.
Il y a ensuite le non respect d’une importante règle d’éthique scientifique consistant à rapporter aussi les résultats qui ne vont pas dans le sens attendu ou qui n’étayent pas l’interprétation qu’on veut donner d’autres résultats. Cette règle s’impose d’autant plus lorsqu’on travaille sur le sujet très sensible, assorti à des enjeux sociaux et politiques considérables, des différences entre groupes humains fondés sur une classification biologique. Lorsqu’on rapporte une différence entre les sexes, cette règle commande de rendre compte aussi de la variabilité intra-sexe (ex : moyennes de chaque groupe de sexe assorties d’écarts-types, tailles d’effet du sexe, représentation graphique des moyennes de chaque groupes avec intervalles de confiance, nuages de point), de ne pas souligner uniquement une différence ténue observée entre les sexes lorsque d’autres variables s’avèrent avoir un effet statistique beaucoup plus important, et de ne pas masquer l’absence de différence entre les sexes lorsqu’elle est constatée. En termes de manquements à ces règles, l’article est un modèle du genre. Quelles que soient les comparaisons rapportées, les auteurs ne donnent aucune valeur moyenne de chaque sexe, aucune information sur les distributions à l’intérieur des groupes de sexe et aucune taille d’effet du sexe (il m’a fallu les estimer par un calcul approximatif) au profit d’une mise en valeur de la significativité statistique qui n’a d’autre intérêt que celui d’impressionner le lecteur [33]; concernant l’analyse détaillée par arête on ne sait pas combien d’entre elles étaient présentes en tout et pour combien ils ont trouvé une différence significative, et on n’a même pas ici les valeurs (t) qui permettraient d’estimer l’effet statistique du sexe ; concernant les autres analyses il n’y a aucune liste des comparaisons faites, seules celles pour lesquels une différence a été trouvée étant montrées dans les tables et les figures ; il n’y a de même aucune information ni commentaire dans le texte sur toutes les régions pour lesquelles ils n’ont pas trouvé de différences significatives (hippocampe, amygdale,… ?).
Il y a encore les légendes remarquablement sibyllines des figures et des tables, et surtout les images représentant les différences significatives ressortant de l’analyse détaillée par arête dont on a vu qu’elles étaient éminemment trompeuses. De fait, ces images ont été mal comprises par presque tout le monde, y compris dans les critiques de la surinterprétation et mésinterprétation de cette étude. Sur le web et dans les médias grand public, seuls Mark Liberman sur Language Log et Lise Eliot dans le Huffington Post ont relevé qu’elles passaient pour être ce qu’elles n’étaient pas, et même l’article très critique publié dans The Guardian (7/12) par Robin McKie, désigné journaliste scientifique de l’année le 2 décembre 2013 lors des British Journalism Awards, a présenté ces images avec une légende incorrecte. Il faut dire que leur légende était déjà ambigüe dans l’article scientifique, voire incompréhensible : « Les réseaux cérébraux présentent une connectivité accrue chez les sujets de sexe masculin (en haut) et de sexe féminin (en bas) ».
Il y a enfin trois reformulations gravement fallacieuses des résultats. La première est celle des résultats de la comparaison filles/garçons concernant les connexions inter- et intra-hémisphériques en termes de résultats d’une comparaison des connexions inter- vs intra-hémisphérique chez les filles, de la même comparaison chez les garçons, et de constat imaginaire que ces comparaisons donneraient des résultats opposés (les auteurs parlent de « dominance of intrahemispheric connectivity in males » et d’« interhemispheric connectivity dominance in females » dans le corps de l’article et écrivent « males had greater within-hemispheric connectivity […] whereas between-hemispheric connectivity and cross-module participation predominated in females » dans l’abstract). Comme on l’a vu, aucune des données rapportées dans l’article ne permet pourtant de savoir si les connexions intra-hémisphériques « prédominaient » sur les connexions inter-hémisphériques chez les garçons ni si c’était l’inverse chez les filles. La seconde est celle déjà signalée plus haut au sujet d’une observation faite sur le cervelet : « the opposite pattern prevailed » alors que ça n’est pas ce qu’indiquent leurs données, redoublée dans l’abstract de l’article (« this effect was reversed in the cerebellar connections »). La troisième est l’affirmation spécieuse faite dans l’abstract que « l’analyse de ces changements dans leur développement a mis en évidence des différences de trajectoire entre garçons et filles » et dans l’encadré « significance » que « les trajectoires développementales masculines et féminines se séparent dès l’enfance, présentant d’importantes différences durant l’adolescence et à l’âge adulte », alors qu’ils admettent dans le corps de l’article n’avoir pas trouvé d’effet statistique du sexe sur la trajectoire développementale.
L’interprétation et le commentaire des résultats par les auteurs sont exempts de tout souci de rigueur, pour ne pas dire plus. L’affirmation dans l’abstract que « les différences entre les sexes dans le comportement humain présentent une complémentarité adaptative : les hommes ont de meilleurs capacités motrices et spatiales, tandis que les femmes ont une mémoire et des aptitudes en termes de cognition sociale supérieures » n’est ainsi qu’un tissus de mensonges et demi-mensonges. Mensonger est également le résumé des résultats de Gur et al (2012) fait en 4ème page de l’article pour donner l’illusion que leur scénario est cohérent, dans lequel ils osent mentionner des différences qui n’étaient pas statistiquement significatives : loin d’avoir mis en évidence des différences ente les sexes « prononcées », cette étude n’a pas non plus trouvé que les garçons avaient été meilleurs en « traitement spatial » (leur figure 1 montre qu’ils ont seulement été meilleurs à un test d’orientation d’une ligne sur un écran, pas meilleurs en mémoire spatiale et moins bon en raisonnement non-verbal), ni qu’ils avaient été meilleurs en « rapidité motrice et sensorimotrice » (ils n’ont été meilleurs qu’au premier de ces deux tests), ni que « ces différences ont été principalement observées à la mi-adolescence (12 – 14 ans) », ni que les garçons ont été à cette âge « plus précis dans les tâches de mémoire spatiale » (leur figue 3 montre une absence de différence significative à cet âge comme aux autres).
L’affirmation dans l’encadré « significance » que « Les résultats établissent que les cerveaux masculins sont optimisés pour la communication intra-hémisphérique et les cerveaux féminins pour la communication inter-hémisphérique » relève d’une malhonnêteté intellectuelle confondante. L’affirmation dans l’abstract que « les résultats suggèrent que les cerveaux masculins sont structurés pour faciliter la connectivité entre perception et action coordonnée, tandis que les cerveaux féminins sont conçus pour faciliter la communication entre modes analytique et intuitif de traitement de l’information » est complètement gratuite, et on atteint un sommet de ridicule avec le développement de cette idée dans le corps du texte : « Une plus grande connectivité inter-hémisphérique chez les femmes faciliterait l’intégration des modes de raisonnement analytique et séquentiel de l’hémisphère gauche avec le traitement spatial, intuitif des informations de l’hémisphère droit », digne de la neuropsychologie naïve d’il y a un siècle.
Il est aussi incroyable qu’ils aient osé affirmer que les différences mises en évidence « suggèrent des patterns de connectivité fondamentalement différents » (2ème page), et même « révèlent des différences entre les sexes fondamentales dans l’architecture structurelle du cerveau humain » (4ème page) alors que leurs données suggèrent au contraire une absence de différence structurelle dans le connectome et une très grande similarité en termes de poids relatifs de ses arêtes.
On peut se consoler en se disant que l’énormité de toutes ces affirmations a définitivement discrédité ces chercheurs aux yeux de la communauté neuroscientifique, mais ça n’effacera malheureusement pas leur reprise dans les médias grands public, et ça n’empêchera pas leur citation ultérieure par des scientifiques d’autres champs de recherche, des « experts » des différences entre hommes et femmes, des militants contre la « théorie du genre », etc. De cela les auteurs n’ont visiblement cure, qui n’ont pas non plus souligné que leurs observations étaient compatibles avec l’hypothèse d’une modulation de la force des connexions par les vécus différents des garçons et des filles et ont au contraire tout fait pour induire l’idée qu’elles traduisaient une sexuation naturelle du cerveau pourtant nullement étayée par leurs données.
Un comité éditorial peu regardant voire pousse-au-crime
Pour qu’un article avec autant de défauts ait pu être publié, il a fallu en premier lieu que le processus de revue par des pairs avant publication dysfonctionne. Les pairs sollicités étaient-ils incompétents, n’ont-ils pas eu assez de temps ou ont-ils été aveuglés par leurs propres préjugés hétérosexistes ? Est-ce une version non corrigée de l’article qui a été publiée par erreur ? Y a-t-il eu une intervention intempestive du rédacteur en chef Inder Verma facilitant la publication en l’état de cet article dont Ragini Verma est l’auteur correspondant ? Je n’en sais rien, mais ce qui est sûr c’est que ce processus a dysfonctionné.
Cela étant dit, qu’un article publié dans l’une des revues scientifiques les plus prestigieuses puisse souffrir de grosses faiblesses n’a rien d’exceptionnel, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Comme l’a souligné Dorothy Bishop sur Storify, il s’agit d’un « article de PNAS typique : un résultat extrêmement tape-à-l’œil accompagné d’une description ultralégère des méthodes ». D’autres chercheurs se sont offusqués qu’un article ait pu être publié sans aucune taille d’effet alors qu’il s’agit d’une mauvaise pratique dénoncée de longue date, en principe bannie des revues scientifiques. Mais la position de force de PNAS autorise paradoxalement ses éditeurs à se permettre de publier des articles que des revues mineures rejetteraient en l’état. Un autre élément canonique dans les revues scientifiques de qualité est le paragraphe de discussion dans lequel les auteurs adressent les limitations de leur étude et discutent les interprétations alternatives à celle qu’ils privilégient, mais là encore PNAS s’autorise à ne pas l’exiger des auteurs. Au lieu de cela, la revue exige depuis 2013 qu’ils fournissent un encadré « significance » destiné à mettre en valeur l’importance de l’étude, autant dire un pousse-au-crime en matière de publicité mensongère.
PNAS se trouve de fait dans une position particulière sur le marché de l’édition scientifique (car il faut appeler un chat un chat : c’est devenu un marché semblable à d’autres, y compris avec un dispositif de cotation en l’occurrence basé sur l’Audimat). En tant que revue généraliste elle a un lectorat cible très large, par conséquent bien moins critique en moyenne que le lectorat pointu des revues spécialisées, et est sans doute plus que d’autres contrainte de générer du buzz pour exister face à Science et Nature, les deux revues dominant le marché vis-à-vis desquelles elle se place en outsider. PNAS fait même désormais sur son site, en partenariat avec une société spécialisée, la publicité du buzz qu’elle génère sur le web afin d’alimenter le cercle vicieux de la fabrication de sa cote. Sur la page de l’article dont il est question ici, la revue revendiquait ainsi le 7 janvier 2014 un buzz d’enfer le plaçant dans le premier centile des 1 769 850 articles scrutés et des 56 183 articles scrutés publiés entre le 21 octobre et le 6 janvier pour lesquels cette mesure d’audience a été faite, au 13ème rang des 19 630 articles de PNAS scrutés et au 4ème rang des 693 articles scrutés publiés dans PNAS entre le 21 octobre et le 6 janvier (voir ici).
Cet article de qualité plus que médiocre a donc très bien performé tout seul, mais le comité éditorial a souhaité lui donner un coup de pouce supplémentaire : pour exploiter cette pépite au maximum, il a commandé à Larry Cahill un commentaire destiné à attirer l’attention sur elle [34]. Ce neurosexiste de service convaincu de l’existence de profondes différences psychologiques naturelles entre les sexes sélectionnées au cours de l’évolution [35] s’est exécuté avec l’aveuglement ou la malhonnêteté intellectuelle qu’on pouvait attendre de lui. Posant que l’article avait tout ce qu’il faut pour faire date et qu’il rapportait « des différences claires et frappantes », il n’a pas hésité à reformuler les résultats dans un sens qui devait l’arranger, sans que ça gène le comité éditorial pour lequel décidément tout semble bon à prendre dès lors que ça sert a priori ses intérêts : selon Cahill, la conclusion « la plus notable » de cette étude est en effet que « les cerveaux des hommes présentent un degré d’interconnectivité beaucoup plus faible, tant à l’intérieur de chaque hémisphère qu’entre hémisphères, que ceux des femmes qui réciproquement présentent un degré d’interconnectivité significativement plus grand tant entre hémisphères qu’entre lobes à l’intérieur d’un hémisphère » (Cahill, 2014, traduit et souligné par moi). Comme il y a huit ans (cf Cahill, 2006), il exprime son regret que nombre de neuroscientifiques soient convaincus que l’influence du sexe biologique sur le cerveau est douteuse ou négligeable et espère bien que ça va maintenant changer. Pour ma part, je note que cette conviction semble au contraire progresser malgré la pression combinée de l’industrie biopharmaceutique et de certaines féministes en faveur du développement d’une gender-specific medicine mal définie, et je pense que cette nouvelle tentative de freinage de sa progression aura été assez maladroite pour être contre-productive.
Le comportement des auteurs après la publication de l’article
La manière dont les auteurs d’un article scientifique communiquent à son sujet est souvent déterminante pour sa carrière médiatique. Ici, les auteurs sont allés assez loin dans une distorsion et une surinterprétation de leurs résultats qui ont incontestablement joué en faveur de leur succès auprès des journalistes et du grand public. Je suis une nouvelle fois d’accord avec Dorothy Bishop qui souligne dans Storify que le comportement de ces chercheurs, qui se sont discrédités auprès de leurs pairs en échange d’un moment de gloire médiatique, est difficile à comprendre sauf à supposer qu’ils ne se rendent pas compte des énormités qu’ils ont proférées, auquel cas ils sont vraiment mauvais.
Ca a commencé avec le communiqué de presse, dont je vous invite à (re)lire le texte à la lumière de la description faite plus haut de ce que les chercheurs ont réellement observé. Il convient de souligner qu’en plus de ce texte profondément fallacieux, le communiqué contenait les fameuses images affublées d’un titre ambigu et abusivement généralisant (« Différences entre les sexes dans le connectome du cerveau humain ») et d’une légende qui l’était également, en plus d’être mensongère puisque la technique utilisée par les auteurs ne permettait pas de donner une direction aux arêtes (« Les réseaux cérébraux présentent une connectivité accrue de l’avant vers l’arrière et à l’intérieur d’une hémisphère chez les hommes (en haut) et de la gauche vers la droite chez les femmes (en bas) »).
Ca a continué avec leurs interviews dans les médias, dans lesquelles ils en ont remis plusieurs couches. Dans un reportage tourné par l’antenne de CBS à Philadelphie diffusé le matin du 3 décembre, Ruben Gur a ainsi commenté de manière fantaisiste les fameuses images, n’hésitant pas à présenter celle aux lignes orange en disant « ceci est le cerveau féminin », à affirmer que chez les femmes les lobes cérébraux « communiquent beaucoup plus entre eux » et à ajouter : « c’est pour ça que les hommes ont peut-être plus de mal à parler de sentiments » (!)[36]. Dans The Independent, Ragini Verma a quant à elle expliqué au journaliste scientifique Steve Connor que ce qu’ils avaient identifié est qu’ « il y a des connexions dans le cerveau qui sont câblées en dur [hardwired] différemment chez les hommes et les femmes », que « chez les femmes, la plupart des connexions relient les hémisphères gauche et droit alors que chez les hommes la plupart des connexions relient l’avant et l’arrière du cerveau » (affirmation nullement étayée par cette étude comme on l’a vu), et que l’hémisphère gauche étant « associé avec la pensée logique » et le droit « lié à l’intuition », cela « pourrait aider à expliquer pourquoi les femmes tendent à être meilleures que les hommes dans les tâches intuitives » : « l’intuition, c’est penser sans penser. […] Les femmes tendent à être meilleures que les hommes dans ce genre de capacités qui sont liées au fait d’être de bonnes mères » (!). Ses propos rapportés par le journaliste scientifique Ian Sample dans The Guardian (repris après traduction dans Maxiscience) sont également si gratinés qu’on ne peut concevoir qu’il les ait inventés, fautes de syntaxe comprises : « Si vous regardez les études fonctionnelles, la partie gauche du cerveau est plus pour la pensée logique, la droite plus pour la pensée intuitive. Donc s’il y a une tâche qui implique de faire les deux, il semblerait que les femmes soient câblées en dur pour mieux faire ces choses. Les femmes sont meilleures en pensée intuitive. Les femmes sont meilleures pour se souvenir des choses. Quand vous parlez, les femmes sont plus émotionnellement impliquées, elles vont écouter davantage […] J’ai été surprise que ça corresponde à de nombreux stéréotypes dont on pense qu’ils sont [juste] dans nos têtes. Si je devais aller voir un chef cuisinier ou un coiffeur, ce sont principalement des hommes » (ma traduction).
Je tiens également à signaler au passage que ces chercheurs ont fait preuve d’une attitude méprisante vis-à-vis de leurs pairs inversement proportionnelle à leur diligence vis-à-vis des médias. Ils ont écrit dans l’article que leurs données avaient été mises à disposition en ligne alors que ça n’était pas le cas. Ils n’ont pas daigné répondre aux questions qui leur ont été posées sur PubPeer, site de peer-review post-publication assurant la communication aux auteurs des questions et critiques qui leur sont adressées. Leur réponse à la lettre de Joel & Tarrasch (2014) pointant le caractère trompeur des images, leur commentaire inapproprié en termes dichotomiques, l’absence de tailles d’effet du sexe, l’absence d’information donnant une idée de l’ampleur du recouvrement des distributions observées dans chaque groupe de sexe et l’absence du nombre de connexions pour lesquelles des différences ont été trouvées est également édifiante. Ils se contentent en effet de dire qu’il suffisait de lire la légende des images et d’avoir des notions de statistique de base pour l’interpréter correctement, ne répondent pas aux questions concernant le nombre de connexions différentes et les tailles d’effet du sexe, posent que c’était leur droit de ne rapporter que les différences entre les sexes puisque c’est ça qui les intéressait, ajoutant que les autres n’ont qu’à aller voir par eux-mêmes ce qui ne différait pas entre les deux groupes de sexes en ré-analysant « les données qui ont été mises à disposition » (les données l’ayant été ne permettant pas d’adresser cette question), se payant le culot d’écrire : « Il est compréhensible qu’on n’aime pas les résultats d’une étude qui contredit ses croyances » (Ingalhalikar et al, 2014b, traduit par moi). Mon échange avec l’auteure correspondante fut également instructif. Lorsque m’étant présentée comme chercheure, je lui ai posé quelques question simples et précises (ex : quelles étaient les 27 régions sous-corticales), elle n’a pas daigné me répondre. Lorsque je l’ai relancée en expliquant que j’en avais besoin pour un article que j’étais en train d’écrire, elle m’a mise en contact avec l’attaché de presse qui m’a indiqué qu’elle ne répondrait pas à mes questions par écrit et proposé d’organiser un entretien avec elle. Lorsque je lui ai écrit que je ne souhaitais pas l’interviewer pour écrire dans un média mais pour alimenter mon blog en même temps qu’un article scientifique, j’ai été informée que Ragini Verma étant très prise, elle ne répondait qu’aux sollicitations des médias et laisserait donc mes questions sans réponse.
La disponibilité des séduisantes images de neuroimagerie, qui donnent l’illusion qu’on peut constater par soi-même que ce que les chercheurs disent avoir « vu » dans le cerveau est vrai, a certainement joué et joue encore un rôle important pour le succès des neurosciences auprès du grand public. Pour ce qui est des images de différences entre hommes et femmes il est d’illustres précédents, telles celles de Shaywitz et al (1995) qui étaient censées montrer une différence très nette d’activation cérébrale des hommes et des femmes lors d’une tâche langagière (obtenues par le même genre de trituration des données qu’ici), qui avaient à l’époque déclenché un beau délire dans la presse (Le Monde, Le Nouvel Observateur, Science & Vie, etc) et qui ont malheureusement marqué bien plus durablement les esprits que l’invalidation définitive de ce résultat.
Dans le cas présent, notamment au vu de la manière dont les fausses images de connectomes masculin et féminin ont été commentées dans les médias qui les ont reprises, il me paraît probable que ces images diffusées dans le communiqué de presse ont beaucoup aidé à convaincre les rédacteurs d’articles de vulgarisation que les résultats de l’étude étaient aussi frappants et les différences entre les sexes aussi « complémentaires » que le prétendaient les auteurs.
Si la confirmation de cette hypothèse demanderait un complément d’enquête, j’ai en tout cas relevé des indices d’une plus grande « viralité » des news ayant repris ces images par rapport à celles ne les ayant pas reprises : voir la Table 1 ci-dessous, notamment la différence entre les articles du Point et de L’Express qui étaient par ailleurs en tout point comparables.
La réponse à une demande sociale
Enfin et peut-être surtout, la qualité essentielle de cet article scientifique est qu’il répond à une demande. Que ce soit en réaction aux transformations sociales qui se sont produites depuis la fin des années 1960, suscitant chez des personnes de gauche comme de droite une recherche de repères (en réponse à l’injonction à la définition de chacun comme « homme » ou « femme »), d’ancrage identitaire solide (surtout pour des hommes apeurés à l’idée qu’ils pourraient ne guère différer des femmes) ou d’assurance que la structure hétéronormative autour de laquelle elles se sont construites subsistera comme mode d’organisation fondamental de la société, que ce soit au contraire face au constat de la persistance remarquable de différences entre hommes et femmes malgré l’égalité formelle acquise, suscitant une recherche d’explication d’autant plus attirante qu’elle sera simple, conforme à des mythes savants déjà bien ancrés dans la culture et qu’elle chassera l’idée effrayante que tout cela et bien plus (ce qui guide jusqu’à nos élans les plus intimes) pourrait n’être que le produit d’un formatage social, ou encore que ce soit dans une perspective féministe essentialiste soucieuse de voir reconnues des spécificités féminines supposées dont la prise en compte permettrait de lutter plus efficacement contre les inégalités, pour ne citer que ces trois moteurs, il existe indubitablement une forte demande sociale pour les discours scientifiques accréditant l’idée qu’il existe des différences psychiques naturelles entre les sexes.
Les discours de ce type se propagent avec d’autant moins d’obstacles qu’ils accréditent l’idée de complémentarité des aptitudes et attitudes des deux sexes (source d’une bienheureuse attirance garantissant la survie de l’espèce, assurance de fonctionnements conjugaux et parentaux naturellement optimaux, et explication des problèmes de communication au sein du couple qui en sont le seul inconvénient), qu’ils sont compatibles avec l’idée qu’hommes et femmes sont fondamentalement égaux (dans la différence) et qu’ils sont susceptibles de conforter des stéréotypes de genre répandus. La présentation des résultats de l’article en question ici répondait parfaitement à ces trois critères.
L’idée de complémentarité a ainsi été formulée avec insistance dans l’article scientifique, redoublée par un commentaire de Ruben Gur dans le communiqué de presse, et c’est ce commentaire que le journaliste de l’AFP a choisi de mettre en valeur en en faisant l’intertitre de sa dépêche. Au-delà de la citation fréquente de ce commentaire (ne serait-ce que dans toutes les reprises de la dépêche AFP), l’idée de complémentarité a été rabâchée dans de nombreuses annonces de l’étude : « Ici, des connectomes spécifiques homme-femme, révèlent non seulement une différence nette dans les capacités cognitives respectives, mais confirment aussi une vraie complémentarité entre les 2 sexes. […] C’est aussi une complémentarité cérébrale homme-femme qui est confirmée avec cette étude » (Santé Log) ; « la “complémentarité comportementale” entre hommes et femmes […] se fonderait bien sur des “substrats neuronaux développementaux” précis » (Le Plus – Le Nouvel Obs) ; « Leurs cerveaux sont branchés de façon complémentaire révèle lundi une recherche menée avec un scanner. Aptitudes et comportements sont propres à chacun des deux sexes » (Midi Libre) ; « L’architecture du cerveau masculin et féminin est donc différente mais aussi très complémentaire » (Top Actus Santé) ; etc.
Les résultats de l’étude ont également été mis en relation avec la conjugalité hétérosexuelle et parfois avec les « problèmes de compréhension » qui lui seraient consubstantiels. Ainsi, le reportage de M6 met en scène un couple hétérosexuel comme fil conducteur et se termine par : « Mais ce qui compte, finalement, c’est bel et bien notre complémentarité » (fin sur l’image du couple qui s’éloigne enlacé). Le reportage de RTL TVI se termine de même par : « Les recherches pour comprendre ce qui nous distingue et nous complète restent encore un domaine à explorer », avec l’image d’un couple hétérosexuel s’éloignant en se tenant par le bras. Dans le reportage de France 2, c’est sur cette phrase que la journaliste laisse le spectateur : « Une étude qui montre aussi la complémentarité des cerveaux masculin et féminin, peut-être la clé pour mieux comprendre le sexe opposé. » Dans Top Santé on nous explique : « Les hommes et les femmes peinent parfois à se comprendre. Ceci pourrait s’expliquer par des différences de comportement. Eh oui, nous ne serions pas branchés de la même manière ». Le journaliste de Futura-Sciences, plus sombre, introduit ainsi son papier : « Les hommes et les femmes peuvent-ils vraiment se comprendre ? Probablement. Mais après de longs efforts. Car qu’on le veuille ou non, il existe des différences entre les sexes. Au niveau cognitif au moins ». Le Matin, plus optimiste, semble compter sur la capacité des femmes à écouter leur conjoint (« Si les femmes sont «multitâche» – c’est- à-dire qu’elles peuvent suivre un film à la TV, écouter leur conjoint et faire leurs ongles en même temps, bref, faire plusieurs choses à la fois – c’est dû à un grand nombre de liaisons neuronales entre le cerveau gauche (plutôt rationnel) et le droit (plutôt intuitif) »).
La notion d’égalité dans la différence, intimement liée à celle de la complémentarité et seule encore audible dans une société ayant intégré l’idéal d’égalité entre les sexes (quoi que certains tentent encore de convaincre que c’est une fausse piste [37]), était également compatible avec les résultats supposés de l’étude concernant les forces et faiblesses de chaque sexe en matière de capacités cognitives. Elle a parfois été explicitement soulignée, comme dans AuFéminin.com avec la mention « Tout le monde y trouve sont compte. Sauf peut-être ceux qui s’efforce à établir une égalité en tous points entre les deux sexes » ou dans Pourquoi Docteur – Le Nouvel Obs : « Au final, cette étude […] pourrait bien contenter tout le monde ».
Quant à la confirmation de stéréotypes de genre répandus, on pourrait difficilement imaginer discours plus propice. La mention explicite que l’étude permettait de « confirmer » des stéréotypes ou « ce qu’on soupçonnait depuis longtemps » est d’ailleurs fréquemment présente : dans l’AFP et toutes ses reprises, dans Pourquoi Docteur – Le Nouvel Obs, dans Maxisciences, dans Top Actus Santé, dans Le Matin, ou encore dans Le Point utilisant carrément l’expression « bons vieux stéréotypes ». Dans le détail, les stéréotypes en question correspondaient généralement à l’idée que les femmes seraient plus aptes à maintenir leur attention, à se souvenir des mots et des visages, à gérer les interactions sociales et à mobiliser un mode de pensée intuitif, mais aussi plus « multitâches » que les hommes qui seraient en contrepartie plus spécialisés, plus performants, plus rapides, plus aptes à enchaîner la perception et l’action (fréquemment associée à l’idée qu’ils seraient naturellement plus doués pour les activités sportives). On relève cependant des variantes qui trahissent des préjugés plus spécifiques (et souvent le sexe) de certains journalistes.
La supposée « plus grande intelligence sociale » des femmes de la dépêche AFP est ainsi devenue une plus grande capacité à « créer du lien social » dans la bouche de la journaliste ayant réalisé le reportage pour France 2 ; trois articles rédigés par des journalistes femmes ont particulièrement insisté sur la supériorité féminine supposée des femmes dans la capacité à accomplir plusieurs tâches à la fois (TerraFemina dans le titre, Top Santé dans l’accroche et surtout Le Matin, dont l’article est structuré autour de l’idée que l’étude confirme et explique pourquoi seules les femmes sont multitâches) ; la rédactrice de Santé Log a introduit l’idée que les hommes étaient meilleurs dans l’exécution d’une seule tâche « manuelle » alors que « les femmes sont meilleures dans la réflexion, […]et plus intellectuelles » (il fallait oser) ; dans le même sens, selon la journaliste femme de Maxisciences l’étude « suggère que le cerveau masculin est plus optimisé pour les aptitudes motrices alors que le cerveau féminin est plus doué pour des aptitudes mentales ».
A l’inverse, le rédacteur du Point qui a repris la dépêche AFP en l’affublant d’un chapeau fantaisiste lui a également ajouté les deux intertitres suivants : « Les hommes plus aptes à apprendre » et « Les femmes plus attentives » ; sous la plume du journaliste homme de Futura-Sciences les meilleures performances supposées des femmes aux tests d’attention et mois bonnes performances supposées aux tests de cognition spatiales sont devenues « la gent féminine sait davantage faire preuve d’attention que son homologue masculine » et « elle se trouve moins brillante en ce qui concerne la capacité à traiter l’information visuelle », le journaliste s’illustrant également par la curieuse idée que « les femmes sont mieux pourvues en matière grise, point de départ de la pensée » alors que « les hommes présentent beaucoup de substance blanche, qui caractérise surtout les connexions entre les différentes régions de l’encéphale» (comme s’il manquait aux femmes les connexions nécessaires à la structuration et la pleine exploitation de leurs débuts de pensées) ; le journaliste homme de Metronews a significativement modifié la dépêche AFP en changeant le titre, devenu « Le cerveau des femmes a moins de connexions que celui des hommes », en introduisant dans le texte un énorme contresens à l’appui de ce titre fantaisiste (« Chez l’homme, en plus d’une plus grande connectivité entre l’avant et l’arrière du cerveau, les images révèlent un grand nombre de branchements entre les deux hémisphères cérébraux ») et en supprimant toute référence à la plus grande capacité supposée des femmes à mobiliser conjointement analyse et intuition. Curieusement, je n’ai en revanche retrouvé nulle part l’idée qui figurait dans l’encadré « significance » de l’article de PNAS que les différences comportementales caractérisant la complémentarité naturelle des hommes et des femmes incluent une « plus grande propension des hommes à l’agressivité physique »…
Il me reste à ce stade à formuler deux vœux en espérant que les personnes concernées recevront le message.
Le premier est que les journalistes prennent une fois pour toutes conscience du fait que les abstracts des articles scientifiques et plus encore les communiqués de presse qui annoncent leur publication sont des textes de nature publicitaire de qualité aléatoire qu’il est criminel de faire passer pour de l’information.
J’aimerais en particulier que les journalistes scientifiques de l’AFP méditent cette parole de leur ancien patron : « Information et communication : la distinction a toujours été très claire au sein de l’Agence ; nous transmettons des informations ou dépêches et non pas des “communiqués”, comme certains le disent de façon erronée. La “religion” des faits, des faits vérifiés et attestés, est au cœur de notre exigence. […] Nous constatons chaque jour les ravages de la libre circulation des rumeurs, voire des fausses nouvelles, sur les plates-formes “libertaires” de la Toile. Ce qui invite à bien réaffirmer la différence entre une information professionnelle et une “information” d’amateur. » Eveno (2004)
Le second est que des chercheurs se donnent la peine de ré-analyser proprement les données de cette étude lorsqu’elles seront disponibles. Mon petit doigt me dit qu’il en sortira des conclusions intéressantes, quoique pas forcément sur les différences entre filles et garçons.
Odile Fillod
PS :
– Article modifié le 26/02/2014 (images du Figaro Madame et annexe 6 ajoutées)
– Pour des informations sur la postérité de cette étude et un nouvel exemple de son instrumentalisation (par Jacques Balthazart, Larry Cahill et Peggy Sastre), voir chapitre III dans “Les cerveaux en bleu et rose selon Jacques Balthazart” (mai 2019)
Annexe 1 : Références
Annexe 2 : Aperçu de l’annonce de l’étude dans les médias francophones
Annexe 3 : Communiqué de presse et dépêches AFP en français
Annexe 4 : Annonces de l’étude sur France 2, M6 et RTL TVI
Annexe 5 : Utilisation des images de connectomes présumés
Annexe 6 : Récapitulatif par média des principales informations erronées
___________________________________
Notes
[1] Le texte intégral de l’article a été mis en ligne le 27/11/2013, rendu accessible aux seuls journalistes accrédités, sous embargo prenant fin le 2 décembre à 3 pm heure de l’Est (20h à Londres et 21h à Paris en hiver). Un résumé journalistique (appelé « tip sheet » par les attachés de presse) également sous embargo leur en a été fourni en même temps, accompagné des coordonnées de l’attaché de presse de l’Université de Pennsylvanie en charge des contacts médias pour cette article. Ce résumé est accessible ici (identique à ce qui a été mis à disposition des journalistes le 27/11). Source : échanges par mail avec un attaché de presse de PNAS.
[2] Source : entretien avec le responsable sciences / santé / environnement de l’AFP.
[3] Voir un exemple récent de dépêche émise par Jean-Louis Santini, tout aussi erronée et élaborée exactement de la même façon, dans https://allodoxia.odilefillod.fr/2013/12/19/alzheimer-facteurs-de-risque/, § « UN PROCESSUS DE PUBLICISATION/VULGARISATION (BANALEMENT) PATHETIQUE » (dans le texte peu après la note 51). Le processus d’élaboration de fausses informations passant par lui n’est cependant pas toujours le même. Par exemple, en ce qui concerne la récente dépêche AFP annonçant la découverte que le lait maternel s’adapte au sexe de l’enfant, reprise notamment par Le Point.fr (lire aussi les commentaires : c’est instructif), interprétation des propos de Katie Hinde vivement démentie par elle-même, la dépêche fautive a d’abord été écrite en anglais par une correspondante de l’AFP à Chicago (qui n’est pas une journaliste spécialisée dans l’actualité scientifique) puis traduite en français par Jean-Louis Santini sans la moindre valeur ajoutée. Correspondant AFP à Washington depuis octobre 1997, cet agencier chevronné y a d’abord traité les sujets relatifs à l’économie, puis ceux relatifs à la politique états-unienne à partir de fin 2002, puis l’actualité scientifique et technique depuis fin 2004.
[4] Sur Sébastien Bohler, voir https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/12/22/arret-sur-mirages/ et https://allodoxia.odilefillod.fr/2013/01/12/arret-sur-lenvers-dun-mirage/. Sur Peggy Sastre, voir https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/06/20/genre-evolution-testosterone/. Sur Jean-Paul Mialet, voir http://www.amazon.fr/Sex-Aequo-quiproquo-Jean-Paul-Mialet/dp/2226220828/ref=la_B004N907HK_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1390300025&sr=1-1 et http://leplus.nouvelobs.com/contribution/204206-la-difference-entre-hommes-et-femmes-est-elle-une-question-d-education.html. Sur Philippe Poindron, voir parmi d’innombrables exemples (catholique militant, ce professeur honoraire est fort prolixe) son très récent billet parlant de « théorie » du genre et appelant à manifester avec La Manif Pour Tous le 2 février 2014 : http://politis-philippe.blogspot.fr/2014/02/nouvelles-de-la-resistance-haine.html.
[5] Voir par exemple http://www.franceinter.fr/personne-peggy-sastre et http://fiches.lexpress.fr/personnalite/peggy-sastre_497225.
[6] Peggy Sastre indique se baser sur http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108906/, un compte-rendu de Brain Storm (Rebecca Jordan-Young) et de Delusions of gender (Cordelia Fine) publié par deux « spécialistes de la question », Margaret M. McCarthy et Gregory F. Ball. Précisons que ce compte-rendu a été publié dans le journal officiel de l’Organization for the Study of Sex Differences et que ces deux chercheurs sont impliqués dans ce domaine depuis la fin des années 1980 : la première travaille sur la neurobiologie des différences entre les sexes chez le rat, le second sur les effets des hormones sexuelles sur le cerveau et le comportement des oiseaux, principalement la caille du Japon (en collaboration avec Jacques Balthazart, dont j’aurai l’occasion de parler prochainement). Selon Peggy Sastre, McCarthy et Ball jugent que Brain Storm est « à côté de la plaque », et ce « notamment parce qu’il se limite à des recherches vieilles de plus de cinquante ans » qui a l’époque nécessitaient certes des recherches ultérieures pour être confirmées , mais « [l]e problème, c’est que ces recherches ultérieures ont depuis été menées ». Sans parler de lire le livre de Jordan-Young, ce qui est manifestement au-delà de ses forces, il aurait suffit à Peggy Sastre de jeter un coup d’œil à la liste des références citées dans Brain Storm (p. 339-378) pour se rendre compte de l’absurdité de son affirmation. Cette ineptie provient en fait de sa lecture trop rapide du passage dans lequel McCarthy et Ball regrettent que Jordan-Young n’accorde pas assez d’attention aux études animales menées depuis le fameux article de Phoenix et al. publié en 1959 sur les cochons d’Inde. Ca n’est en effet pas le sujet de Brain Storm, qui s’attache essentiellement à décortiquer les recherches menées sur l’être humain ayant tenté en vain de mettre en évidence des effets organisationnels des hormones sexuelles similaires à ceux observés sur certains modèles animaux, et dont les résultats tendent au contraire globalement à invalider l’idée que ces modèles sont pertinents pour l’être humain (évidemment, ça ne plait pas à deux chercheurs qui ont consacré leur carrière à l’étude de tels modèles). De plus, la conclusion de leur critique est très loin d’équivaloir au qualificatif « à côté de la plaque » utilisé par Peggy Sastre. Jugez plutôt : « Nonetheless, if one considers the broader biological context of studies of sex differences in brain and behavior in humans, Jordan-Young’s concerns are well-founded. It is indeed difficult to ascertain at present which factors, biological or environmental, cause the documented sex differences in the human brain, although significant evidence suggests that gonadal hormones are among these factors. If one were just looking for a good species among all vertebrates to try to ascertain basic principles that underlie interrelationships among hormones and brain and sex differences, one would certainly not pick Homo sapiens! » (McCarthy et Ball, 2011).
[7] Sous couvert d’anonymat pour certains, car il est toujours délicat pour un chercheur d’attaquer publiquement d’autres chercheurs ou une revue scientifique. Citons (références en Annexe 1) : divers pairs sur PubPeer (3-5 déc), un neuroscientifique britannique sur son blog Neuroskeptic de Discover Magazine (3 déc), une chercheuse en neurobiologie de la perception du langage sur son site Speech Communication Laboratory (3 déc), un maître de conférence en psychologie et sciences cognitives dans The Conversation (3 déc, repris par le Huffington Post le 4 déc), un doctorant en anthropologie évolutive sur son blog scientifique TangledWoof (3 déc), une professeure de neuroimagerie cognitive sur le blog ScienceGrrl (4 déc), une professeure de neuropsychologie développementale sur le ScienceMediaCenter (géré par la Royal Society of New Zealand(4 déc), sur Storify (4 déc) et dans The Guardian (7 déc), un maître de conférences en neurosciences sur le ScienceMediaCenter (4 déc), une professeure de neurosciences cognitives sur le ScienceMediaCenter (4 déc) et dans The Guardian (7 déc), une psychologue spécialisée dans la critique du neurosexisme dans The Conversation (4 déc, repris par Slate le 4 déc), un ex-chercheur en psychologie cognitive et journaliste spécialisé dans Wired (4 déc), un spécialiste anonyme sur son blog scientifique (bien connu des neuroscientifiques et des journalistes spécialisés) The Neurocritic (5 déc), un chercheur en neurosciences dans Salon, deux spécialistes d’imagerie cérébrale respectivement maître de conférence et chercheur en neurosciences dans The Guardian (7 déc), un linguiste également critique régulier du neurosexisme sur Language Log (15 déc), ou encore une professeure de neurosciences connue pour un livre sur les différences entre les sexes (dans lequel elle dénonce certains stéréotypes mais en accrédite d’autres) sur le Huffington Post (30 déc).
[8] Sources pour ce paragraphe : la page www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/study.cgi?study_id=phs000607.v1.p1 à laquelle renvoie l’article de PNAS et la page https://caglab.org/neurodevelopment-study/project-overview vers laquelle celle-ci pointe (accédées le 6 janvier 2014), l’article en question ci ainsi que plusieurs autres articles publiés dans le cadre de ce projet (Gur et al 2012, Gur et al 2013, Satterthwaite et al 2013a, Satterthwaite et al 2014), http://search.engrant.com/project/Grhhx5/neurodevelopmental_genomics_trajectories_of_complex_phenotypes et le CV de Raquel Gur mis à jour en octobre 2013 disponible ici.
[9] C’est le terme qu’emploient les auteurs dans l’article, plutôt qu’ « ethnicity » pourtant utilisé pour décrire la même variable dans d’autres articles publiés à partir de l’analyse de la même cohorte. Leur utilisation du terme « race » plutôt qu’ « ethnicity » pourrait laisser penser aux personnes qui croient que ce concept a une quelconque pertinence biologique, tels Nancy Huston ou Michel Raymond, qu’il s’agit d’une variable déduite du génotype des jeunes concernés. En fait, les auteurs ne le précisent pas dans l’article mais il s’agit de l’appartenance ethnique principale auto-déclarée par chaque enfant, comme on peut le voir dans la description des données du projet qui commencent à être fournies sur le site dédié à leur partage : voir ici (accédé le 6/2/2014). Il est significatif que les chercheurs impliqués dans ce projet distinguent sur ce site les sujets de « race blanche », de « race noire », de « race asiatique », de « race native indien d’Amérique/d’Alaska » et de « race hawaïenne/îlien du Pacifique », réservant le terme « ethnicity » à la distinction à l’intérieur de chacune de ces « races » des sujets se déclarant aussi ou principalement comme « hispaniques/latinos » ou non : voir ici (accédé le 6/2/2014). On voit combien ces distinctions sont éminemment culturelles… Précisons également que la critique de l’usage du terme « race » n’est pas franco-française ni ne relève d’un quelconque « anti-biologisme ». Dans le cas présent par exemple, le doctorant en anthropologie évolutive qui a critiqué cet article sur TangledWoof écrit « they only account for individual age and [their words] ‘race’ », et la professeure de neuroimagerie cognitive qui l’a critiqué sur ScienceGrrl « we don’t know much about the subjects. We know […] their sex and (in the words of the authors) their ‘race’ ».
[10] Ici, le « poids » Pij de l’arête reliant Ri à Rj a été défini comme étant le nombre de fibres théoriques reliant probablement Ri et Rj divisé par le nombre de fibres théoriques partant de ou arrivant probablement à Ri, le tout multiplié par la surface de Ri. Comme il est impossible d’attribuer une direction aux fibres, il n’y a pas de raison de considérer séparément Pij et Pji ni de considérer l’un plutôt que l’autre. Par conséquent, le connectome final utilisé par les auteurs pour leurs analyses – si j’ai bien compris le passage correspondant de l’article, qui n’est pas très clair – était une liste de 4560 valeurs (= 95×94/2 + 95), à raison d’une par couple de régions (Ri, Rj), égales à la moyenne de Pij et Pji. A titre de comparaison, van den Heuvel et Sporns (2011) a défini deux mesures de poids basées sur le nombre de fibres (la troisième étant basée sur l’anisotropie fractionnelle). Pour l’une, le poids Pij était tout simplement égal au nombre de fibres entre Ri et Rj. Selon les auteurs, le problème avec cette mesure est que le volume des différentes régions n’étant pas uniforme, il est possible que les régions les plus grosses aient une plus grande probabilité d’être touchées par une fibre. Pour corriger ce risque de biais, ils ont défini une autre mesure de Pij égale au nombre de fibres entre Ri et Rj divisé par la somme des volumes de Ri et Rj. Ils précisent que cette seconde mesure risque cependant de surcompenser ce risque. Ils ajoutent que des études ont pointé l’effet d’un autre paramètre susceptible de biaiser le comptage des fibres reliant deux régions, à savoir la distance qui les sépare, du fait de la procédure utilisée pour reconstituer les fibres. Ils commentent en ces termes : « The degree to which different normalization strategies may interact, and to which extent they may bias the data to one end or the other, is unknown ».
[11] Les auteurs citent ici quatre articles : Hagmann et al (2010), Bassett et al (2008), Gong et al (2009a) et Sporns et al (2007). Dans Hagmann et al (2010), les chercheurs ont calculé un poids de connexion entre deux régions qui correspond à une densité de connexion : ils l’ont défini comme était égal à la somme (sur toutes les fibres connectant les deux régions) de l’inverse de la longueur de chaque fibre, le tout divisé par la surface totale des deux régions. Ils ont tenu compte de la longueur des fibres plutôt que de simplement les compter afin de corriger le biais en faveur des fibres plus longues (évoqué ci-dessus dans la note précédente). Dans Bassett et al (2008), le poids de la connexion entre deux régions n’a absolument rien à voir : il correspond à la co-variation statistique de leurs volumes de matière grise respectifs, mesurés par IRM structurelle, sur un échantillon de 259 sujets. Dans Gong et al (2009a), les chercheurs expliquent qu’ils se sont contentés de la mesure binaire (présence d’au moins une fibre vs absence), s’étant abstenus de pondérer les connexions en se basant sur le nombre de fibres car celui-ci est selon eux trop fortement dépendant de divers paramètres techniques (en effet). Enfin, Sporns et al (2007) a également utilisé des données de connexions non pondérées (!). Dans Dennis et al (2013) cité dans un autre paragraphe de l’article, les chercheurs ont défini le poids de la connexion entre deux régions comme étant égal au nombre de fibres les connectant divisé par le nombre total de fibres comptées chez le sujet, la normalisation par le nombre total de fibres ayant pour objectif de contrôler les biais induits par la technique de comptage. Dans Gong et al (2009b) qu’ils citent également, c’est une méthode encore différente qui a été utilisée, tenant compte du volume des régions de manière similaire à van den Heuvel et Sporns (2011) cité dans la note précédente. Dans Yan et al (2011) qu’ils citent aussi, c’est la même méthode de pondération que celle de Hagmann et al (2010) qui a été utilisée, etc.
[12] Les propriétés de réseaux non pondérés classiquement étudiées sont les suivantes :
– longueur de chemin caractéristique = moyenne des longueurs de chemin entre chaque paire de nœuds, la longueur de chemin étant définie comme le nombre d’étapes (arêtes) pour aller d’un nœud à l’autre (cette notion ne correspond pas à la distance physique réelle entre les deux nœuds),
– efficacité globale = moyenne de l’inverse des longueurs de chemins (l’idée sous-jacente est que moins on a d’ « étapes » à faire pour aller d’un nœud à un autre, plus le réseau est « efficace »),
– coefficient de regroupement moyen = moyenne des coefficients de regroupement de chaque nœud, i.e. de la fraction des « voisins » d’un nœud (les nœuds auxquels il est directement connecté) qui sont aussi connectés entre eux,
– transitivité = nombre de triplets de nœuds directement interconnectés (i.e. de triangles dessinés par les arêtes) divisé par le nombre total de triplets de nœuds,
– modularité = quantification de la mesure dans laquelle le réseau peut-être divisé en regroupements faiblement interconnectés de nœuds intensément interconnectés,
– small-worldness = moyenne sur tous les nœuds du coefficient de regroupement d’un nœud rapporté à sa longueur de chemin moyenne,
– degré = nombre d’arêtes par nœud,
– densité = nombre d’arêtes rapporté au nombre maximal possible compte tenu du nombre de nœuds,
– betweenness centrality de chaque nœud = fraction de tous les chemins les plus courts entre deux nœuds contenant chaque nœud.
Ces mesures peuvent être utilisées soit brutes, soit normalisées. Dans ce dernier cas, on les rapporte en principe à la valeur correspondante observée en moyenne dans des réseaux générés aléatoirement contenant le même nombre de nœuds et le même nombre d’arêtes que le réseau considéré. De nombreuses autres mesures existent, et pour certaines d’entres elles plusieurs méthodes de calcul différentes existent. Ainsi, la transitivité et la modularité peuvent être définies non pas comme ci-dessus en ne tenant compte que du nombre d’arêtes mais comme cela a été fait dans l’article en question ici en tenant compte de leurs poids.
[13] La valeur du test t sur la variable sexe a été calculée pour chacune des 4465 arêtes, après régression linéaire de chaque poids d’arête sur l’âge, le sexe, et l’interaction entre âge et sexe. Il n’était pas pertinent ici de faire un simple test de significativité statistique de chaque valeur T au seuil habituel p=0.05. En effet, les chercheurs ont mécaniquement trouvé des dizaines de différences ayant moins d’une chance sur 20 (p< 0.05) d’être observées dans cet échantillon même si elles n’existent pas en réalité dans la population qu’il est censé représenter. Si on lance un dé une fois on a une chance sur six de tomber sur le 1, mais si on en lance 4465 à la fois on a beaucoup plus qu’une chance sur six qu’au moins un d’entre eux tombe sur le 1. Il faut donc définir un seuil de significativité statistique beaucoup plus exigeant pour considérer qu’un des 4465 dés est tombé sur le 1 parce qu’il était pipé et non tout simplement par hasard. Déterminer quelle méthode est la plus pertinente pour redéfinir ce seuil peut s’avérer délicat.
[14] Selon Fornito et al (2013), si on applique la correction de Bonferroni (la méthode la plus conservatrice) à l’analyse des 4950 arêtes non orientées existant entre 100 régions d’un connectome, pour une arête donnée il faut pour rejeter l’hypothèse nulle au niveau conventionnel (p < 0.05) que la valeur de p calculée avec la méthode classique soit inférieure à 0.0000101. Pour adresser le problème des comparaisons multiples sans mettre la barre aussi haut, ce qui peut se justifier, les auteurs ont utilisé ici le principe du test de permutation avec seuil unique proposé dans Nichols & Holmes (2002). Ils ont généré 20 000 permutations aléatoires des sexes des 949 participants, calculé pour chaque permutation les valeurs T associées au sexe pour chaque connexion, et retenu à chaque fois la valeur maximale parmi ces 4465 valeurs. Ils ont alors construit un histogramme des ces 20 000 valeurs de T maximales, et calculé sur cette base celle correspondant au seuil de significativité statistique égale à p=0.05. C’est ensuite ce seuil qui a été appliqué aux valeurs T trouvées pour chaque connexion dans l’échantillon : seules celles ayant un T supérieur à ce seuil ont été considérées comme différant significativement entre garçons et filles. Dans un autre article, les auteurs ont procédé autrement : ils ont identifié les arêtes pour lesquelles il y avait une différence significative en utilisant la procédure de false-discovery-rate (FDR) proposée par Genovese et al (2002), et dans les illustrations de comparaisons de connectomes similaires à celles fournies ici ils n’ont montré que les arêtes pour lesquelles la différence testée avait survécu à la correction de Bonferroni (cf Satterthwaite et al , 2013b, fig. 3 – C, p.50). Dans Gong et al (2009b) qu’ils citent ici, c’est également la procédure de false-discovery-rate (FDR) proposée par Genovese et al (2002) qui a été suivie pour décider si les différences entre les sexes observées dans un connectome similaire (basé sur la parcellisation du cortex en 78 régions) étaient statistiquement significatives. Dans Gong et al (2009a) qu’ils citent également, pour décider pour quelles arêtes, parmi les 3003 théoriquement possibles entre deux régions différentes, la procédure de tractographie indiquait une connectivité anatomique statistiquement significative, ils ont utilisé la correction de Bonferroni. Voir Nichols & Holmes (2002) pour des exemples concrets d’application de test de permutation montrant le caractère beaucoup moins conservateur de cette méthode comparée à d’autres (Figure 6 p.17 et Table 1 p.20).
[15] Le schéma 5 de la figure 1 classe les nœuds en 6 groupes : frontal, temporal, pariétal, occipital (soit les 4 lobes du cortex), sous-cortical et cervelet, ce qui laisse à penser qu’ils ont défini 6 x 2 « lobes » correspondant à chacun de ces regroupement dans chaque hémisphère et non considéré seulement les 4 x2 lobes du cortex (à noter que dans la légende de la figure 2 sont distingué 5 types de nœuds seulement, les nœuds sous-corticaux incluant ici le cervelet). Cette hypothèse est étayée par deux éléments portant sur une autre mesure (PC) également définie par lobe selon leur définition : dans la figure 3, on voit représenté le résultat d’un calcul sur le cervelet, qui par définition n’appartient pas à la liste des 4 x 2 lobes du cortex cités ci-dessus, et dans la table 3 on trouve le résultat de calculs sur le nœud représentant le cervelet ainsi que sur deux nœuds hors cortex et hors cervelet, représentant chacun une région sous-corticale (noyau caudé et putamen). Dans la description détaillée de la méthode en fin d’article, les auteurs n’expliquent pas ce qu’ils entendent par « lobe » pour le calcul de LCW et de PC. Pour le calcul de la transitivité, ils précisent qu’ils ont divisé le « cerveau » en 8 lobes (frontal droit et gauche, etc). De deux choses l’une : soit ils n’ont pas utilisé la même définition des « lobes » pour LCW, PC et transitivité, soit ils ont utilisé la même, et dans cas puisqu’ils mentionnent des nœuds sous-corticaux et du cervelet dans leur calcul de PC ça signifie qu’ils ont affecté ces nœuds à des lobes du cortex, ce qui serait très inhabituel, discutable, et mériterait d’être précisé : ont-ils considéré que le cervelet faisait partie du cortex occipital ? A quel lobe ont-ils affecté le thalamus ? Si pour LCW et/ou la transitivité ils ont utilisé une définition des lobes différente de celle de PC, de telle sorte que seuls les lobes du cortex sont considérés, ça mériterait non seulement d’être signalé mais aussi d’être justifié.
[16] Par exemple, dans un article qu’ils citent, lorsque les chercheurs ont cherché parmi les 78 nœuds de leur connectome ceux pour lesquels il y avait une différence entre les sexes dans l’ « efficacité régionale », ils ont utilisé la procédure de correction par le false-discovery-rate (cf Gong et al, 2009b, p. 15690).
[17] Une différence moyenne entre deux groupes observée sur un échantillon est statistiquement significative si on peut raisonnablement faire l’hypothèse qu’elle est généralisable à la population dont l’échantillon a été tiré, pour peu que cet échantillon en ait été tiré complètement au hasard (ou au moins qu’il ne souffre pas d’un biais de sélection évident, comme on a vu que c’était le cas ici). La significativité statistique d’une différence ne préjuge pas de sa signifiance, c’est-à-dire de sa taille ou de ses conséquences concrètes : plus on prend un échantillon de grande taille, plus on peut trouver de différences significatives même si elles sont infimes ou concrètement négligeables.
[18] Ils ont eux-mêmes publié en juin 2013, à partir des données de la même cohorte de jeunes, un article qui traite spécifiquement de ce problème pour les connectomes tirés de données d’IRMf (Satterthwaite et al, 2013b). Dans Satterthwaite et al (2013a), ils ont logiquement inclus ce paramètre dans les variables de contrôle lors de leur analyse statistique des connectomes de cette cohorte. La littérature scientifique existant sur ce problème commence à s’étoffer, certains auteurs ayant d’ailleurs rapporté que même en incluant ce paramètre dans les équations de régression, on ne corrigeait pas forcément entièrement des artefacts systématiques dus aux mouvements : cf Power et al (2012).
[19] Lewis et al. (2009) a ainsi trouvé sur un échantillon d’adultes que plus les connexions à longue distance qui relient les deux hémisphères étaient longues, comme c’est le cas dans les cerveaux plus gros, plus le degré de connectivité estimé entre les régions reliées par ces connexions était faible. Ce résultat pourrait selon les auteurs conforter l’hypothèse selon laquelle en raison de l’accroissement des délais de conduction et des coûts cellulaires liés aux connexions à longue distance, les cerveaux plus gros contiendraient relativement plus de connexions à plus courte distance. D’autre part, dans l’un des articles qui a rendu le couple Gur célèbre, je note que nos auteurs commentent le constat du pourcentage de matière grise plus grand chez les femmes que chez les hommes et de celui de matière blanche plus grand chez les hommes que chez les femmes en expliquant que cela met « davantage de tissus à disposition pour le calcul des informations relativement à leur transfert entre région distantes » chez les femmes, ce qui est selon eux « une stratégie évolutive raisonnable car les petits crânes transfèrent les informations sur de plus courtes distances, et par conséquent pourraient avoir relativement moins besoin de matière blanche » (Gur et al, 1999, p. 4065 et 4070, ma traduction). Comme cela a été suggéré sur ScienceMediaCenter par un neuroscientifique ayant critiqué l’article dont il est question ici, il est aussi possible que dans la mesure où la technique utilisée ici est sensible à la distance physique entre deux nœuds, les connexions à longue distance pourraient sembler d’autant plus faibles que le cerveau serait gros, mais cette moindre connectivité à longue distance ne serait qu’apparente. Dans un cas comme dans l’autre, l’augmentation de la taille du cerveau pourrait causer une augmentation du rapport connectivité locale/connectivité à longue distance, que ce soit en termes de connectivité réelle ou de connectivité apparente, or c’est justement une des différences trouvées ici entre garçons et filles. Une autre possibilité, suggérée sur Language Log par un autre expert ayant critiqué l’étude, est que du fait de la plus grande densité de la matière grise et du plus petit volume de matière blanche chez les filles que chez les garçons en raison de la plus petite taille de leur boîte crânienne, l’IRM de diffusion détecte moins bien chez elles les connexions intra-hémisphériques à courte distance car la diffusion des molécules d’eau à l’intérieur d’une matière grise plus compact est moins clairement orientée. Cela pourrait à nouveau expliquer l’observation faite ici par les auteurs d’un rapport connectivité à longue distance/connectivité locale plus grand chez les filles que chez les garçons, mais d’une autre manière. Un effet inverse de la taille du cerveau a été suggéré par une neuroscientifique sur le Huffington Post : selon elle, les cerveaux plus gros ont besoin de voies neuronales de plus gros calibre pour relier leurs régions relativement plus distantes physiquement que dans les petits cerveaux, et ce plus gros calibre se traduit en termes de nombre accru de fibres théoriques comme on l’a vu. Par conséquent, la plus grande taille moyenne du cerveau des garçons pourrait être la cause d’une plus grande connectivité à longue distance entre avant et arrière du cerveau à l’intérieur d’un même hémisphère.
[20] Ces deux notions ne sont pas tout à fait équivalentes, le volume du cerveau pouvant être calculé de différentes manières. Ainsi, Yan et al (2011) cité ici a considéré que ce volume était égal à la somme des volumes de matière grise, de matière blanche et de liquide céphalo-rachidien (hors cervelet semble-t-il), et vérifié si les résultats obtenus en enlevant le volume de liquide céphalo-rachidien étaient équivalents.
[21] L’étude rapportée dans Tomasi & Volkow (2012a) est basée sur des données d’IRM fonctionnelle au repos. Les chercheurs ont comparé la « densité de connectivité fonctionnelle » à relativement « courte » et « longue » distances dans l’hémisphère gauche et dans l’hémisphère droit du cortex, calculé un indice de latéralisation de cette densité (comparaison entre hémisphères gauche et droit), et comparé cet indice entre 408 hommes et 505 femmes issus du 1000 Functional Connectomes Project âgés de 13 à 85 ans. Ils rapportent que cette densité était davantage latéralisée à droite chez les hommes que chez les femmes dans le cortex temporal supérieur pour les connexions locales comme pour celles à longue distance (différence entre les sexes la plus proéminente selon les auteurs), dans le cortex frontal inférieur pour les connexions locales seulement, et dans le cortex occipital inférieur pour les connexions locales seulement, et davantage latéralisée à gauche chez les femmes que chez les hommes dans le cortex frontal inférieur pour les connexions à longue distance seulement. Ils commentent ces résultats en relevant qu’ils étayent l’hypothèse d’une plus grande latéralisation de la connectivité locale chez les hommes, mais qu’ils font en même temps apparaître une plus grande latéralisation de la connectivité à longue distance « chez les femmes dans certaines régions (cortex frontal inférieur) et chez les hommes dans d’autres (cortex temporal supérieur) ». Dans ce champ d’études, la plus grande latéralisation cérébrale en général attribuée aux hommes est interprétée en termes de moindre collaboration des deux hémisphères et mise en relation avec une moindre connectivité structurelle inter-hémisphérique supposée. Les résultats de cette étude aussi originale et complexe que l’article dont il est question ici sont bien-sûr à interpréter avec beaucoup de précautions et ne sauraient être considérés comme établis.
[22] L’étude rapportée dans Tomasi & Volkow (2012b) est basée sur des données d’IRM fonctionnelle au repos obtenues sur 225 hommes et 336 femmes âgés de 18 à 30 ans. Les chercheurs ont trouvé que les hommes avaient des cerveaux en moyenne plus volumineux de 13.57 %, 11.05 % de matière grise en plus, 15.61 % de matière blanche en plus et 19.82 % de liquide céphalo-rachidien en plus. Ils ont logiquement (pas comme nos auteurs…) commencé par neutraliser l’effet du volume du cerveau. Comme après cette opération il subsistait des différences – les femmes avaient cette fois 2.46 % de matière grise en plus, 1.90 % de matière blanche en moins et 6.06 % de liquide céphalo-rachidien en moins –, ils ont également contrôlé l’effet de ces variables. Ils trouvent une « densité de connectivité fonctionnelle locale » beaucoup plus grande chez les femmes que chez les hommes. Même après contrôle de l’âge et des quatre paramètres ci-dessus, la différence restait en faveur de femmes à hauteur de 14 %. Ils commentent ces résultats notamment en ces termes : « The main finding is that women had 14% higher lFCD than men, even after controlling for differences in TBV, GM, WM, and age, suggesting that lFCD differences reflect brain organization differences between genders rather than GM effects. […] Recent studies using diffusion magnetic resonance imaging (MRI) tractography reported that cortical networks showed greater overall anatomical connectivity and more efficient organization in the female than in the male brain [Gong et al., 2009] […] Our results are consistent with the women’s higher global anatomical connectivity reported by diffusion tensor imaging studies [Gong et al., 2009] » (souligné par moi).
[23] Cette notion d’ « efficacité » issue de la théorie des graphes ne correspond pas à notion d’efficacité réelle (par exemple en termes de rapidité) du réseau de connexions cérébrales représenté par le connectome. Elle dépend du nombre d’arêtes à parcourir pour aller d’un nœud à un autre : moins il y en a, plus l’ « efficacité » est grande. Voir la note [12] ci-dessus pour le mode de calcul de l’efficacité globale d’un graphe. L’efficacité locale d’un nœud est calculée comme l’efficacité globale mais uniquement pour les paires de nœuds l’incluant, et l’efficacité locale de l’ensemble du graphe est la moyenne des efficacités locales de tous ses nœuds. Dans cette étude, l’efficacité locale de l’ensemble du connectome était en moyenne significativement plus grande chez les femmes, et significativement différente entre les sexes pour 8 régions sur 78 : 6 telles que femmes > hommes et deux en sens inverse (dans le cortex frontal droit).
[24] Par exemple, selon Giedd et al (2012) déjà cité, si les fonctions du cervelet « ont traditionnellement été décrites comme étant relatives au contrôle moteur, il est maintenant communément admis qu’il est également impliqué dans le traitement des émotions et dans d’autres fonctions cognitives de haut niveau qui suivent un processus de maturation au cours de l’adolescence ». Le cervelet représente environ 11% du volume total du cerveau mais contient plus de la moitié du nombre total de ses neurones. D’après des données très préliminaires citées dans cette revue de la littérature, le volume du cervelet pourrait suivre une courbe de développement en U inversé, avec un pic vers 12 ans chez les filles et vers 15 ans et demi chez les garçons, et pourrait être en moyenne de 10 à 13% plus gros chez les garçons que chez les filles selon l’âge de comparaison.
[25] Cf ses mots rapportés dans HealthDay à propos de l’article en question ici : « Still, the findings “confirm our intuition that men are predisposed for rapid action, and women are predisposed to think about how things feel,” said Paul Zak, who’s familiar with the study findings. “This really helps us understand why men and women are different,” added Zak, founding director of the Center for Neuroeconomics Studies at Claremont Graduate University in California. […] To put the results another way, “men’s brains are biased toward rapid understanding of a situation and how to respond to it, especially in how to act and move in response to information,” Claremont’s Zak said. “Women’s brains are biased toward integrating information with feelings.” The findings suggest the hormones that begin to kick in during adolescence push the male and female brains in different directions, he said. What does all this mean in the context of people’s day-to-day lives? “It tells us why, almost always, when men and women are in a car together, the man drives,” Zak contended. “His brain is biased toward being better at moving a vehicle along a road and going to the right place, the stereotype of the lost man notwithstanding.” Also, “women maintain and value friendships and other relationships better than men do. Men can have many friends, but on average we are less good at this,” Zak said. »
[26] La prose inepte de Jean-Pierre Dickès se conclut ainsi : « Personne ne s’étonnera guère de la publication effectuée par ce savant dans la revue Pen Medecine (2 décembre dernier) dans laquelle il affirme que le cerveau de la femme est différent de celui de l’homme. Voilà qui tient du bon sens. Il a étudié les IRM fonctionnelles de 524 filles et 421 garçons entre 8 et 22 ans. L’homme est celui qui capte les informations, les coordonne en vue de l’action. La femme est celle qui a l’intuition et le sens de l’analyse ; elle combine mieux les deux hémisphères. Il en résulte que les hommes sont doués pour certains métiers et les femmes pour d’autres. En réalité hommes et femmes sont complémentaires. C’est ce que nient les tenants du gender qui s’imaginent qu’en élevant un garçon comme une fille on en fera une fille et inversement. » (Médias-Presse-Info, 4/12/2013). Médias-Presse-Info est un site web monté en septembre 2013 qui sert à diffuser une propagande ultraconservatrice, catholique et nationaliste sous couvert d’information. Le Dr Jean-Pierre Dickès, médecin retraité, est président de l’Association catholique des Infirmières et Médecins. Il milite notamment contre la « théorie du genre » et la « destruction de la famille » : voir par exemplehttp://www.laportelatine.org/district/prieure/NDdeFatima/confdickes120208/dickes120208.php et http://www.enquete-debat.fr/archives/dr-jean-pierre-dickes-l-ultime-transgression-85063.
[27] Pour se faire une idée du positionnement des Gur au sein de ce champ de recherches, voir par exemple Today Health (2006) : « Men may not be from Mars and women may not be from Venus, but that doesn’t mean the sexes have the same wiring. Dr. Ruben Gur and his wife, Dr. Raquel Gur, two of the world’s premier experts on gender differences in the human brain, have been studying men and women for more than 30 years. The neuroscientists were the first to show, with brain imaging methods, that the sexes may not have the same hard wiring, after all. “A lot of the differences between men and women are related to how they are built rather than how they are taught,” says Dr. Ruben Gur who works with his wife at the Brain Behavior Center of the University of Pennsylvania’s Department of Psychiatry. Using an MRI scanner, the couple monitors how the brains of males and females react when their volunteers are instructed to answer emotional, verbal, and spatial questions. “Estrogen and progesterone are likely to be important factors when we talk about biological differences, but it is likely to go even beyond that,” says Dr. Raquel Gur. ». Voir aussi Pinker (2005, p.404-405) : « Comme nous allons le voir, les neurosciences, la génétique, la psychologie et l’ethnographie mettent en évidence des différences entre les sexes qui sont presque certainement d’origine biologique. […] En premier lieu, la recherche sur le fondement biologique des différences entre les sexes a été menée par des femmes. Comme on dit souvent que cette recherche est un complot pour maintenir les femmes dans leur position d’infériorité, je suis bien obligé de citer des noms. Les chercheurs sur la biologie des différences entre les sexes comprennent les chercheuses en neurosciences Raquel Gur, Melissa Hines, Doreen Kimura, Jerre Levy, Martha McClintock, Sally Shaywitz et Sandra Witelson, ansi que les psychologues Camilla Benbow, Linda Gottfredson, Diane Halpern, Judith Kleinfeld et Diane McGuinness. »
Raquel et Ruben Gur ont fait leurs études ensemble d’abord en Israël puis aux Etats-Unis, où ils sont installés depuis le début des années 1970 et ont mené ensemble une très grande partie de leurs recherches. Raquel s’est spécialisée dans l’approche biologique des psychoses (recherche de corrélats neurobiologiques et de facteurs de risque génétiques). Après un doctorat en psychologie clinique et développementale, elle a intégré le département de psychiatrie de l’Université de Pennsylvanie en 1975. Elle y a ensuite obtenu un doctorat en médecine (1980) puis y a suivi une formation complémentaire en neurologie et en psychiatrie (elle n’est cependant ni psychiatre, ni neurologue certifiée). Elle y dirige depuis 1984 la section de Neuropsychiatrie à laquelle est rattaché le laboratoire qu’elle dirige avec Ruben. A fin 2013, elle était co-auteur de plus de 350 articles scientifiques. Début 2000 elle été classée 16ème d’un classement mondial des auteurs d’articles à plus fort impact publiés dans le domaine de la psychiatrie sur la période 1990-1998 : cf Thomson ISI (2000) ; pour établir ce classement, les 200 articles les plus cités par d’autres – selon les données de la base Thomson-ISI à juin 1999 – publiés chaque année soit dans une revue indexée dans la catégorie « Psychiatry »de Thomson-ISI, soit dans les revues Science, Nature ou PNAS ont été retenus, puis leurs auteurs ont été classés en fonction du nombre total de citations de ces « articles à fort impact » ; Raquel Gur avait signé seize des 1800 articles ainsi sélectionnés sur la période 1990-1998 et ces seize articles avaient recueilli à eux seuls 1089 citations à juin 1999, ce qui la plaçait au 16ème rang du classement des auteurs). Présidente en 2007 de la Société de Psychiatrie Biologique, elle est membre de son comité exécutif depuis 2008 et a travaillé à l’élaboration du DSM5 pour ce qui concerne les psychoses.
Ruben Gur est docteur en psychologie, spécialisé en neuropsychologie clinique, et travaille également à l’Université de Pennsylvanie depuis 40 ans. Ses recherches ont porté sur l’identification de caractéristiques cérébrales et cognitives générales chez les sujets sains ou atteints de troubles psychiatriques et se sont particulièrement focalisées sur l’utilisation des techniques de neuroimagerie dès que celles-ci sont devenues accessibles. Il a notamment cosigné le chapitre consacré à « L’évolution des différences entre les sexes dans la cognition spatiale » de Evolutionary Cognitive Neuroscience (MIT Press, 2006), ouvrage de référence de ce courant de pensée et de recherches co-dirigé par Steven Platek, Julian Paul Keenan et Todd K Shackelford dans lequel on trouve également des contributions de Simon Baron-Cohen, Philippe Rushton, Robin Dunbar, Helen Fischer et David Puts entre autres.
Les Gur ont publié ensemble en 1974 leur premier article sur les différences entre les sexes (Gur & Gur, 1974). Ils y rapportent une étude de la corrélation entre l’hypnotisabilité et le nombre de mouvements des yeux vers la droite chez des sujets mis face à un examinateur leur soumettant des problèmes sollicitant les capacités verbales ou spatiales (censée mettre indirectement en évidence l’hémisphère cérébrale dominante chez les sujets testés). Dans leur échantillon d’étudiants, ils avaient alors trouvé que le sens et la significativité statistique de la corrélation variait en fonction du sexe des sujets combiné à leur latéralisation manuelle (gaucher/droitier) et à leur latéralisation occulaire (œil dominant = gauche ou droit). Ils avaient également trouvé que les latéralisations manuelle et occulaire étaient significativement corrélées entre elles chez les hommes mais pas chez les femmes de leur échantillon. Ce constat les avait amenés à approfondir la recherche de relations entre latéralisation (manuelle, occulaire ou autre) et performances cognitives, et la modulation de ces relations par le sexe. C’est ce qui constitue la ligne directrice fondamentale de leurs recherches depuis 40 ans. La plupart des articles du couple Gur ne portant pas sur la schizophrénie ont porté sur les différences entre hommes et femmes dans la structure ou le fonctionnement du cerveau (sachant que ceux sur la schizophrénie portent également souvent sur cette question, l’une de leurs hypothèses de travail étant que la schizophrénie est liée à une altération du « dimorphisme sexuel normal » du cerveau humain). En voici les principaux avec leur nombre de citations (source : Web of Science interrogé en janvier 2014, rang en termes de citations parmi les près de 500 articles publiés par l’un et/ou l’autre) : Gur et al (1982, 281 citations, 10ème), Gur et al (1990, 64 citations), Gur et al (1991, 269 citations, 11ème), Cowell et al (1994, 205 citations, 25ème), Gur et al (1995, 241 citations, 17ème), Gur et al (1999, 339 citations, 7ème), Gur et al (2000, 150 citations), Ragland et al (2000, 49 citations), Mozley et al (2001, 133 citations), Gur et al (2002a, 140 citations), Gur et al (2002b, 53 citations), Dubb et al (2003, 43 citations) , Wang et al (2007, 82 citations). Références détaillées en Annexe 1.
[28] Ragini Verma est l’auteur correspondant de l’article, mais le projet de recherche dans son ensemble avait Raquel Gur pour investigateur principal. Les Gur sont co-auteurs de toutes les publications qui ont été faites dans le cadre de ce projet, avec leurs noms en premier et/ou en dernier sauf pour celui-ci. Ragini Verma n’est investigateur principal que pour des sous-projets associés à l’une des lignes de financements par le NIMH utilisées pour produire cet article, et ceux-ci portaient spécifiquement sur la schizophrénie et sur l’autisme (Cf http://search.engrant.com/researcher/j7Bq11/ragini_verma). Le communiqué de presse annonçant la publication de l’article inclut des propos de Ruben Gur, et c’est lui (seul) qui a été interviewé par CBS le lendemain de la publication de l’article, et il est présenté dans le reportage comme celui qui a mené cette étude, le nom de Verma n’étant même pas mentionné. Les contributions déclarées des signataires de l’article sont les suivantes : conception de l’étude = M. Ingalhalikar, T. D. Satterthwaite, R.E. Gur, R.C. Gur et R. Verma (école de méd. de l’Univ. de Pennsylvanie) et H. Hakonarson (Hôp. pour enfants de Philadelphie); rédaction de l’article = M. Ingalhalikar, R.E. Gur, R.C. Gur et R. Verma; réalisation de l’étude = A. Smith, M. A. Elliott et K. Ruparel (école de méd. de l’Univ. de Pennsylvanie) et H. Hakonarson (Hôp. pour enfants de Philadelphie); analyse des données = A. Smith et D. Parker. (école de méd. de l’Univ. de Pennsylvanie, section d’analyse des images biomédicales).
[29] « The lack of a significant age-by-sex interaction in the connection-based analysis suggests that although there are not statistically significant differences in the trajectory of developmental effects between males and females, analyses of age groups allows the description of the magnitude of the sex difference during the stages of development » (p. 825).
[30] Dans Le Matin, la journaliste ne met pas un instant en doute l’idée que l’étude a démontré l’existence d’une différence de câblage qui explique tout un tas de différences cognitives et comportementales entre hommes et femmes dont l’existence lui paraît évidente. La seule distance critique qu’elle prend vis-à-vis de l’interprétation des auteurs de l’étude consiste à invoquer les effets des interactions avec l’environnement sur le développement des connexions cérébrales (en citant un extrait d’une interview qu’elle avait faite en novembre 2011 de la neurobiologiste Catherine Vidal), ajoutant maladroitement qu’une observation de chercheurs « va dans ce sens, puisque les chercheurs ont observé qu’il y avait peu de différences de connectivités cérébrales entre les sexes chez les enfants de moins de 13 ans. Ce n’est qu’à partir de 14-17 ans qu’elles deviennent plus prononcées ». Dans Causette, la seule critique formulée est également la non prise en compte de la plasticité cérébrale par les chercheurs, et le journaliste ajoute : « Mais il ne faut pas tout rejeter en bloc : il serait également antiscientifique de nier par principe, et au nom d’une quelconque égalité, la part d’inné dans les différences homme-femme » (souligné par moi). Sur FranceTVinfo, le texte reprend l’essentiel de la dépêche AFP en ajoutant deux références censées permettre de prendre une distance critique vis-à-vis des affirmations des chercheurs, mais maladroitement pour le moins : l’une se réfère à nouveau à des propos de Catherine Vidal, mais présentés de telle manière qu’on peut penser que cette nouvelle étude les dément, l’autre à des propos de Jean-François Bouvet (présenté à tort comme « neurobiologiste ») censés tordre le cou aux idées reçues mais qui en fait les conforte et les naturalise, faux arguments biologiques à l’appui, et contredit Catherine Vidal. Il se termine en effet ainsi : « En mai, la neurobiologiste et directrice de recherche à l’Institut Pasteur, Catherine Vidal, estimaient pourtant dans Le Monde [lien hypertexte vers l’article en question] qu’“il est impossible de deviner si un cerveau appartient à un homme ou une femme”. Et fin 2012, le neurobiologiste Jean-François Bouvet assurait dans Le Point [lien hypertexte vers l’article en question] que “les différences entre les deux restent néanmoins limitées”. ». Dans cet interview par Le Point, Jean-François Bouvet assure au contraire (fallacieusement) que les chercheurs sont « capables de reconnaître, en soumettant le cerveau à une IRM, s’il s’agit d’un homme ou d’une femme » (pour la critique de certaines des affirmations faites par Jean-François Bouvet notamment dans cet article du Point, voir https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/12/09/habemus-sex-papam/, https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/12/10/habemus-sex-suite/ et ma réponse à https://allodoxia.odilefillod.fr/2012/12/09/habemus-sex-papam/#comment-1331, ainsi que https://allodoxia.odilefillod.fr/2013/10/04/sexes-mensonges-et-video-baron-cohen/). Dans Réponse à tout ! la journaliste reprend une citation de Catherine Vidal contre l’idée que les différences entre hommes et femmes éventuellement de observées dans leurs connexions cérébrales ou dans leurs capacités ou comportements sont nécessairement d’origine biologique, mais : 1) elle ajoute un lien vers l’article qu’elle avait publié fin octobre 2013 instrumentalisant l’étude dont j’avais parlé ici à l’appui de l’idée que les femmes ne seraient pas plus multitâches que les hommes, alors que cette étude (bidon) naturalise une supériorité supposée des hommes en la matière ; 2) reprend en les exagérant encore les fausses informations de la dépêche AFP (ex : « L’équipe de scientifiques a constaté que l’homme présentait, en général, une plus grand connectivité neuronale que la femme entre l’avant du cerveau (zone de la coordination de l’action) et l’arrière, où se situe le cervelet (zone relative à l’intuition) »).
[31] Dans l’article de BBC News , les commentaires critiques suivants étaient presents : « But experts have questioned whether it can be that simple, arguing it is a huge leap to extrapolate from anatomical differences to try to explain behavioural variation between the sexes. Also, brain connections are not set and can change throughout life. […] Prof Heidi Johansen-Berg, a UK expert in neuroscience at the University of Oxford, said the brain was too complex an organ to be able to make broad generalisations. “We know that there is no such thing as ‘hard wiring’ when it comes to brain connections. Connections can change throughout life, in response to experience and learning”. “Often, sophisticated mathematical approaches are used to analyse and describe these brain networks. These methods can be useful to identify differences between groups, but it is often challenging to interpret those differences in biological terms”. Dr Michael Bloomfield, Clinical Research Fellow at the Medical Research Council Clinical Sciences Centre in London, said […] care must be taken in drawing conclusions from the study, as the precise relationships between how our brains are wired and our performance on particular tasks needed further investigation. “We cannot say yet that one is causing the other”. “Furthermore, the measure used in the study, called ‘connectivity’, is only one aspect of how our brains our wired”. “We think that there can also be differences in certain chemicals in the brain called neurotransmitters, for example, and so we need more research to fully understand how all these different aspects of brain structure and function work together to answer fundamental questions like ‘how do we think?’ ” “One thing that remains unknown is what is driving these differences between the sexes. An obvious possibility is that that male hormones like testosterone and female hormones like oestrogen have different affects on the brain”. “A more subtle possibility is that bringing a child up in a particular gender could affect how our brains are wired.” ». Seuls certains de ces commentaires ont été repris dans L’Express, et ce d’une manière lapidaire qui les rend nettement moins convaincants, le titre de l’article (« Les femmes et les hommes n’utilisent pas leur cerveau de la même façon ») les contredisant en outre. Par ailleurs, on peut lire dans L’Express le paragraphe suivant : « Des tests complémentaires ont été menés, montrant que “les femmes ont de meilleurs résultats en matière de concentration ou de mémorisation, alors que les hommes sont meilleurs en appréhension de l’espace”, développe le site de la BBC. ». Voici pourtant ce qui figurait sur ledit site : « On a demandé aux mêmes volontaires de réaliser une série de test cognitifs […]. Dans cette étude, les femmes ont eu de bons scores d’attention, de mémoire des mots et des visages et de cognition sociale, tandis que les hommes ont eu de meilleures performance en traitement des informations spatiale et en vitesse sensorimotrice » (ma traduction).
[32] Pour chacune des comparaisons, il aurait fallu vérifier que l’hypothèse de normalité était raisonnable dans l’échantillon de filles et dans l’échantillon de garçons pour pouvoir faire un test t, or les auteurs ne disent pas avoir fait cette vérification. En toute rigueur il aurait également fallu que les populations féminine et masculine soient échantillonnées de manière indépendante, mais ne chipotons pas. Par ailleurs, les auteurs ne disent pas quelle sorte de test t ils ont fait. Si c’est le test t de Student, puisqu’ils n’avaient pas le même nombre de filles que de garçons il fallait vérifier que l’hypothèse d’égalité des variances était raisonnable, ce qu’ils ne disent pas non plus avoir fait.
[33] Et ça n’est pas du tout par manque de place. Par exemple, leur table 2 pouvait très facilement contenir trois colonnes supplémentaires montrant les valeurs moyennes de chaque groupe de sexe et l’écart-type ou la taille de l’effet, voir plus (ex : écart-type dans chaque groupe de sexe) en remplaçant les valeurs de p à la septième décimale près par des astérisques assortis d’une légende. Autre exemple : au lieu de donner deux fois les mêmes informations chiffrées (valeurs de t) dans la figure 3 et la table 3, ils auraient pu donner dans l’un des deux la taille d’effet.
[34] Cf www.pnas.org/site/authors/index.xhtml accédé en janvier 2014 : « Commentaries call attention to papers of particular note and are written at the invitation of the Editorial Board ». Cahill (2014) a été publié dans la rubrique Commentaries de PNAS.
[35] Cf Cahill (2005) et Cahill (2006), dans lesquels il s’appuie d’ailleurs déjà sur les travaux du couple Gur entre autres. Une traduction française de Cahill (2005) a été publiée en juillet 2009 dans Cerveau & Psycho (le magazine dont Sébastien Bohler est l’unique rédacteur permanent depuis sa création) sous le titre « Cerveau masculin, cerveau féminin », réimprimée sous le même titre en février 2011 dans L’Essentiel Cerveau & Psycho, n° 5 (l’une des sources citées par Jean-François Bouvet dans Le camion et la poupée, 2012, Flammarion). Concernant son adhésion aux présupposés psycho-évolutionnistes concernant les différences entre hommes et femmes, voir Cahill (2006) dans lequel il écrit : « Extensive evidence from many species makes it clear that males and females have evolved different behavioural strategies to optimize their chances of successful mating. Females tend to compete with other females more subtly, in ways that may depend more heavily on the processing of finer details; for example, of social cues. Such evolutionary accounts may help to explain the heightened recall of detailed information in females found in several studies of human memory so far. Regardless of the ultimate evolutionary explanations, it seems incontrovertible that males and females evolved under some similar, and some very different pressures. We should therefore expect a priori that their brain organization will be both similar in some respects, and markedly different in others. This is precisely the situation suggested by the sex difference literature. »
[36] Reportage diffusé sur CBS le matin du 3/12/2013 visionné ici, réalisé par la journaliste spécialisée Stephanie Stahl récompensée plusieurs fois pour la qualité de ses reportages sur des sujets de santé (cf http://www.broadcastpioneers.com/bp10/stahl.html). En y voit Ruben Gur montrant les fameuses images aux lignes oranges et bleues à la journaliste de CBS, et on entend les commentaires suivants : “[Ruben Gur :] This is the female brain… [fondu enchaîné, voix off :] Neural wiring in a woman’s brain runs from side to side, as seen with the orange lines. Both sides of the brain interact. Not so much with men: that information highway, shown with the blue lines, goes from back to front. How we’re wired controls how we behave. [Ruben Gur :] That’s why men have possibly harder time talking about feelings. [Voix off :] Ruben Gur at Penn Medicin conducted the brain imaging study which documents fundamental differences in the brain wiring of men and women. [Ruben Gur :] The brain is divided into majors lobes. And in females, those lobes communicate with each other, a lot more. In males, each lobe communicates within itself. […] [Voix off :] It confirms what many have suspected: women have more emotionnal intelligence, men are more performance-oriented. [Ruben Gur :] Each hemisphere of the brain looks at the world differently. »
[37] Fabrice Hadjadj écrit ainsi, dans sa réaction au livre Le déni publiée par Le Point, que « c’est l’égalité qui est cause de rivalité : les égaux se trouvent automatiquement en concurrence mimétique (voir Tocqueville ou Girard). Seule une pensée de la complémentarité, sinon de l’incomparable, permet de sortir de la compétition. » (Fabrice Hadjadj, 9/1/2014, « Une manipulation des textes et des contresens », Le Point, p. 115).
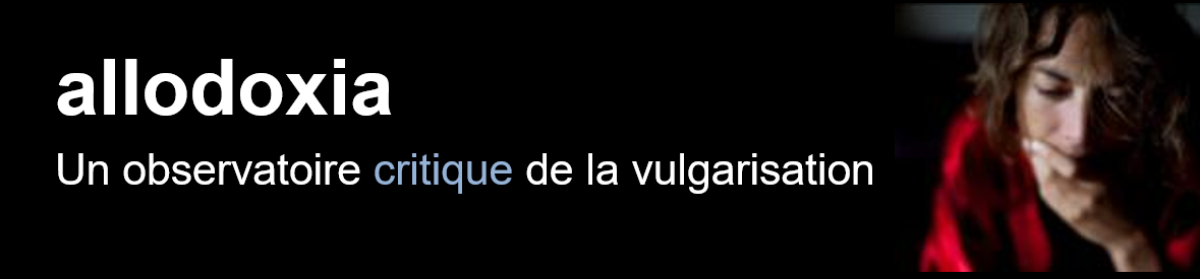
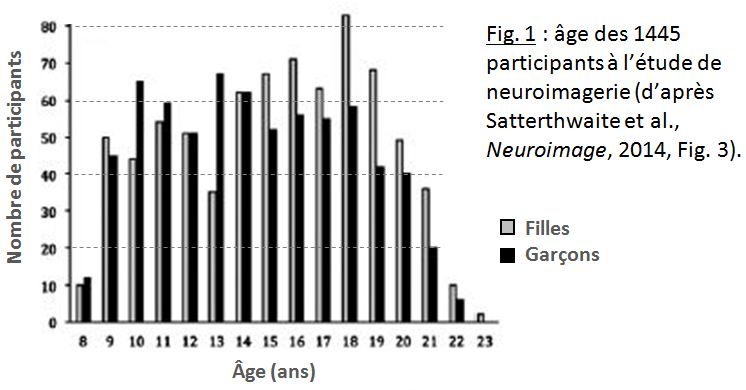
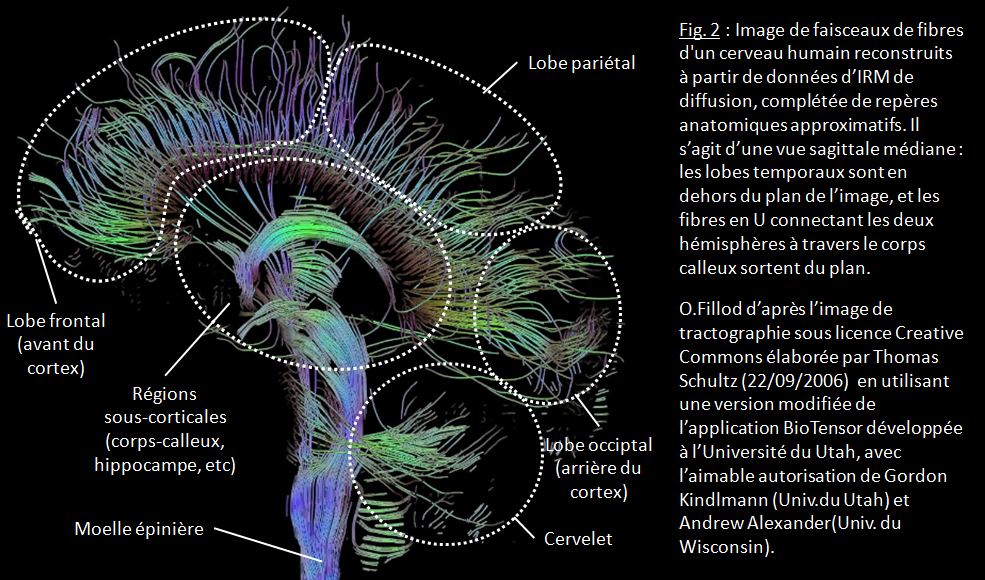
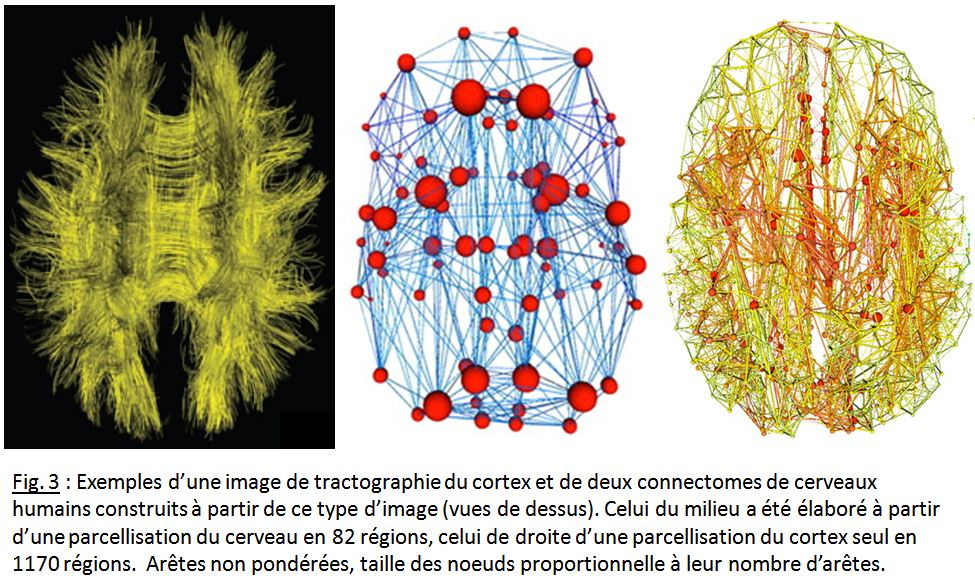
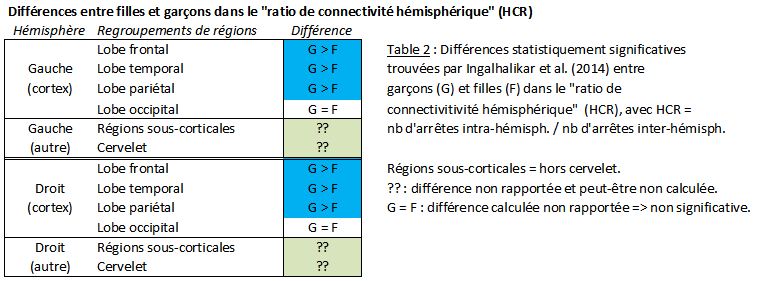
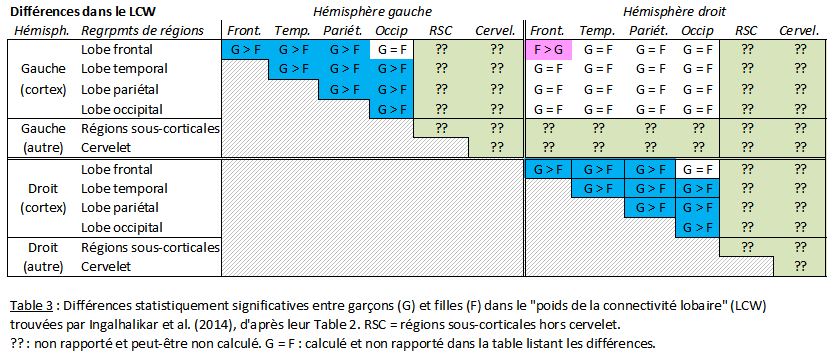
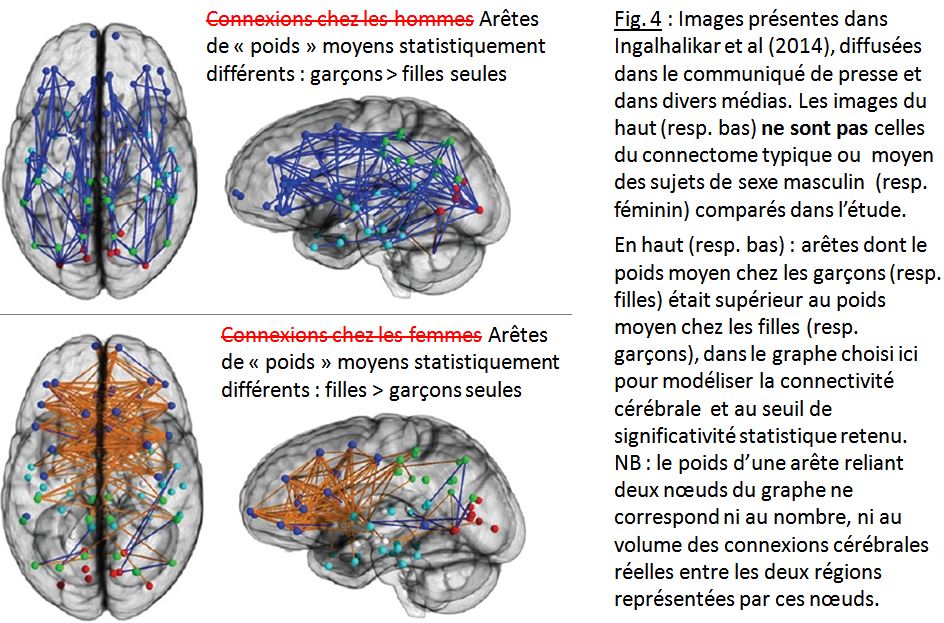
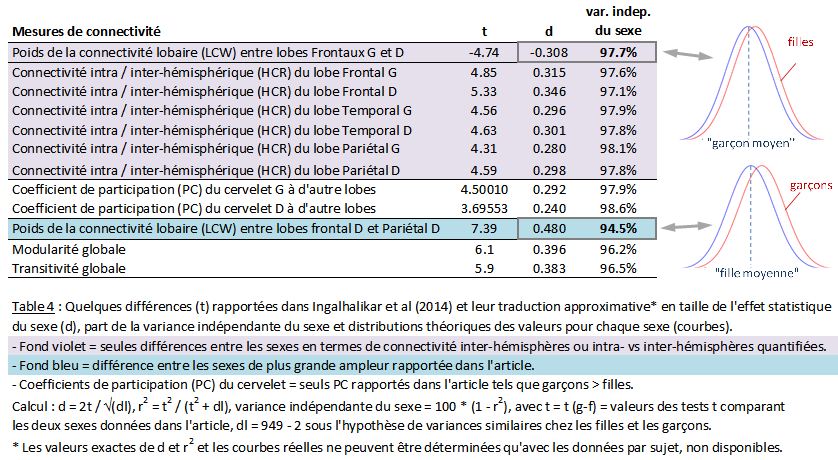
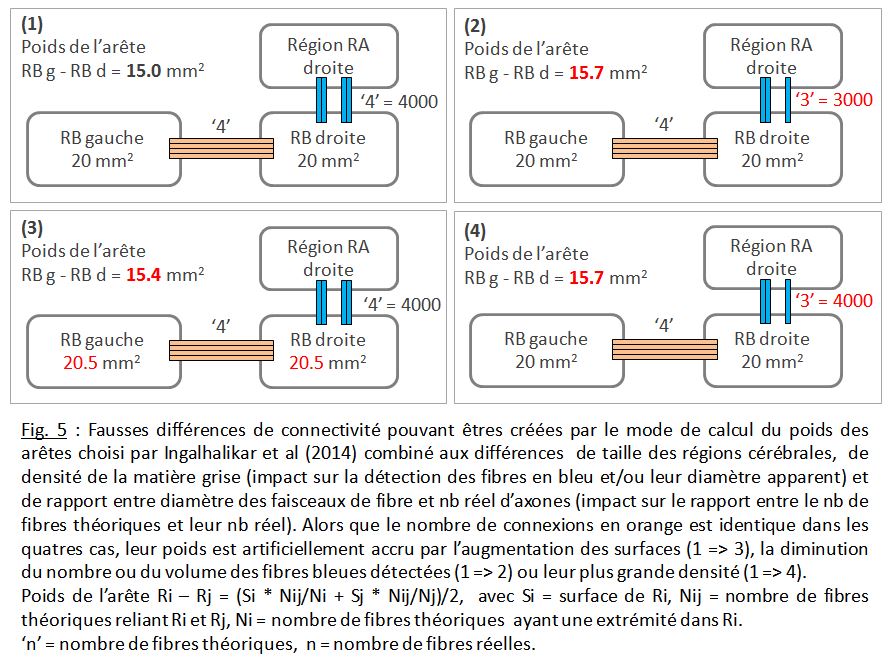
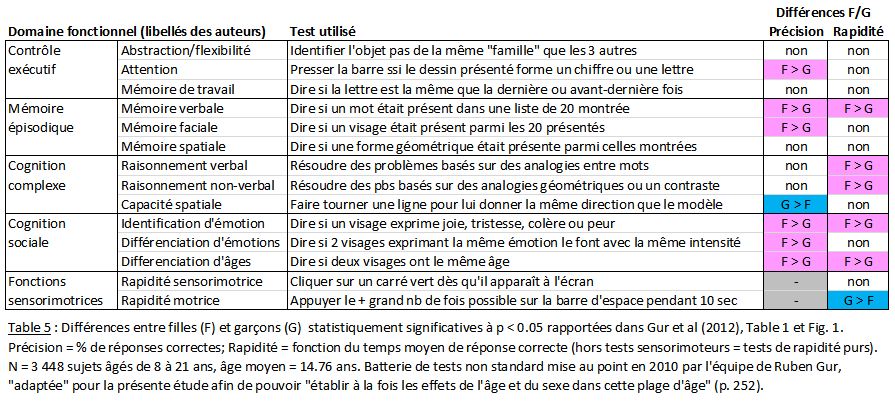
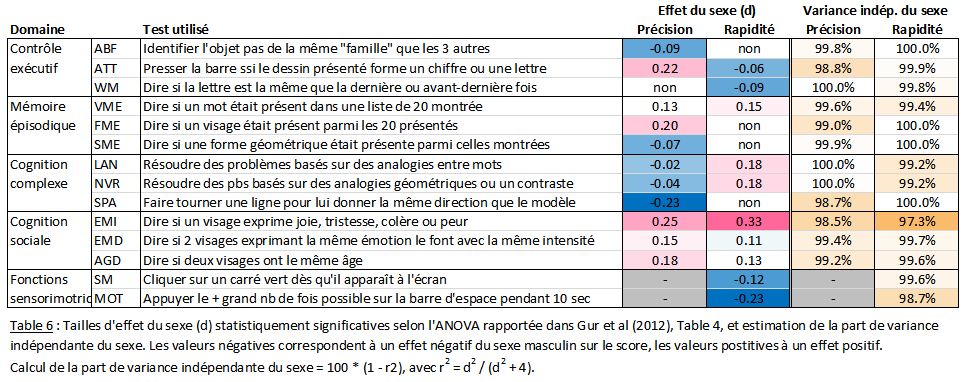
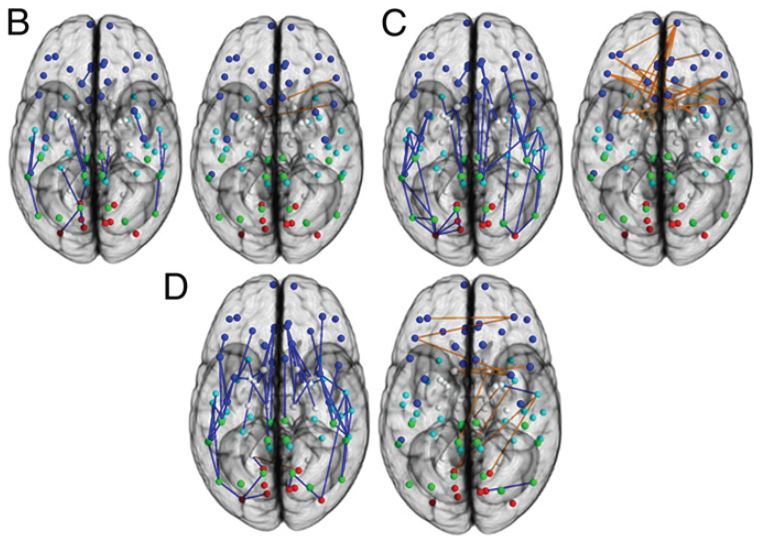
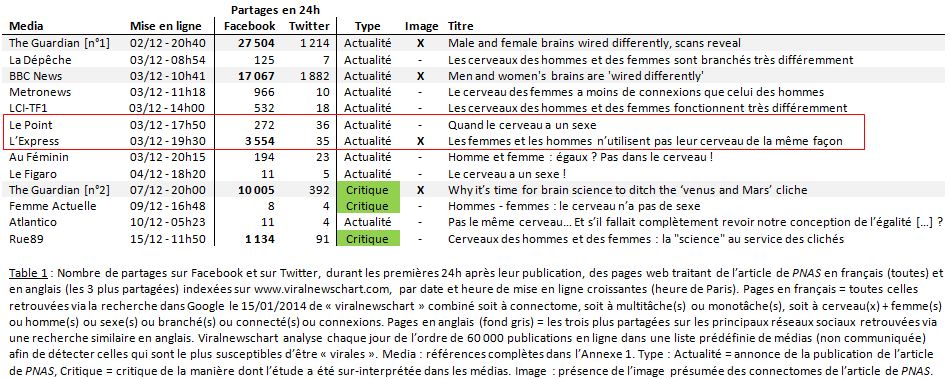
Je suis toujours admiratif du travail qui doit être nécessaire pour écrire un tel article que pour ma part je ne lirais qu’en diagonale car ne disposant pas du “câblage neuronal” suffisant !
Merci. Tout simplement. Merci de ce splendide éclairage, du temps passé et du travail effectué. Merci.
Merci pour ce formidable travail. C’est d’une importance capitale dans ce monde. Cependant on voit bien qu’il est beaucoup plus facile de répandre des fausses informations que de rétablir la vérité et c’est ce qui me fait peur….Dommage qu’on ne fasse pas des recherches sur la plasticité du cerveau pour savoir son effet sur le cerveau.
Bonjour,
Quel travail impressionnant, de relecture, ré-analyse de la biblio et des données ! Bravo !
Deux remarques :
– Vous en parlez, certes, mais ce qui m’a le plus choqué lors de la lecture de l’article dans PNAS, c’est le parti pris des auteurs, qui est totalement explicite dès les premières lignes, sur d’une part la différence homme – femme en terme cognitive et comportementale, sur une différence supposée entre les hémisphères droits et gauches (et on sait aussi que c’est un mythe : on peut lire en particulier ce document (pdf) de l’Université de médecine de Toulouse http://www.medecine.ups-tlse.fr/du_diu/fichiers/ametepe/Article%20Cerveau%20droit.pdf ), et enfin d’autre part sur un “processus évolutif” justifiant ces différences cérébrales.
Evidemment, ces pré-supposés ridicules auraient dû alerté les journalistes scientifiques qui ont relayé les infos, même sans qu’ils aient les connaissances en statistisques / épidémio / neuroscience.
– Vous parlez de la blogosphère francophone à travers la plateforme (récente) scilogs, émanant de Pour La Science. Je vous rappelle donc qu’il y en a une autre, plus ancienne : le c@fé des sciences, dont je fais partie. Et qu’à l’occasion de la sortie de ce fumeux article, j’avais écrit un petit billet sur la question (http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/le-cerveau-les-hommes-et-les-femmes-retour-au-moyen-age/) . Si les grands médias n’ont pas été à la hauteur, n’oubliez pas les “petits”, qui, avec leur petite audience et moyens, s’acharnent à communiquer sur cette “bad science” reprise sans vergogne ni vérification. A signaler aussi, puisque vous parlez (un peu) de Catherine Vidal, son interview dans les “Nouvelles News”, où elle dénonce cet article (http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-section/chroniques/3292-sexe-du-cerveau-etude-qui-embrouille-les-neurones). Si les blogs scientifiques français pouvaient accroître leur inter-connectivité, afin d’augmenter leur visibilité, nous serions tous gagnant. (et je vous signale à ce propos les discussions que nous avons sur la question ces derniers temps, au travers, par exemple de cet article de @PhJulien http://www.biopsci.com/2014/02/10/analyse-liens-blogs-sciences/)
Merci beaucoup pour cet article très documenté. Petite question: comment définissez-vous “différence significative”? J’ai du mal à comprendre votre distinction entre significative et signifiante. Je la comprends sur votre exemple, mais serais en peine de l’extrapoler à d’autres cas.
On considère qu’un résultat obtenu sur un échantillon est statistiquement significatif s’il est peu probable qu’il ait été obtenu par hasard.
– Résultat obtenu par hasard = observé dans l’échantillon, mais si on analysait toute la population dont cet échantillon a été tiré au hasard, on ne retrouverait pas ce résultat; le résultat a été observé simplement parce qu’il s’est trouvé par hasard que l’échantillon était biaisé.
– Peu probable = probabilité que le résultat soit le fait du hasard (valeur p ou p-value en anglais) inférieure à un seuil conventionnel. Ce seuil est habituellement fixé à 0.05 dans les sciences du vivant et la psychologie, c’est-à-dire moins d’une chance sur 20.
NB : la valeur p se calcule à l’aide de formules statistiques qui reposent notamment sur l’hypothèse que l’échantillon a été tiré au hasard de la population qu’il est censé représenter. En pratique dans ces sciences, il est très rare que l’échantillon étudié soit réellement tiré au hasard, et la valeur p calculée n’a donc en fait qu’une valeur indicative.
Une différence moyenne observée entre deux groupes dans un échantillon peut être statistiquement significative (au sens où le calcul de la valeur p indique qu’on avait moins d’une chance sur 20 de l’observer si elle était inexistante dans la population), tout en étant :
– très petite (voire insignifiante),
– en fait inexistante dans la population dont l’échantillon a été tiré.
Merci beaucoup!
Merci pour cette remarquable analyse qui vaudrait, sous une forme remaniée et en l’incluant dans une littérature adéquate (socio des sciences, public understanding of science…), une publication dans une revue scientifique.
L’analyse sur le positionnement de PNAS, leur usage des article-level metrics et de l’appareil de “mise en presse” est tout à fait juste. Je voudrais simplement ajouter que tout cela n’est en rien limité à cet article, c’est devenu l’ordinaire de ces “grandes revues généralistes” comme on le voit au nombre de retraits d’articles, corrections et affaires diverses les concernant.
http://ledeni.net/
nous analysons dans notre livre, Le Déni, enquête sur l’Eglise et l’égalité des sexes une source active des stéréotypes de genre. Loin d’être en déclin, l’Eglise influence encore par ses modèles la société
Merci mille fois pour cette formidable analyse. Je partage immédiatement.
Encore merci pour ce travail remarquable !
Une étude qui corroborerait l’hypothèse de l’existence de quelques différences entre cerveau masculin et féminin ?
http://www.cell.com/AJHG/retrieve/pii/S0002929714000597
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/27/22048-filles-mieux-armees-face-lautisme
Plusieurs remarques concernant l’article du Figaro:
1) la logique des chercheurs est assez étrange, non? Ils remarquent que certaines variations génétiques sont plus présentes chez les filles atteintes de troubles développementaux que chez les garçons, mais qu’elles sont moins atteintes que les garçons, et il ne leur vient pas à l’idée que, peut-être, ça indiquerait que les gènes en question ne sont pas les plus importants pour l’apparition de l’autisme?
2) Quand bien même ces gènes seraient très impliqués dans l’autisme, pourquoi ce serait le cerveau qui protègerait les filles? Ne pourrait-on pas imaginer d’autres mécanismes, du genre des mécanismes épigénétiques qui empêcheraient les gènes incriminés de s’exprimer?
1) En effet, et ce qui est dommage est que les auteurs ne donnent aucune information sur les variations génétiques en question. C’est curieux car ils auraient pu le faire au moins dans leurs données supplémentaires en ligne. Concernant les anomalies du nombre de copies de séquences d’ADN de grande taille (les CNVs > 400 kb) dans des gènes potentiellement liés aux troubles développementaux en général (ce qu’ils ont appelé “ND genes”), qui donnent leur odds ratio le plus impressionnant, observé dans la cohorte d’autistes et mentionné dans l’abstract (“In an independent autism spectrum disorder (ASD) cohort of 762 families, we found a 3-fold increase in deleterious autosomal CNVs”), ça correspond en effet d’après leur table 1 à 36 variantes trouvés chez 5% des 653 garçons (= 33 sujets) et 17 variantes trouvés chez 15% des 109 filles (= 16 sujets). Il aurait été intéressant de savoir quels étaient ces variantes et si elles avaient été mises en relation avec l’autisme. Je suppose que la réponse à cette question est négative, sinon ils l’aurait très certainement mentionné.
2) Leurs résultats peuvent en effet être expliqués par des hypothèses alternatives qu’ils n’évoquent pas dans l’article (ils évoquent uniquement celle d’un sous-diagnostic des troubles neuro-développementaux chez les filles du fait des stéréotypes de genre).
Rem : leurs analyses portent sur des sujet d’ “ascendance européenne” exclusivement…
Précisions :
– Les sujets étaient d’ “ascendance européenne” sauf 14 sur 762 pour l’analyse des CNVs, et les 14 en question ont été exclus pour l’analyse des SNVs (les auteurs ne disent pas pourquoi). Pour la tentative de réplication dans deux cohortes de population générale du déséquilibre femmes > hommes dans le “fardeau” génétique en termes de CNVs, seuls les sujets d’ “ascendance européenne” ont été retenus (rem : le déséquilibre a été retrouvé dans la petite cohorte de 2515 sujets, mais pas dans celle de 8733 sujets, où le déséquilibre était à la limite de la significativité statistique et dans le sens contraire, i.e. hommes > femmes).
– On ne sait pas ce qu’il en est pour la cohorte de sujets souffrant d’un « trouble neurodeveloppemental » non spécifié fournie par la société Signature Genomics Laboratories. Tout ce qu’on sait est qu’ils venaient du Canada et des Etats-Unis.
– Par ailleurs, bien qu’il soit indiqué dans l’abstract que cette cohorte de Signature Genomics était constituée de sujets chez lesquels un trouble neurodéveloppemental a été constaté (“probands ascertained for NDs”), la description détaillée de cette cohorte précise qu’il s’agissait de sujets ayant été génotypés pour cause de handicap mental pour “la grande majorité” des 15585, d’autisme pour 1379, d’épilepsie pour 1776, de malformations congénitales diverses pour un nombre indéfini d’entre eux (dont 575 pour cause de malformation cardiaque), et d’un problème non spécifié pour 12 % d’entre eux. Cette même cohorte est décrite de manière plus précise dans http://www.nature.com/ng/journal/v43/n9/abs/ng.909.html; on y voit que 73 % des sujets souffraient d’un handicap mental, d’un retard de développement ou d’un trouble du spectre autistique, 12 % des sujets avaient été génotypés sans qu’on sache pourquoi, les 15 % restant souffrant d’ “anomalies congénitales diverses”; dans cet article là, les auteurs soulignent que cette cohorte inclut des sujets souffrant de malformations craniofaciales (3898), de MCA i.e. “anomalies congénitales muliples” (2247), d’épilepsie (1776), de FTT i.e. retard staturopondéral ou retard de croissance (883), de problèmes cardiovasculaires (575) ou reinaux (93), ou encore de surdité (121). Les données supplémentaires en ligne permettent de constater que par exemple, 1453 sujets inclus souffrant de MCA, 1097 souffrant de malformations craniofaciales et 395 souffrant de retard de croissance ne souffraient ni d’un trouble “neurologique”, ni d’épilepsie, ni d’un trouble autistique, ni d’un trouble de l’attention, seules catégories de troubles “neurodeveloppementaux” répertoriées par Signature Genomics. La description de cette cohorte dans l’abstract du présent article est donc clairement trompeuse.
– Pour aucune des cohortes de l’étude on ne dispose de la moindre information concernant l’âge des sujets et celui de leur parents (important car les CNVs et mutations de novo augmentent avec l’âge, un biais de sexe pouvant donc être artificiellement créé en absence de contrôle de l’âge).
– Il est précisé dans l’article que : Evan E. Eichler, dernier auteur et co-auteur correspondant de l’article, est membre du conseil scientifique de la société SynapDx Corp. et l’était des sociétés Pacific Biosciences Inc. et DNAnexus Inc. de 2009 à 2013 et de 2011 à 2013 respectivement; Jill A. Rosenfeld est une employée de Signature Genomic Laboratories (filiale de PerkinElmer Inc.); Sébastien Jacquemont, premier auteur et co-auteur correspondant de l’article, a fourni des prestations de service à Novartis Pharma et a reçu des financements pour le test clinique du Mavoglurant, un médicament développé par Novartis pour traiter le syndrome de l’X fragile.
Deslan, tout d’abord je voudrais vous faire remarquer que ce que vous signalez n’a rien à voir avec l’article sur les connectomes. Si vous continuez à poster des commentaires sous mes articles à chaque fois que la presse annonce qu’on a trouvé une différence entre les sexes quelle qu’elle soit, on n’est pas rendu. Si en plus vous ne me lisez ensuite “qu’en diagonale car ne disposant pas du « câblage neuronal » suffisant ” (je vous cite), je ne vois pas bien ce que ça vous apporte. Cela étant dit, voici ma réponse.
Vous évoquez l’hypothèse de l’existence de quelques différences entre cerveau masculin et féminin, or ça n’est à mon avis pas une hypothèse mais une certitude : lisez par exemple ce que j’avais écrit dans http://repap.fr/docs/6/article2.pdf début 2011. La question ne se pose pas en ces termes.
Il existe des différences “naturelles” moyennes entre les cerveaux des femmes et ceux des hommes. Exemple : le volume total du cerveau, en lien avec la différence moyenne de stature entre hommes et femmes, celle-ci étant en partie “naturelle” au sens où toutes choses égales par ailleurs (alimentation, activité physique, sommeil durant l’enfance…), un garçon et une fille n’auront pas à la naissance les mêmes chances d’atteindre certaines statures pour des raisons biologiques.
=>La question est de savoir si ces différences “naturelles” ont des conséquences en termes psychiques au sens large (capacités cognitives, tendances comportementales, etc). Ce qu’on peut dire à ce jour est qu’aucune conséquence de ce type n’a été trouvée, et que ça n’est pas faute d’avoir cherché.
Il existe d’autres différences moyennes trouvée ici ou là sur certains échantillons via des études de neuroimagerie, et d’autres sans doute qu’on n’a pas encore trouvées parce qu’on ne dispose pas d’outils assez sophistiqués pour les mettre en évidence : puisque le cerveau est modifié par le vécu et puisque les vécus des filles/femmes et des garçons/hommes sont en moyenne différents, ça doit bien en effet se traduire d’une manière ou d’une autre en différences cérébrales. Une autre façon de le dire est que puisqu’on constate sur des populations données l’existence de différences moyennes dans certains traits psychologiques, sous l’hypothèse que le système nerveux est le substrat biologique de ces traits ça doit bien se traduire d’une manière ou d’une autre au niveau de celui-ci dans ces populations.
=>La question est de savoir si ces différences sont entièrement “acquises” ou s’il y a une part de “naturel”. Ce qu’on peut dire à ce jour est que : 1) les différences trouvées ici ou là – qui le plus souvent restent non répliquées ou disparaissent lorsqu’on fait une métanalyse des études les concernant – ne constituent jamais des dichotomies (i.e. les cerveaux féminins “sont comme-ci”, les cerveaux masculin “sont comme ça”), mais des petites différences en moyenne, avec un énorme recouvrement des distributions des deux sexes (i.e. plein de garçons plus “féminins” que la fille moyenne et plein de filles plus “masculines” que le garçon moyen sur le critère analysé, typiquement comme ce qu’on voit dans l’étude sur les connectomes dont je parle ici; 2) les données disponibles démontrent l’existence d’effets de “l’acquis” qu’aucun neurobiologiste ne conteste; 3) en revanche aucun effet d’un facteur biologique lié au sexe sur la variabilité commune dans le domaine du psychisme n’a pu être mis au jour, et là encore ça n’est pas faute d’avoir cherché. Ex : l’hypothèse selon laquelle la testostérone agit dans le cerveau en rendant les hommes en moyenne plus agressifs ou plus libidineux que les femmes n’est pas validée par la littérature scientifique; celle selon laquelle l’ocytocine agit dans le cerveau en rendant les femmes en moyenne plus aimantes et soucieuses de leurs enfants que les hommes non plus; celle selon laquelle les variations des niveaux d’oestrogène au cous du cycle menstruel ou à la ménopause agissent sur des centres cérébraux en causant des variations de l’humeur chez les femmes non plus; celle selon laquelle la plupart des hommes préfèrent des femmes pour partenaires sexuelles et réciproquement en raison d’une conformation prénatale de leur cerveau par les hormones ou d’effets de gènes portés par le chromosome X non plus; etc, etc.
En ce qui concerne les conséquences de rares anomalies génétiques du chromosome X sur le développement/fonctionnement du cerveau, il est bien établi qu’elles peuvent avoir des conséquences différentes selon qu’on a un caryotype XX ou XY : je parlais par exemple dans http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2012/05/30/debat-inne-acquis/ du syndrome de l’X fragile qui a des conséquences en moyenne plus graves chez les garçons, et on peut deviner pourquoi.
=>La question est de savoir si en dehors des mutations délétères de ce type, la variabilité commune au niveau de ces loci génétiques a aussi des effets sur le développement/fonctionnement du cerveau ET si ces effets varient selon le sexe. A ma connaissance à ce jour rien de ce type n’a pu être établi, et là encore ça n’est pas faute d’avoir cherché.
La nouvelle étude que vous nous signalez ne porte pas sur des “différences entre cerveau masculin et féminin”. Il s’agit d’une étude qui rapporte des corrélations entre présence de certains types de variantes génétiques et sexe dans deux cohortes, l’une de 15585 sujets diagnostiqués comme étant atteints d’un “trouble neurodeveloppemental” (non spécifié), l’autre de 762 sujets diagnostiqués comme souffrant de “symptômes autistiques modérés à sévères” et de QI moyen égal à 80. En résumé, les chercheurs ont trouvé dans ces deux cohortes qu’à niveaux de fonctionnement intellectuel et social égaux, les filles étaient en moyenne porteuses de davantage de certaines mutations a priori délétères que les garçons.
Cette étude ne permet absolument pas d’affirmer : “Les filles mieux armées face à l’autisme” (titre de l’article du Figaro). Comme il est indiqué dans le texte de l’article du Figaro : « Cela suggère qu’à nombre d’atteintes génétiques égal, les filles s’en sortiraient mieux que les garçons, résume Sébastien Jacquemont. Leur cerveau serait en quelque sorte mieux armé pour faire face et “compenser” certaines mutations.». Cela “suggère”, en effet, et il reste un long chemin à parcourir pour confirmer cette hypothèse, bien que comme l’indique Catalina Betancur ces résultats “corroborent des hypothèses qui existent depuis déjà un certain temps”.
Le commentaire du Figaro selon lequel ces observations sont “cohérentes avec la théorie du spécialiste de l’autisme Simon Baron-Cohen, selon laquelle les filles étant naturellement plus aptes à la communication et à la sociabilité, une altération de leurs fonctions cognitives aurait moins de conséquences sur leur comportement que chez les garçons.”, renvoyant ici à http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001081, n’est qu’une interprétation tendancieuse qui ne correspond pas à celle que proposent les auteurs dans l’article : ils font référence à la théorie de Baron-Cohen, mais pas du tout dans ces termes. Il est certain que des facteurs biologiques liés au sexe ont un rôle dans le déséquilibre garçons/filles dans les troubles autistiques : c’est le cas d’anomalies du chromosome X telles que celle que j’ai mentionnée plus haut, mais elles n’expliquent qu’une partie de ce déséquilibre. Pour expliquer le reste, aucun facteur biologique n’est à ce jour avérée. En particulier, l’hypothèse de Baron-Cohen selon laquelle il y aurait une “masculinisation” prénatale du cerveau par la testostérone qui ferait que le cerveau masculin serait en quelque sorte en moyenne davantage porté vers des tendances autistiques que le cerveau féminin reste une pure conjecture malgré l’énergie qu’il met depuis des années à l’étayer (il est vrai qu’il est bien seul à tenter de le faire au sein de la communauté des chercheurs qui travaillent sur l’autisme…).
Bonsoir,
Je réagis à ce commentaire en le déterrant allègrement, car vous indiquez le lien d’un document qui n’est, malheureusement, plus disponible : http://repap.fr/docs/6/article2.pdf . J’ai beau chercher avec les moyens qui sont les miens (Internet WayBack Machine : https://web.archive.org/web/20180422141014/http://www.repap.fr/docs/6/article2.pdf), c’est chou blanc ‘^’
Auriez-vous par hasard une archive de ce document ?
Je profite de ce commentaire pour vous indiquer combien sont précieux vos articles ! C’est un travail admirable.
Un Quidam
En effet, le site de la revue REPAP (qui n’existe plus) a complètement disparu depuis plusieurs années… J’avais téléchargé fin 2011 le pdf qui y était en ligne et l’ai stocké sur mon site : https://allodoxia.odilefillod.fr/files/2016/12/2011_REPAP_OFillod_Version-en-ligne-sur-repap.fr_.pdf
Bonjour, et bravo pour votre travail stupéfiant. Je suis époustouflé par le volume de votre travail et par sa précision, bien que je n’aie lu qu’une petite partie de l’ensemble de vos articles.
Savez-vous si depuis 2010 et le moment où vos avez écrit l’article que vous mentionnez sur repap, d’autres résultats étaient apparus à votre connaissance susceptibles de modifier certaines affirmations dans celui-ci ? Je pense par exemple à l’affirmation qu’ “aucune des théories conférant à telle ou telle variable biologique liée au sexe chromosomique ou gonadique le statut de cause de variabilité en termes psychique […] n’a à ce jour dépassé le stade d’hypothèse”, notamment en ce qui concerne les hormones sexuelles
Il ne faut surtout pas enlever de la citation ce que vous avez remplacé par “[…]”, à savoir “(hors anomalies génétiques connues à l’origine de troubles
neurodéveloppementaux)” et rappeler le contexte de cette phrase : je parle dans ce article des théories concernant les différences psychologiques entre femmes et hommes. A cette condition, à ma connaissance cette affirmation reste valide.
PS : on voit encore le lien sur https://web.archive.org/web/20131126235504/http://repap.fr/telechargez.php mais le téléchargement ne marche plus.
Si cela peut vous aider, il vous suffit de baisser les yeux et de regarder entre vos jambes pour savoir de quelle sexe vous êtes, à quelques exceptions près vous aurez la bonne réponse. Quant au genre c’est pas compliqué chacun choisi ce qu’il veut devenir, si ça le chante.
Quant au genre, à mon avis c’est beaucoup plus compliqué que ça…
Moi ce qui m’avait fait tiquer à l’époque, c’est la référence à des “tests d’intelligence sociale” que les filles réussiraient mieux que les garçons.
En rapportant cela le journaliste laisse imaginer qu’il existe un moyen fin de mesurer cette “intelligence sociale” – et je pense que ce journaliste ne cherche pas à tromper le lecteur, il imagine lui-même vraiment qu’il existe des protocoles scientifiques subtils et raffinés permettant d’identifier des nuances dans nos aptitudes à interagir avec le collectif.
C’est gag car au mieux, les tests de ce type ne permettent que de détecter les anomalies pathologiques les plus brutales, les méconnaissances les plus grossières des règles sociales!
Mais bon, ça colle tellement bien au préjugé comme quoi les femmes seraient naturellement plus sociables, bavardes, diplomates, psychologues, manipulatrices etc… théorie que je m’explique pas tant elle résiste mal à un examen de la réalité quotidienne, mais ceci est un avis personnel non fondé scientifiquement.
Le deuxième truc qui m’avait fait tiquer, ce sont les références à une organisation spatiale droite/gauche et avant/arrière du cerveau, qui permettrait de distinguer action et réflexion. Je ne comprend pas que certains en soit encore là, ce sont des raisonnements du 19e siècle, depuis une masse de travaux ont montré que le fonctionnement du cerveau humain est d’une plasticité et d’une subtilité sans rapports avec une organisation aussi grossière.
Bonjour et félicitation pour l’article (58 pages word, c’est presque un mémoire !). J’ai une question épistémologique.
Vous écrivez “La question est de savoir si ces différences « naturelles » ont des conséquences en termes psychiques au sens large (capacités cognitives, tendances comportementales, etc). Ce qu’on peut dire à ce jour est qu’aucune conséquence de ce type n’a été trouvée, et que ça n’est pas faute d’avoir cherché.”
Dans la mesure où l’être humain est un être social que l’on ne peut pas isoler du facteur “société” pour analyse, dans la mesure où tout ce que l’on peut trouver chez les animaux se heurte au fait que ce ne sont pas des êtres humains, à supposer (je vous assure que je n’ai de préférence pour aucune explication d’un point de vue politique), à supposer donc que des différences naturelles déterminantes existent entre les hommes et les femmes (c’est-à-dire avec une influence sur le comportement, observable en moyenne, compensables ou non par l’éducation), ne serait-il pas de toute façon impossible de les mettre à jour sans que l’on oppose à ces études (légitimement, même si les idées politiques de l’analyste peuvent motiver ses préférences) que le facteur “société” les rend non concluantes ? Bref, qu’elles sont scientifiquement improuvables parce que l’on ne peut pas démontrer qu’elles ne sont pas dues à une construction sociale.
Merci.
Merci pour cette excellente question.
Un premier élément de réflexion me semble important bien qu’il n’y réponde pas exactement, qui est la notion de quantification des effets éventuels des différences naturelles : dans l’hypothèse où on n’arriverait pas à une conclusion définitive quant à l’existence de tels effets, je pense qu’on pourra du moins cerner leur ampleur maximale (et au vu des données disponibles, celle-ci est à mon avis négligeable comparativement à celle des effets de l’ “environnement” au sens large).
Indépendamment de ça, j’ai confiance dans la capacité de la recherche à trancher cette question à plus ou moins longue échéance.
D’abord, je serais pour ma part prête à accepter la conclusion que tel ou tel effet existe si j’étais face sinon à une preuve formelle de son existence mais du moins à un faisceau robuste d’indices convergents (à ce jour ça n’existe pas : il y a de gros “trous” dans les modèles envisagés concernant tel ou tel facteur biologique, et surtout aucun modèle susceptible de rendre compte des nombreuses données contradictoires déjà disponibles).
Ensuite, si d’aventure il existe une chaîne de causalité biologique entre des différences naturelles ente les sexes et des variations psychologiques/comportementales, je pense que les progrès techniques finiront par permettre de la mettre en évidence de manière incontestable.
Belle analyse, pour la partie que j’ai pu comprendre…
C’est d’ailleurs sur ce dernier point que je voudrais rebondir. Je suis un bête biologiste comme il en existe des milliers dans ce pays. J’ai une formation universitaire (un doctorat) mais aucune spécialisation en neurosciences ce qui fait que j’ai fortement buté pour comprendre les notions concernant le connectome, les nœuds et les arêtes. J’ai d’ailleurs mis un temps assez long pour lire votre analyse.
Alors, je suis toujours émerveillé de voir que des gens, qui font tous les jours preuve de leur incapacité à comprendre des notions simples de biologie, sont capables de pondre une analyse de l’article de PNAS dans les jours qui suivent sa sortie.
Je pense notamment à une blogueuse avec laquelle je me suis entretenue il y a quelques années. Celle-ci mélangeait les notions de phénotype et de génotype pour faire passer ses théories fumeuses. Quand je lui ai fait remarqué elle m’avait répondu que “tout cela c’est la même chose”. Donc on peut avoir un niveau en biologie qui vaut à n’importe quel lycéen un 0 en biologie et comprendre des publications pointues en neurologie. Comprend qui peut…..
Par ailleurs, je sais que vous passez déjà beaucoup de temps sur ce blog, mais pourriez vous accompagner vos publications d’une versions PDF ou ePub pour permettre une lecture aisée sur liseuse ou papier. Merci d’avance
Merci.
Je crois deviner à quelle bloggeuse vous pensez…
De manière générale, ce qui vous émerveille ne laisse pas de m’étonner également. En l’occurrence, même des gens ayant une formation pointue en neurosciences et des chercheurs en neurobiologie ne connaissent rien aux connectomes, et en ce qui me concerne j’ai passé plusieurs semaines à lire des articles produits dans ce champ de recherches que je ne connaissais pas avant de me sentir autorisée à en parler. Je regrette d’apprendre que vous avez buté sur cette partie “technique” de mon article que je pensais claire. Peut-être qu’une mise en forme permettant une lecture plus aisée est une partie de la solution… Je vais y réfléchir… ou bien revenir à des articles plus courts. A voir.
S’il y a un domaine où on ne se lasse pas de nous rappeler ces fameuses différences, c’est chez les joueurs d’échecs. Pas une discussion, pas un article sans que cela soit mentionné, y compris de la part de la Fédération Française des Echecs. Tout récemment, par exemple : http://www.echecs.asso.fr/NewsLetter/NewsLetter8.pdf
Extrait : Nathalie Franc, joueuse d’échecs de haut niveau et médecin psychiatre, confirme cette explication. «Des études ont prouvé que l’intelligence de la femme n’est pas la même que celle de l’homme. Différente, mais en aucun cas inférieure, bien évidemment. L’intelligence des femmes a notamment un côté plus artistique et créatif alors que celle des hommes serait plus rigoureuse et logique. Il y a aussi sans doute la soif de vaincre et l’esprit du jeu qu’on retrouve davantage chez les hommes. À relier tout naturellement au taux de testostérone.»
Merci pour la communication de ce très intéressant exemple de sexisme avec justification par des arguments biologiques. J’allais commenter en soulignant qu’il montrait une fois de plus, s’il en était besoin, que les discours les plus sexistes étayés par un mélange d’aprioris et d’ignorance et légitimés par l’étiquette “médecin psychiatre” pouvaient aussi être tenus par des femmes, mais après avoir lu la source je me pose une question : Nathalie Franc a-t-elle réellement dit ça, où est-ce une interprétation / reformulation de ses propos par l’auteur de l’article, Vincent Moret ?
Car je constate qu’il a largement distordu le propos de Jacques Bernard dans le livre qu’il cite (Socio-anthropologie des joueurs d’échecs, L’Harmattan, 2005). Moret affirme en effet que Bernard “met en avant l’argument physiologique ‘le mode de pensée serait différent chez l’homme, et cette différence avantagerait l’homme.'”, et que pour Bernard, “il semble toutefois que les arguments de nature psychique ou mentale n’expliquent pas tout”. Or si on lit le livre de Bernard, on s’aperçoit premièrement qu’il ne met pas “en avant” cette explication mais la mentionne en tant qu’une des “explications couramment avancées”, sur laquelle il pose un regard critique (“Ces idées sont discutables”, p. 119). On voit ensuite qu’il critique l’explication qu’il appelle “psychologique” selon laquelle les hommes seraient “prêts à tout pour gagner” à la différence des femmes, citant les écrits de Reuben Fine en 1973 et concluant : “Aujourd’hui, ce type de discours apparaît dénué de sens, mais témoigne toutefois d’un fait avéré : la faiblesse – relative – des femmes aux échecs. Toutefois, il semble que l’explication de ce phénomène soit plutôt d’ordre social, et que les arguments de nature psychique ou mentale, pour intéressants qu’ils soient, manquent de rigueur scientifique” (p. 121).
Bref Moret est manifestement convaincu qu’il y a dans cet état de fait “un peu de nature” et “un peu de culture” et n’hésite pas à reformuler les propos de l’auteur qu’il cite pour étayer sa position. A-t-il fait de même avec ceux de Nathalie Franc ? Si vous avez la possibilité d’en savoir plus, ça m’intéresse…
Deux PS :
1) Voici une des explications d’ordre social avancées par Bernard qui me paraît plus pertinente que les deux que Moret a choisi de citer : “Et il semble que la société des joueurs d’échecs, traditionnellement masculine, possède une solide tradition de dénigrement à l’égard des joueuses, qui mène à un véritable cercle vicieux […]” (p. 121-122)
2) En fait, le seul argument biologique que Bernard met en avant dans son bouquin est celui-ci : “Pour conclure, il faudra revenir sur un postulat […] : il s’agit du caractère purement intellectuel du combat aux échecs, qui ne nécessite aucun effort physique, ce qui excluait [sic] toute explication biologique à cette question. En réalité, il semble bien que les échecs soient avant tout un sport et que la lutte sur l’échiquier, loin d’être uniquement intellectuelle, soit aussi physique. […] En tout cas, la pratique a prouvé qu’une bonne condition physique était un préalable indispensable pour espérer réussir dans les compétitions d’échecs et sans doute les hommes supportent-ils mieux, d’un point de vue strictement biologique, ces efforts intellectuels.” (p. 122-123)
Il fallait oser ! On comprend que l’auteur de l’article ait choisi de ne pas retenir cet argument-là…
Hop, encore un article où on nous explique que les hommes sont plus forts aux échecs à cause de notre passé de chasseurs-cueilleurs. Mais attention, les femmes sont sans doute meilleures dans d’autres domaines… (l’égalité dans la différence, j’imagine)
http://en.chessbase.com/post/explaining-male-predominance-in-chess
Évidemment l’auteur ne parle pas une seconde du fait que les joueuses sont massivement poussées à jouer dans des championnats distincts des championnats mixtes, se retrouvant ainsi entre elles dans des compétitions moins fortes, avec moins de participantes et donc avec des objectifs plus faibles.
Bonjour à tous !
Je suis doctorante et justement je fais une étude sur les stéréotypes masculins et notamment ce qu’on attend d’un homme et d’une femme dans notre société.
Je profite de cet article pour vous demander votre participation,
Si vous voulez bien m’aider, et si vous avez quelques minutes (10 pour être précise) pour répondre à mes questionnaires (l’un ou l’autre!) :
Questionnaire A PROPOS des femmes (mais qui est pour les femmes et les hommes) : https://toulousepsychology.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_38jcKi0ddVaI2lT
Questionnaire A PROPOS des Hommes (mais qui est pour les femmes et les hommes) : https://toulousepsychology.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dakMifdW6Bk8O6p
Le questionnaire va vous poser 9 fois la même question environ, ne vous découragez pas ! (je dis ça car plusieurs personnes quittent le questionnaire alors qu’ils sont presque à la fin)
Merci à ceux qui prendront le temps, et si vous avez des remarques, je serai ravie d’en discuter !
Dans un contexte de forte différenciation d’éducation et donc de facto de de différence de développement neurologique, je veux bien croire que des études neurologiques montreraient des différences entre hommes et femmes statistiquement, mais ça revient à dire que des gens qui font plus de musculation ont statistiquement plus de muscles que les gens ne faisant pas de musculation…C’est l’histoire de l’oeuf ou de la poule…
M’enfin entendre de vieux bedonnants en justifier leur main-mise sur la société au nom de “l’homme d’action viril et musclé” tout en critiquant les “djeunes barbares” des cités, c’est comment dire complètement incohérent….
Toute cette rhétorique pour empêcher les femmes et les hommes d’être libre de ne pas se conformer à leurs rôles sociaux deviendrait intolérable sur d’autres sujets – on ne veut pas interdire le conservatoire à des enfants de non-musiciens, même si il est probable qu’on pourrait montrer de meilleures dispositions chez les enfants de musiciens (oh surprise!!) en action et même au niveau neurologique.
Bonjour,
Juste trois petites remarques :
– Les différences de tailles d’échantillon n’invalident pas les conclusions. Elles peuvent les rendre plus sûres et plus précises.
– La meilleure définition des groupes d’âge par rapport à l’âge effectif de puberté aurait renforcé les conclusions des auteurs.
– Vous avez butté sur l’hypothèse “taille comme signe de complémentarité entre hommes et femmes”. Pourquoi vous n’envisagez pas cette hypothèse ? Bien entendu, il y a un aspect quantitatif à la taille. Mais celle-ci implique également des questions qualitatives. Preuve en est la diversité et l’importance de ces différences de tailles par sexe selon les espèces animales. Parallèlement, les différences quantitatives de connections pourraient indiquer des différences qualitatives de fonctionnement des cerveaux.
Bien à vous.
M.L
Voici mes réponses à vos trois remarques dont je crois comprendre que les deux premières font référence au § “Un effet des hormones « mâles » et/ou « femelles » faisant diverger les trajectoires développementales ?”.
1) De manière générale, bien-sûr que lorsqu’on compare deux groupes les différences de tailles d’échantillon n’invalident pas les conclusions, et qu’elles permettent dans certains cas de les renforcer (typiquement dans les études avec un petit échantillon de cas qu’on compare à un gros échantillons de témoins, ce qui permet d’augmenter la puissance statistique). En revanche lorsqu’on a envie de comparer les différences significatives entre les sexes dans un groupe d’âge à celle dans un autre groupe d’âge comme les auteurs l’ont fait ici, ce qui est déjà en soi limite en termes de méthodologie d’analyse, on a intérêt à ce que les deux groupes d’âge soient de la même taille sinon ça peut devenir vraiment du n’importe quoi. Où vouliez-vous en venir avec cette remarque sibylline ?
2) Votre affirmation péremptoire n’est étayée par rien puisque nul ne sait ce qu’une meilleure définition des groupes d’âge par rapport à l’âge effectif de puberté aurait donné comme résultats, sans compter que ceux-ci resteraient interprétables de différentes manières et donc pas nécessairement dans le sens des conclusions des auteurs. Au sujet de celles-ci, je note en tout cas avec plaisir que Laurent Cohen a déclaré le 5 mai dernier dans Le Monde ceci : “Ils concluent que les cerveaux masculins sont organisés pour mieux coordonner la perception et l’action, tandis que les cerveaux féminins associent raisonnement, logique et intuition. Autant de lieux communs éculés ! Cela rejoint une autre réaction entendue à la radio, sur le mode : de grands savants américains prouvent que les femmes sont intuitives et les hommes prédisposés à la lutte gréco-romaine… Ou comment renforcer les stéréotypes de genre…” et ajouté ceci : “Lorsque l’imagerie cérébrale repère une différence entre le cerveau des femmes et des hommes, celle-ci est-elle la cause d’une différence de compétences innées ou la conséquence de l’éducation ? L’éducation et l’expérience impriment en permanence leur empreinte dans notre cerveau. Prenons l’exemple de la lecture. Lorsque vous apprenez à lire, vous utilisez les voies de connexion les plus adaptées à cet apprentissage. Mais dans le même temps, cet apprentissage modifie de façon subtile l’anatomie et les connexions de votre cerveau. Démêler la cause de la conséquence reste difficile.”
3) Vous êtes libre de penser que la différence moyenne de stature (et donc de taille du crâne) est un “signe de complémentarité entre hommes et femmes”, et qu’une telle différence “implique [nécessairement] également des questions qualitatives”, mais ça n’est pas de la science : ce sont des conjectures. Je ne “bute” par sur ce type d’hypothèse ni n’omets de les envisager : je critique de manière précise et factuelle les arguments avancés à l’appui de telles hypothèses qui s’avèrent ne pas être étayées. Oui, bien-sûr, la différence moyenne de stature pourrait se traduire mécaniquement par une différence quantitative moyenne en termes de connexions, celle-ci se traduisant en une différence qualitative moyenne en termes de fonctionnement des cerveaux, mais rien de tel n’est pour l’instant scientifiquement étayé.
1) Pour essayer d’être plus clair : vous avez expliqué dans votre article que les différences de taille d’échantillon entre groupes remettrait en cause la méthodologie de l’expérience. Je ne suis pas du tout d’accord. Cela élargit ou restreint le pourcentage d’obtenir une probabilité exacte. C’est tout. Pour moi, vous n’avez pas été assez factuelle sur ce point et vous avez introduit une sorte de jugement de valeur sur la méthodologie, jugement de valeur qui n’y avait pas sa place.
2) De même, je m’oppose à l’idée qu’une meilleure prise en compte des âges pubères n’aurait pas renforcé les résultats de l’expérience. Une mauvaise prise en compte de cet âge fait sortir des résultats, des personnes qui devraient s’y trouver. En rétablissant dans le bon échantillon les personnes qu’on a sorti de manière arbitraire, on affinerait la précision des différences entre filles et garçons, précision qui a été rendue plus lâche par le critère restrictif de l’âge. En somme, si on trouve déjà des différences avec l’âge, on en trouvera d’autant plus si on prend en compte, en sus, les différences de développement biologique, ces dernières étant encore plus précises et significatives que l’âge.
3) Ici, je n’ai pas porté de jugement de valeur sur l’argument qualitatif en tant que tel. Je faisais juste remarquer que vous aviez écarté cette possibilité dans votre raisonnement et que cela n’avait pas lieu d’être. Je rajouterais maintenant que la façon d’écarter cette possibilité semblait emprise d’une charge émotive déplacée dans votre texte.
Vous savez, même les meilleurs commettent de petites erreurs parfois, surtout les meilleurs.
1) Je n’ai expliqué cela nulle part dans mon article ! Votre notion de “pourcentage d’obtenir une probabilité exacte” n’ayant par ailleurs aucun sens, je commence à me dire que vous êtes juste un troll.
2) Vous ne répondez pas à mes arguments, et oubliez que comme je le souligne dans l’article, les auteurs avaient sous la main une variable permettant de faire des groupes basés sur la stade de développement pubertaire mais ont “oublié” de s’en servir pour cet article (mais pas pour un autre réalisé à partir des mêmes données) : si ça leur avait permis de renforcer leur conclusion, nul doute qu’ils auraient utilisé cette variable plutôt que de constituer des groupes d’âge foireux. Mon impression d’être en présence d’un troll se précise.
3) Toujours pas de réponse à mes arguments, et vous en rajoutez dans les remarques passives-agressives destinées à augmenter mon agacement, avec l’espoir de me faire déraper je suppose. Laissez tomber et allez donc voir ailleurs si j’y suis, vous voulez bien ? Merci d’avance.
Bravo pour l’énorme travail de recoupements des diverses études sur le sujet et votre critique de la méthodologie qui m’a permis d’y voir un peu plus clair
Votre blog est une mine d’or
Les differences physiques sont tellement évidentes entre hommes et femmes qu’il est vraiment dommage de renier des résultats montrant que ses différences ne sont pas beaucoup moins subtiles au niveau cérébral. En voyant la figure principale, je ne vois qu”une augmentation de la connectivité bilatéral du lobe frontal chez la femme, qui selon moi ne peut que correspondre à une augmentation de la complexité du raisonnement et de la prise de descision. Votre article en est la preuve ma chère. Pourquoi s’acharner a contredire une qualité d’apparence méliorative par rapport à l’homme?
Jean michel
Il est tellement évident que cette étude n’a pas montré les différences que vous imaginez exister qu’il est vraiment dommage que la lecture de ce billet n’ait pas réussi à déplacer d’un millimètre vos œillères. Vous expliquerez donc aussi aux chercheurs, qui ont publié depuis un essai de réplication aboutissant à la conclusion que ces résultats étaient un artefact de la différence moyenne de taille du cerveau des sujets de l’échantillon (l’un des facteurs de confusion possibles que j’évoquais), qu’ils ne font que “renier” les résultats de leurs collègues. Je m’acharne à contredire l’ignorance, la bêtise, la tromperie, le mensonge, la propagande sexiste, et n’ai que faire des qualités que vous et d’autres attribuez à lafâme.
Sans compter que c’est tout de même très osé de supposer un lien direct entre une augmentation de la connectivité bilatéral du lobe frontal et une augmentation de la complexité du raisonnement et de la prise de décision…
Je puis me tromper mais il me semble que le message signé jean-michel est un un compliment dont je ne sais si le sexisme est ironique et farceur ou simplement maladroit.
PS : extrait de Hanggi et al, Frontiers in Human Neuroscience, 2014 : “Although gender and brain size are highly correlated, the hypothesis of neuronal interconnectivity as a function of brain size is independent of gender. As expected, brain size and gender were significantly related in our sample as well (Cohen’s d = 1.52); hence the large brain group is biased toward men (55/14 m/f), whereas the small brain group is biased toward women (55/14 f/m). However, we were able to replicate the effect found in the gender-pooled sample (N = 138) within the gender-specific subsamples (n = 69 each). The interaction within the gender-specific subsamples (35 small vs. 34 large brains) is statistically significant between small and large female brains as well as between small and large male brains. Therefore, the hypothesis of neuronal interconnectivity as a function of brain size is gender-independent and almost exclusively driven by brain size. Further support for the fact that the important factor, which drives the connectivity pattern under investigation, is brain size and not gender, can be derived from our cross-gender subgroup comparisons. These comparisons revealed stronger effect sizes when comparing small female brains with large male brains (larger brain size difference) on one hand, and no effect when comparing large female with small male brains (no brain size difference) on the other hand.
However, in a recently published study it has been suggested that women have increased interhemispheric connectivity and men have increased intrahemispheric connectivity (Ingalhalikar et al., 2014), whereas the findings of the present study clearly show that this pattern of connectivity can also be found within genders when comparing small-brained with large-brained women and small-brained with large-brained men (see Figure Figure2).2). Therefore, the effects reported by Ingalhalikar and colleagues are, in our opinion, caused by differences in brain size and not by gender as suggested by the authors (Ingalhalikar et al., 2014). To directly disprove their conclusions we first replicated their finding in a random subsample of our study (27 women vs. 27 men). These groups significantly differed in brain size [t(52) = −6.37, p = 5.0E-8, d = 1.77]. In line with their results (Ingalhalikar et al., 2014) we found an interaction between sex and type of connectivity [F(1, 52) = 18.1, p = 0.00009, ηp2 = 0.26]. Post-hoc t-tests revealed strongly increased intrahemispheric connectivity in male compared with female brains [t(52) = 3.04, p = 0.0037, d = 0.84], whereas interhemispheric connectivity was slightly increased in female brains, but did not reach statistical significance [t(52) = −1.27, p = 0.21, d = −0.35]. To investigate sex differences independent of brain size, we then formed a female (n = 27) and a male (n = 27) subgroup that were almost perfectly matched for brain size [t(52) = 0.008, p = 0.99]. In groups with equal brain sizes, no significant interaction between sex and type of connectivity was found [F(1, 52) = 0.008, p = 0.93]. T-tests showed that neither intrahemispheric connectivity is increased in men [t(67) = −0.08, p = 0.94] nor is interhemispheric connectivity increased in women [t(67) = −0.54, p = 0.59]. Our findings provide strong evidence against the conclusions drawn by Ingalhalikar et al. (2014) and clearly show that this apparent sex difference is merely driven by difference in brain size. Further support for our conclusions can be derived from a recently published study that showed that individual differences in brain size account for apparent sex differences in the anatomy of the human corpus callosum (Luders et al., 2014). “
Merci pour cet article Hanggi et al que je ne connaissais pas, et qui est exemplaire sur bien des points (et du coup se retrouve dans Frontiers plutôt que PNAS…). Il confirme une fois de plus que le volume cérébral total est un facteur confondant majeur, et insuffisamment pris en compte, dans bien des comparaisons, entre H et F, mais aussi entre différents troubles (autistes, dyslexiques ou autres) et des groupes contrôles.
Ceci dit, de ma propre expérience avec l’analyse de ce genre de données, lorsque l’on ajuste sur le volume cérébral total, on continue à trouver des différences entre les sexes dans bien des mesures cérébrales locales.